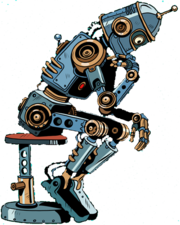Groupe 2 (jeudi)

Vous trouverez ici le cahier de textes des 1eres HLP. Pour des raisons de commodité, il est présenté sous une forme blog : la dernière date renseignée se trouve donc en haut du document. J'ajoute parfois des liens internes, que vous pouvez consulter pour obtenir des précisions sur le contenu d'une séquence. Si quelque chose vous laisse perplexe (point de cours, élément de méthodologie, etc.) n'hésitez pas à mobiliser l'espace posez vos questions...
20.02. Nous consacrons cette séance à la présentation du cheminement que nous allons parcourir après les vacances, pour traiter le second thème de notre programme, qui porte sur les tansformations des représentations du monde à l'âge classique : comment s'articulent les "représentations du monde" (de l'univers, de la terre, de l'animal et de l'homme) et la "vision du monde" qui s'élabore à partir de la renaissance ?
Introduction
1) représenter le monde, se représenter le monde
A partir de la Renaissance s'opère un grand changement dans la manière dont l'homme voit le monde, dans ce que l'on peut appeler sa « représentation du monde », ce que les allemands nomment « Weltanschauung ». Une vision du monde peut être définie à comme « l'image » que l'on s'en donne, la représentation mentale que l'on s'en fait.
Le point important est ici que toute représentation du monde est une interprétation du monde, une manière de lui donner un sens, de le comprendre. C'est ce que traduit bien l'expression française : « se représenter » quelque chose. Représenter, c'est « donner à voir » quelque chose, en produire une image. Se représenter, c'est avoir un certain point de vue, une certaine interprétation de quelque chose. « C'est comme ça que tu te représentes les choses, toi » : c'est comme ça que tu les vois, que tu les comprends. Représenter, c'est toujours « se représenter » ; construire une image de quelque chose, c'est en avoir une certaine vision. La manière dont on représente les choses traduit la manière dont on « voit les choses ».
Donc : la manière dont on représente une chose traduit, manifeste, exprime la manière dont on se le représente, la manière dont on le comprend, la façon dont on l'interprète.
On peut donc dire que la manière dont une époque, une société, une culture, une civilisation représente le monde exprime, rend manifeste sa « vision du monde »
Ex : lorsque, au Moyen-Âge, on représente l'univers avec la terre au centre, c'est une manière de comprendre le monde : le monde est « centré sur la terre », et il est hiérarchisé : en bas, la terre, monde du fluctuant, du périssable, du mouvant. En haut, les astres, animés du mouvement parfait (circulaire) : le ciel est la demeure de(s) Dieu(x).
Si l'on admet ce point, alors on doit admettre que tout changement dans la « vision du monde » (dans la façon dont les hommes « se représentent » le monde) doit se traduire par des changements dans la représentation du monde (dans la manière dont les hommes le représentent) ; et qu'inversement, toute modification dans la représentation du monde manifeste un changement dans la vision que l'homme a du monde, et de lui-même.
Nous allons donc chercher à mettre en lumière ce qui, dans les grandes transformations qui s'opèrent dans la façon dont les hommes représentent le monde à partir de la Renaissance, manifeste un changement dans la vision du monde : comment les images que l'homme a données du monde manifestent une transformation de l'image que l'homme se fait de l'univers – et de lui-même.
2) La représentation de l'univers : la révolution astronomique
La première transformation s'opère dans la représentation de l'univers. On va passer d'une représentation géocentrique à une représentation héliocentrique : c'est ce que l'on appelle la « révolution copernicienne ». Nous essaierons de retracer les étapes de cette transformation, qui s'effectue en un siècle, et qui va de Copernic à Newton (en passant par Tycho Brahé, Kepler et Galilée). Nous essaierons ensuite de montrer en quoi cette transformation implique une modification dans la « vision du monde » à l'âge classique.
a. changement dans la compréhension de l'univers (on passe notamment d'un "monde clos » à un « univers infini »)
b. changement dans la représentation de la place de l'homme dans l'univers (on passe d'une Créature particulière à une créature dotée d'une faculté particulière : la raison. Si l'homme est « au centre du monde », ce n'est plus une localisation géographique, c'est une localisation logique : c'est la raison humaine qui est le point de vue à partir duquel on doit envisager l'univers et le comprendre. L'homme devient le porteur de la faculté qui fonde son humanité : sa raison. C'est le fondement de « L'humanisme ».)
c. changement dans la représentation de la vérité
→ On ne dissocie plus ce qui est vrai « dans l'absolu » (mais qui n'est pas forcément en accord avec ce que l'on observe), le critère de la vérité absolu étant la Révélation, et ce qui « sauve les phénomènes » (ce qui donne un modèle théorique correspondant aux observations et permettant de les prévoir) : la théorie vraie devient celle qui correspond aux observations et qui permet de les prévoir. La vérité quitte le domaine théologique pour le domaine « technique » : ce qui est vrai, c'est ce qui « marche ». La vérité est ce qui est établi par la raison, lorsqu'elle rend compte des faits. D'où le problème de la relation entre la vérité « révélée » et la vérité « démontrée », que nous illustrerons avec l'analyse du procès de Galilée.
d. changement dans la représentation de Dieu
→ Dieu n'est plus le Créateur tout puissant qui a créé un univers parcouru de forces magiques, spirituelles, et qui peut à tout moment intervenir par des « miracles ». Dieu devient l'auteur rationnel d'un monde rationnel, et le travail de l'homme est d'utiliser la raison pour découvrir les lois que Dieu a suivies pour créer le monde. Du Dieu magicien on passe au Dieu mathématicien, au Dieu horloger ; le Verbe devient logos, Dieu lui-même ne peut pas échapper aux lois de la raison. Au contraire, sa perfection vient du fait qu'il est totalement rationnel.
Cette révolution va principalement s'effectuer dans le domaine intellectuel : scientifique, philosophique, théologique. Mais elle va bien sûr se traduire dans les autres espaces, et notamment dans l'espace littéraire. Nous verrons comment la révolution astronomique va se traduire dans des romans qui visent à transporter le lecteur sur une autre planète, pour regarder la terre depuis cette autre planète, ce qui fonde la topique du « Voyage sur la lune ». Nous essaierons de montrer en quoi l'émergence de cette topique signe l'avènement de la « Science Fiction » au sens moderne du terme.
3) La représentation de la terre : la révolution cartographique
A cette première révolution va être liée une seconde : celle qui affecte l'image que l'homme va produire de la surface du globe terrestre. Elle lui est d'abord liée au sens où toute représentation du globe terrestre vise à donner une image de la terre telle qu'on pourrait la voir depuis le ciel, mais aussi parce que la position des astres joue un rôle clé dans la détermination des latitudes et des longitudes. Le sextant apparaît au XVII° siècle : il permet de déterminer la latitude d'un navire à partir de la position des astres dans le ciel, de l'angle qu'ils forment avec l'horizon. Le problème de la détermination de la longitude sera le casse-tête du XVII° siècle (une fois que l'on a reconnu que la terre tourne sur elle-même), et nous verrons que la découverte des satellites de Jupiter par Galilée constituera une étape dans la résolution de cet épineux problème.
Nous chercherons à montrer en quoi la représentation cartographique du monde t raduit la « vision du monde » propre à l'homme de l'âge classique :
_ de ses principaux intérêts (commerciaux, militaires),
_ de la représentation (centrale) qu'il se fait de l'homme européen sur terre
_ de la manière dont il articule le temps et l'espace : la longitude n'est qu'une question de fuseau horaire. Déterminer la position sur le globe, c'est déterminer « l'heure qu'il est ».
Là encore, cette transformation va se traduire dans le domaine littéraire. Nous montrerons en quoi à « l'exotisme » comme topique littéraire correspond une autre forme d'exo-tisme, plus philosophique, qui se traduit par l'émergence (ou la ré-émergence) des Utopies. L'Utopie, c'est le « lieu qui n'est nulle part », mais qui indique néanmoins une perspective ; perspective critique, mais pas seulement. « Une carte du monde ne faisant pas mention du royaume d'Utopie ne mérite même pas un coup d'oeil, car elle laisse à l'écart le seul pays où l'humanité finit toujours par aborder. Et quand elle y aborde, elle regarde à la ronde, et, découvrant un pays meilleur, elle cargue ses voiles. » (Oscar Wilde L'Âme humaine). L'Utopie illustre l'articulation de l'espace et du temps sous le mode de l'imaginaire : le pays d'Utopie est le pays qui ne se trouve nulle part dans la mesure, principalement, où il n'existe pas encore (ou n'existe plus).
4) La représentation artistique du monde : une perspective humaine
La représentation du monde par l'homme s'opère également par la voie propre de l'art ; en ce qui concerne la représentation graphique, visuelle, la grande transformation qui s'opère est l'émergence de la représentation en perspective. Nous retracerons les principales étapes de cette nouvelle « représentation de la représentation », en essayons de dégager ce qui, dans la représentation du monde en perspective, traduit un nouveau « point de vue » de l'homme sur le réel. En quoi la représentation en perspective traduit-elle la perspective humaniste sur la réalité ?
a. En quoi la représentation en perspective correspond-elle à une absolutisation du point de vue de l'homme sur le réel ? En quoi le monde tel qu'il est doit-il être conçu comme le monde tel qu'il apparaît à l'homme ? [Mise en rapport de l'émergence du portrait et de la persêctive, en opposition aux miniatures persanes]
b. En quoi les fondements mathématiques de la perspective traduisent-ils une géométrisation du monde ?
c. Quels (nouveaux) rapports faut-il alors établir entre la représentation picturale du monde et les autres modes de représentation artistique, comme la représentation poétique ? [Ut pictura poesis]
5) La représentation de l'homme, des « autres hommes » : la révolution ethnologique
L'époque qui va de la renaissance au XVIII° siècle est évidemment celle qui voit la découverte d'autres continents, et donc d'autres humains.
La question qui se pose alors est de comprendre comment la représentation de ces autres hommes traduit la « représentation » que les Européens se font de ces autres hommes (mais s'agit-il bien d'autres hommes ?)
Ici, le traitement est avant tout littéraire : car ce sont avant tout par des récits, et notamment par des récits de voyage (Cortès, Lery, etc.) que vont être décrits les hommes d'autres sociétés. Analyser l'image que les explorateurs se font des indigènes, c'est donc analyser la manière dont ils racontent leur rencontre avec ces indigènes.
Le questionnement de fond est alors le suivant :
_ s'il existe d'autres « hommes », peut-on les considérer comme aussi humains que ceux qui les rencontrent ? Peut-on les considérer comme « inférieurs » ? Par exemple, sont-ils, eux aussi, des descendants d'Adam ? Ont-ils, eux aussi, bénéficié de la Révélation ?
_ si le mode de vie de ces « sauvages » est différent du nôtre, doit-on considérer que ce mode de vie est « moins humain » que le nôtre, ou qu'il constitue seulement un mode de vie différent ? S'agit-il d'un mode de vie « naturel », ou d'une autre culture ? Et le sauvage, est-il celui qui est plus proche de l'animal, ou celui qui est resté plus proche de la nature... humaine ?
On insistera sur l'analogie entre cette révolution ethnologique, anthropologique, et la révolution astrologique. Si la révolution copernicienne avait amené l'homme à se situer sur la Lune pour regarder la terre depuis la Lune, la rencontre d'autres sociétés permet en retour de regarder notre société « depuis » la leur. Le mythe du « bon sauvage » tel qu'il se développe du XVI° siècle au XVIII° siècle repose sur une logique paradoxale : un Européen cherche à adopter le point de vue du sauvage tel qu'il le conçoit, pour observer, analyser et critiquer sa propre société. (De ce point de vue, le Supplément au voyage de Bougainville est un aboutissement).
6) La révolution biologique : l'homme est-il un animal comme les autres ?
La dernière grande transformation qui s'opère dans la « représentation » du monde par l'homme concerne le monde du vivant, le monde « biologique ». Nous nous intéresserons surtout, pour notre part, à la représentation scientifique, dont nous verrons qu'elle est en fait une représentation scientifico-philosophico-théologique. Cette représentation prend d'abord la forme d'une classification, d'une représentation nosologique du vivant, qui pose l'épineuse question de la classification des espèces.
Où faut-il placer l'homme dans la classification des êtres vivants ? Faut-il le considérer comme un règne à part, ou comme un membre du règne animal ? Comment faut-il situer l'homme par rapport à l'animal ? Nous verrons que, une fois encore, les prises de position les plus « modernes » sont parfois celles qui portent avec elles le plus de représentations traditionnelles, religieuses, voire mythiques.
En retour, comment faut-il considérer l'animal par rapport à l'homme ? L'animal est-il à ranger dans l'ordre des « choses », comme l'impliquerait le fait de le considérer, de le représenter comme une sorte d'automate, de machine très élaborée ? Ou faut-il considérer que, étant animé par un élan vital, une « âme » au sens artistotélicien, on doit également lui reconnaître une âme au sens spirituel, religieux, et donc, peut-être, des droits ?
DM à rendre pour la rentrée : choisissez l'un des trois textes, et traitez les questions (interprétation et réflexion) qui lui sont liées. Les textes et les questions sont téléchargeables ici : ![]() Sujets de DM sur sagesse et éloquence (34.12 Ko)
Sujets de DM sur sagesse et éloquence (34.12 Ko)
13.02. Nous terminons notre premier chapitre par la mise en lumière de quelques "ponts" qui peuvent être construits entre les analyses que nous avons effectuées dans le cadre de la période de référence, et les enjeux de l'époque contemporaine. Cette mise en relation s'effectue autour de trois axes, que nous illustrons par des extraits vidéo, articulés à une sélection de textes que vous pouvez ![]() télécharger ici (41.08 Ko).
télécharger ici (41.08 Ko).
1. Le premier axe concerne le rôle politique du langage. Si la langue est l'instrument de la pensée, n'est-elle pas un support privilégié pour l'établissement d'une domination idéologique, propre à un système totalitaire ? Nous prenons appui sur les analyses de Klemperer, qui a analysé les transformations de la langue allemande sous le régime nazi. Pour Klemperer, la langue a constitué le support le plus important de la diffusion de l'idéologie nazie (beaucoup plus que les signes visibles, ostentatoires de la propagande officielle). S'il y a bien eu une "langue du troisième Reich" (ce que Klemperer appelle : la LTI, Lingua Tertii Imperii), c'est parce que le régime nazi a su détourner la langue (allemande) pour la mettre à son service. Klemperer a, dans son journal, analysé jour après jour les détournements de sens, les modifications dans les acceptions (l'un des plus manifestes est le changement de la valeur associée au terme de "fanatique", qui devient un qualificatif positif), les transformations stylistiques (le mode déclamatoire devenant le seul et unique mode d'énonciation) qui ont marqué l'évolution de la langue durant le "Troisième Reich" (notion qui est elle-même idéologique, puisqu'elle articule une désignation historique et un référent symbolique, mythologique). Il a bien eu une "nazification" de la langue ; et la "dénazification" de l'Allemagne exigera, pour Klemperer, la dénazification de ce qui constitue le support même de la pensée.
2. Notre deuxième axe s'articule directement au précédent. Il est en effet désormais connu que le ministre chargé de la propagande au sein du système nazi, Göbbels, était lui-même un lecteur de l'ouvrage d'un penseur américain, Edward Bernays, l'inventeur des "relations publiques". Pour Bernays, les démocraties modernes font face à un paradoxe : alors que chaque citoyen est désormais censé formuler, par son vote, son jugement personnel et réfléchi, il est impossible pour la masse des citoyens de construire de façon autonome un jugement informé et réflechi sur l'ensemble des problèmes face auxquels ils doivent prendre position (ils n'en ont pas le temps, ni les ressources). De sorte que la masse des électeurs doit confier à un "gouvernement invisible" le soin de déterminer ce sur quoi il faut se prononcer, et ce qu'il faut penser. Les institutions chargées de façonner l'opinion publique sont les instituts de communication qui, pour éviter les connotations devenues péjoratives de la "propagande", s'occuperont désormais de "relations publiques". Bernays n'est pas seulement un théoricien de la propagande : c'est avant tout un praticien de génie, qui a compris que les mécanismes de la publicité (par lequels on peut façonner les désirs, les aspirations et les comportements économiques des individus) peuvent être mobilisés au sein de l'espace politique. Bernays a ainsi participé à la Commission Creel, qui s'était vue confier la tâche (l'objectif ayant été brillamment atteint) de transformer l'opinion publique américaine, majoritairement hostile à l'entrée en guerre des Etats-Unis lors de la Première Guerre Mondiale), en soutien actif de l'intervention armée. Bernays a ainsib réactivé l'intuition des Sophistes selon laquelle l'art de persuader repose avant tout sur un contrôle des émotions, qui suppose une connaissance approfondie des mécanismes psychologiques et sociologiques qui régissent le comportement de l'homme quand il est est situé dans une foule. Celui qui maîtrise ces mécanismes peut ainsi jouer sur les facteurs inconscients de nos décisions, qui sont en vérité les facteurs déterminants de la plupart de nos comportements. La conception que Bernays se fait des relations publiques illustre ainsi la manière dont la maîtrise de la communication peut être le support d'un maintien de la domination des élites au sein d'un cadre démocratique.
3. Notre troisième axe consiste à rechercher ce qui pourrait s'apparenter, dans le monde contemporain, à la figure de "l'orateur" tel que le concevait Cicéron. Nous commençons par mettre en garde contre des attentes infondées : s'il existe aujourd'hui un "orateur", ce dernier n'exerce plus son art dans le cadre qui était celui de l'orateur antique. Il ne s'agit plus désormais de haranguer une foule en utilisant les seules ressources de la voix et du geste : l'orateur actuel, s'il existe, est avant tout un personnage qui s'adressera à des milliers, voire des millions de spectateurs qui seront avant tout des téléspectateurs et des internautes, auxquels il s'adressera par le truchement des nouvelles technologies. Ce que nous cherchons, ce n'est donc pas un "tribun", c'est un personnage qui :
a. cherche à mobiliser les ressources du langage pour persuader un auditoire d'une cause qu'il estime juste, de façon à opérer un changement de comportement dans son public
b. articule de façon raisonnée les ressources de l'argumentaire logique et le recours au pathos (auquel est reconnu une légitimité dans la prise de décision, sans que le pouvoir de l'émotion prétende l'emporter sur la délibération réfléchie)
c. fonde son discours sur une connaissance rationnelle du "fond", qu'il puisera donc le plus largement possible aux données scientifiquement établies
d. adapte ses procédés oratoires au public et à l'effet visé (ce qui implique une réflexion sur ce qui fonde "l'efficacité" de l'éloquence)
e. articule son discours à une valorisation explicite de la démocratie : l'orateur est moins là pour obtenir l'approbation d'un "décideur" que pour éclairer et atiser les attentes du peuple, qui doit être persuadé dans la mesure même où il constitue le seul authentique Souverain.
Si l'on articule ces diférents points, on s'aperçoit que celui qui constitue une incarnation assez fidèle de l'orateur cicéronien dans le contexte actuel est peut-être... une oratrice. Greta Thunberg incarne en effet de façon conséquente la recherche d'un discours persuasif, mis au service d'une cause à la fois civique et universelle (la protection de l'environnement au nom des générations futures), cause pour laquelle la peur et l'espérance (qui sont des affects) sont des éléments essentiels, notamment lorsqu'ils prennent appui sur des données scientifiquement établies (les rapports du GIEC), qui doivent éclairer le jugement de celui qui, seul, pourra mener à bien la transformation radicale qui s'impose : le Peuple.
L'un des mpoints intéressants de la "rhétorique" de Greta Thunberg est la manière dont elle fait appel à la "séduction" du public ; nous avons souligné le fait que l'orateur cicéronien ne vise pas à "surfer" sur les tendances spontanées de la foule pour en tirer profit, mais bien à en solliciter les forces pour les détourner de leur trajectoire prévisible. Or en quel sens peut-on dire que les discours de Greta Thunberg sont "flatteurs" pour le public ? Ils ne le sont manifestement pas pour ses interlocuteurs directs, qu'elle accuse presque toujours d'inaction, de passivité et (donc) d'irresponsabilité ; si ses propos sont "flatteurs", ce ne peut donc être que du fait s'une stratégie de "double élocution", par laquelle l'oratrice s'adresse, par-delà ses interlocuteurs ditrects, au public qui suivra les débats par le biais de différentes transmissions. C'est bien "le peuple" qui pourrait se sentir flatté, et plus particulièrement le peuple des générations qui viennent ; mais il ne le sera... qu'à la condition de répondre à l'appel de l'oratrice. Celui qui écoute le discours d'un air réjoui et approbateur, tout en partageant la passivité des auditeurs directs, c'est-à-dire sans chercher à transformer le mode de vie des habitants des sociétés développées -- à commencer par le sien -- n'a en fait aucune raison de se sentir flatté. Les discours de l'oratrice ne sont "flatteurs" que pour ce "peuple" auquel elle fait appel et qui n'existe pas encore, ce peuple qui vient... et dont la venue est justement ce à quoi le discours cherche à contribuer.
13.02. [Cicéron, suite et fin] La question qui se pose alors est de savoir en quoi la philosophie a besoin, elle de l'éloquence.
A l'aide du premier texte du recueil, nous soulignons le fait que le débat public, la controverse peuvent être de véritables supports pour la réflexion. Tant que le penseur reste à son bureau, dans le confort douillet de ses méditations privées, au coin de son poêle en quelque sorte, il ne répond qu'aux objections qu'il se formule à lui-même, et il est à lui-même son propre public. Or on se persuade assez facilement soi-même, surtout quand on fait les questions et les réponses. Au forum, c'est à un adversaire qu'il faut répondre, aux arguments et aux exemples qu'il produit pour défendre sa cause. Et celui qu'il s'agit de convaincre, ce n'est pas notre for intérieur, c'est le public qui n'est pas là pour nous complaire. « Descendre dans l'arène », ce n'est donc pas, pour un penseur, renoncer à l'argumentation pour le spectacle : c'est plutôt accepter les risques inhérents à une réflexion véritable.
Le second texte insiste sur la réciprocité de la dépendance : si un beau parleur sans savoir n'est qu'un bavard, un philosophe qui ne sait pas s'exprimer n'est pas vraiment meilleur. D'une part, il est assez suspect de dissocier la capacité à penser clairement et la capacité à parler clairement... puisque la pensée se formule dans et par le langage. Une parole confuse est donc le signe d'une pensée confuse, bien plus que d'un manque de mots ou de style. Mais surtout, la parole n'est pas seulement le support de la pensée : elle en est également le véhicule, ce qui en permet l'extériorisation, la communication. L'éloquence est ce qui permet de passer de la pensée à l'action : c'est grâce à la parole que ce que je pense peut exercer un effet sur le réel, sur la pensée (et l'action) des autres hommes. Une pensée sans éloquence est donc une pensée sans effet, une pensée stérile.
Et c'est là le reproche fondamental que développe Cicéron dans les textes suivants : une pensée sans éloquence est une pensée dont on a détruit l'aboutissement nécessaire et légitime. Ce qui donne sa valeur à quelque chose, dans l'esprit de Cicéron, c'est sa capacité à servir des valeurs : et les plus grandes valeurs sont la vérité et la justice. La pensée du philosophe ne trouve donc sa valeur véritable que là où elle permet à la vérité de triompher de l'erreur, à la justice de combattre l'iniquité. Or un penseur qui ne sait pas persuader ne saura pas défendre l'innocent, ni faire condamner le coupable ; il ne saura pas détromper une foule, il ne saura pas la conduire vers la vérité.
C'est dans l'avant-dernier texte du recueil qu'apparaît ainsi un élément capital de l'éloquence de l'orateur : s'il est vrai que l'orateur véritable doit savoir se rendre maître des opinions et des sentiments de la foule, il ne s'agit en aucun cas pour lui de « surfer » sur ces opinions et ces sentiments, en disant au peuple ce qu'il a envie de croire, ou en excitant les passions qui l'animent déjà. Bien au contraire : ce qui fait la véritable puissance de l'orateur, c'est justement qu'il est capable de détourner le peuple d'une injustice ou d'une erreur. L’orateur n'a rien d'un démagogue qui cherche à accéder au pouvoir en se soumettant aux opinions de la foule : c'est au contraire un homme qui parvient à utiliser les forces qui animent la foule pour la conduire ailleurs que là où ces forces la portaient spontanément. Si la pensée de l'orateur est une pensée efficace, c'est justement parce qu'elle peut défendre l'innocence là où elle était en danger, poursuivre le criminel là où il semblait protégé, détruire l'erreur là où elle prédominait, etc.
Si l'orateur doit connaître les opinions et les passions des foules, c'est bien pour s'en rendre maître ; mais se rendre maître d'une force, ce n'est pas la suivre servilement pour en tirer des bénéfices personnels : c'est être capable d'en capter la puissance pour l'orienter vers sa destination légitime. Non en la soumettant à une contrainte extérieure (comme la force physique), mais en réussissant à en orienter le cours "de l'intérieur" : tel est le propre de la persuasion, qui aboutit au fait qu'un individu choisit de lui-même d'admettre la vérité d'un noncé, la justice d'une cause.
On voit alors apparaître pleinement ce qui constitue l' « orateur » pour Cicéron. L'orateur, c'est la pensée en acte :
a) c'est la réflexion qui utilise le langage pour se construire, et pour agir sur la réalité ;
b) c'est le langage qui se met au service des idées, et se fait arme de persuasion au service de la vérité et de la justice
c) c'est l'acte éclairé par la pensée, et qui n'a recours qu'à une force purement humaine (et non à la contrainte physique) : la force de la parole
Ces trois formules sont bien sûr analogues : elles indiquent le chemin qui va de la pensée à l'action dans la Cité en passant par le langage. Ainsi, l'orateur de Cicéron est celui qui réunit en lui les trois dimensions essentielles de l'humanité de l'homme : la pensée, la parole, la politique.
Il est celui par lequel la sagesse agit dans la Cité par l'intermédiaire de l'éloquence.
Il est le philosophe-orateur-magistrat : il est l'homme complet.
Cicéron insiste à plusieurs reprises dans son Traité sur le fait qu'il ne s'agit pas ici de décrire l'orateur tel qu'il est généralement, mais bien l'orateur idéal. Mais si c'est l'orateur idéal qu'il s'agit de trouver, c'est parce que cet orateur idéal est lui-même l'incarnation de l'Homme idéal, de l'homme pleinement homme. L’orateur parfait, c'est l'homme parfait.
Et c'est la raison pour laquelle il ne peut pas y avoir de « manuel » de l'orateur, pas plus qu'il n'y a de « manuel » de sagesse ou de « manuel » du souverain. Aucune « technique », aucun ensemble de règles, de prescriptions et de recettes ne peut faire de nous un sage ; aucun recueil de maximes et de préceptes ne peut faire du lecteur un bon citoyen ; aucun « manuel de rhétorique » ne peut donner la maîtrise de l'éloquence. Tout ce qui est proprement humain en l'homme ne peut se développer que par un long travail théorique et pratique, par lequel parviendront à maturation des dispositions naturelles.
S'il n'existe pas de « manuel » de sagesse, de politique ou d'éloquence, comment existerait-il un manuel pour l'art qui réunit les trois, l'art de l'orateur ? Il peut éventuellement exister des manuels d' « Humanités » (dans lesquels on trouvera des enseignements philosophiques, des enseignements rhétoriques, des enseignements civiques...) : il n'existe et n'existera jamais de manuel d'humanité.
06.02. [Cicéron, suite]
Comment se fait-il que la sagesse et l'éloquence, la pensée et le discours, la réflexion et la parole, la philosophie et la rhétorique... se soient séparés ? Et qui est responsable de cette séparation ?
b. la faute de Socrate
D'après ce que nous avons dit précédemment, il semble y avoir deux types de candidats possibles : les Sophistes (dont Gorgias et Isocrate), et les philosophes (à commencer par Socrate). Etant donnée l'admiration profonde que Cicéron voue à Platon, on pourrait s'attendre à ce qu'il rende les Sophistes responsables du divorce désastreux entre rhétorique et philosophie, entre sagesse et éloquence.
Or ce n'est pas le cas. Celui que Cicéron désigne comme le grand fautif, ce n'est pas Gorgias, ni Isocrate (tous deux mentionnés dans le texte) : c'est bien Socrate. Pourquoi ?
Le texte l'indique clairement. La faute originelle de Socrate, c'est d'avoir privé la pensée de ce qui en constitue l'aboutissement nécessaire : l'engagement dans la vie de la Cité. En effet, la sagesse réunit nécessairement la pensée et l'action : il ne suffit pas de chercher et de savoir ce qui est juste, il faut agir conformément à ce savoir. La recherche de la vérité et de la justice doivent déboucher sur des engagements concrets, par lesquels le penseur cherche à mettre en œuvre et à défendre le Vrai et le Juste. Etre juste, ce n'est pas seulement connaître ce qui est juste : c'est agir pour faire triompher la justice, en participant aux affaires de la Cité. Et c'est justement pour cela que le penseur a besoin de l'éloquence, car c'est par ses discours qu'il peut agir dans la Cité, au Sénat ou ailleurs.
Or c'est ce que Socrate (d'après Cicéron) s'est refusé à faire. Il s'est retiré des affaires, il a refusé de participer aux institutions, il a soigneusement évité tous les postes « à responsabilité » au sein de la Cité. Et, de fait, Socrate a bel et bien refusé cet engagement, comme il nous l'a dit dans l'Apologie : il a délaissé « les emplois militaires, les fonctions d'orateur et toutes les autres dignités. »
Donc : Socrate a renoncé à l'aboutissement naturel, logique, légitime de la pensée : l'engagement dans les affaires de la Cité. Est-ce par manque de dispositions, de talents oratoires ? Pas du tout. D'après Cicéron, Socrate brillait « par son savoir, sa pénétration, sa grâce et sa finesse, et aussi par l'éloquence, la variété, l'abondance avec lesquelles il traitait toutes les questions ». Mais justement : comme la pensée de Socrate était privée de son aboutissement naturel, comme elle ne pouvait pas s'exprimer et se réaliser dans l'espace politique par l'éloquence.... elle s'est retournée contre l'éloquence elle-même. Socrate a mis toute sa pensée et son éloquence au service de la critique de l'éloquence, il est devenu le plus grand contempteur de l'éloquence parce que sa propre sagesse, ne pouvant aboutir et se réaliser dans une participation active aux affaires de la Cité, s'est déchaînée contre l'éloquence, contre le moyen dont elle aurait dû se servir pour s'exprimer et se concrétiser.
Nous soulignons au passage qu'il y a incontestablement quelque chose de très « moderne », voire de très contemporain dans ce procès de Socrate par Cicéron.
a. D'une part, elle anticipe certaines des analyses qu'un autre admirateur-ennemi de Socrate produira, près de 20 siècles après : celles de Friedrich NIETZSCHE. Nietzsche (l'un des plus grands philosophes allemands du XIX° siècle, que vous croiserez forcément l'année prochaine) dira, lui aussi, que Socrate a retourné sa force contre lui-même, mettant son intelligence et son éloquence au service de la condamnation de ce qui aurait dû en être l'aboutissement naturel : l'action, l'emprise sur le monde et sur les autres.
b. d'autre part, elle esquisse une critique très actuelle de « l'intellectuel », du penseur-philosophe qui se retire de la participation active aux institutions (économiques, politiques, judiciaires....), et qui exerce ensuite toute son intelligence à critiquer, condamner violemment tous les moyens par lesquels des discours agissent, jour après jour, et de façon toujours plus efficace, sur la réalité. Cicéron dresse ainsi un portrait assez acerbe du « philosophe-qui-condamne-la-communication », mais qui s'abstient lui-même d'intervenir activement là où les discours peuvent réellement agir (c'est-à-dire : ailleurs que dans de gros livres, des revues spécialisées ou des colloques universitaires).
Nous voyons à présent pourquoi la sagesse et l'éloquence se sont dissociées, comment la philosophie, ayant été détournée de l'engagement civique, s'est transformée en arme de destruction de la rhétorique.
Il nous reste à montrer pourquoi cette dissociation est une erreur et, plus encore, une catastrophe, aussi bien pour l'éloquence elle-même que pour la philosophie.
3) Pourquoi l'éloquence a besoin de la philosophie
a. On ne parle bien que de ce que l'on connaît
La première raison pour laquelle l'éloquence ne peut se passer d'une étude du « fond », d'une réflexion et d'un examen approfondis aboutissant à un savoir, est assez simple. C'est que, pour Cicéron, on ne peut jamais réellement bien parler de ce que l'on ne connaît pas, ou de ce que l'on connaît mal. Celui qui ignore tout de ce dont il prétend parler pourra peut-être faire illusion à sa table de travail, mais il ne parviendra jamais à persuader un auditoire, surtout lorsqu'il devra faire face à un orateur qui, lui, « connaît le dossier ».
Ainsi, pour plaider une cause devant un tribunal, il ne suffit pas de mobiliser des formules brillantes et d'émouvoir : il faut réussir à convaincre, c'est-à-dire prendre appui sur des faits établis et des raisonnements étayés. Il ne suffit certes pas d'être savant pour être éloquent ; mais un rhéteur ignorant ne fera jamais un bon orateur.
Il faut se rappeler que, lorsque Cicéron dit cela, il sait de quoi il parle. L'un des premiers grands succès qu'il a rencontrés dans sa carrière politico-judiciaire est celui que lui a valu le procès contre Verrès, un « prêteur » romain en Sicile (c'est-à-dire essentiellement : un représentant de l'autorité romaine), accusé de corruption, d'abus de pouvoir et de détournement de fonds (ces qualifications correspondraient aux dénominations actuelles des méfaits commis par Verrès). Qu'est-ce qui a permis à Cicéron de gagner ce procès ? Est-ce son génie oratoire ? Non. Ce qui lui a permis de gagner, alors même que les chances semblaient plutôt être contre lui, c'est sa parfaite connaissance du dossier... et du fonctionnement des institutions romaines. Non seulement Cicéron va se rendre sur place et constituer un énorme dossier à charge, étayé sur des témoignages précis et étayés, mais il va aussi prendre son adversaires de vitesse : ce dernier sait (et Cicéron le sait aussi) que, si le procès est retardé, la composition du jury sera réellement favorable à Verrès. Alors Cicéron fonce : il mène son enquête à toute allure, expédie son introduction lors de la session d'ouverture et passe directement à l'audition des témoins, dont les témoignages sont si nombreux et accablants que Verrès s'enfuie sans attendre la suite du procès (il sera condamné, par contumace, à verser un million et demi de sesterces aux Siciliens).
Voilà exactement le genre de tour de force que l'on ne pourra jamais réussir sans une connaissance approfondie du dossier, c'est-à-dire aussi bien des faits et des témoignages que du fonctionnement des institutions romaines.
Nous soulignons au passage que cette affaire a donné à Cicéron l'occasion d'ajouter une nouvelle œuvre au patrimoine de tous les plaidoyers fictifs, qui jalonnent toute l'histoire de la rhétorique. Nous en avons déjà croisé deux : si « l'Eloge d'Hélène » par Gorgias correspondait en fait à un « procès » fait à Hélène, que nul ne songeait réellement à intenter, le texte d'Isocrate était lui-même extrait d'une plaidoirie qu'Isocrate aurait commise... dans un procès totalement imaginaire. Cicéron, lui, n'ayant pu effectivement tenir les discours qu'il réservait pour la suite du procès (Verrès ayant fui, ce qui a mis fin aux débats)... les a publiés « comme si » ils avaient effectivement été tenus. Toute l'histoire de l'éloquence est jalonnée de ces plaidoiries imaginaires, déployées dans des procès fictifs.
b. On ne parle bien qu'à ceux que l'on connaît
Mais il ne suffit pas de connaître ce dont on parle pour être éloquent. Dans la mesure où l'orateur ne doit pas seulement persuader de quelque chose, mais doit (évidemment) persuader quelqu'un de quelque chose, l'orateur doit aussi connaître les hommes auxquels il s'adresse. Il doit non seulement connaître les ressorts de l'esprit humain (quels sont les arguments qui peuvent convaincre ce type de public ? Quelles sont les stratégies qui permettront de l'émouvoir ?, etc.) mais également la manière dont ses ressorts se transforment lorsque l'on passe d'un individu à un groupe. L'orateur doit ainsi être un bon connaisseur de l'âme humaine, aussi bien individuelle que collective. En termes contemporains : l'orateur doit avoir une formation solide, aussi bien en psychologie qu'en sociologie. Si l'orateur est le personnage-clé des Humanités, c'est aussi parce qu'il est l'un des premiers à avoir dû constituer un savoir que nous rangerions aujourd'hui dans le registre des « sciences humaines ».
Là encore, cette analyse de Cicéron nous renvoie à la fois en amont et en aval. En amont, car il a été démontré (par exemple, par cette grande spécialiste de l'Antiquité que fut Jacqueline de Romilly) que les grands Sophistes avaient joué un rôle de pionniers dans ces domaines d'étude que nous appelons aujourd'hui « psychologie », « psychologie des foules » ou « sociologie ». Pour persuader une foule, il fait savoir comme une foule « fonctionne », quels sont les mécanismes qui régissent ses réactions, ses comportements (et ses emportements), quelles lois on peut utiliser pour obtenir l'effet voulu. Toute technique, pour être efficace, suppose une connaissance correcte de ce sur quoi elle agit ; l'ingénieur ne peut agir efficacement sur la matière que parce que le physicien l'a préalablement éclairé sur les lois et mécanismes qui régissent le monde matériel. Et dans la mesure où l'art oratoire peut bien être considéré comme une « technique », par laquelle on cherche à agir efficacement sur un auditoire, cette technique présuppose une connaissance correcte des lois et des mécanismes qui régissent les jugements, les émotions et les comportements de cet auditoire. Et en ce sens, les Sophistes ont bel et bien été des pères fondateurs de ce que nous appelons aujourd'hui « psychologie », individuelle ou collective.
Mais cette analyse de Cicéron annonce également des idées qui ne seront explicitement défendues que 20 siècles plus tard, notamment par l'un des pères de la « Communication » contemporaine, l'inventeur des « Relations Publiques » : Edward BERNAYS. C'est Bernays qui dira (nous le verrons bientôt) que, si la « communication » est aujourd'hui devenue une science (humaine), c'est d'abord parce que la psychologie (individuelle et collective) et la sociologie sont désormais devenues véritablement scientifiques. Celui qui veut manipuler un individu ou une foule doit savoir comment « fonctionnent » cet individu et cette foule ; or ce sont avant tout les « sciences humaines » qui nous éclairent sur les lois et mécanismes de ce « fonctionnement ».
Précisons que, pour Cicéron, l'acquisition de ce savoir ne peut jamais seulement être "théorique" : elle doit également être "pratique" ; la connaissance des lois et des mécanismes qui régissent la pensée et le comportement des hommes n'est pas seulement une affaire d'études : c'est une question d'expérience.
c. Question locale, problème général
Il y a encore une troisième raison pour laquelle l'éloquence ne peut se passer des services de la philosophie : c'est que toute question, même lorsqu'elle porte sur un cas qui a eu lieu ici et maintenant, engage un problème d'ordre général.
C'est cette fois Antoine qui parle. Et il fait remarquer que, même lorsque l'on doit trancher une question qui implique tel individu, dans telle situation, on est amené à poser des questions qui n'ont plus rien à voir avec cet individu et cette situation.
Nous prenons un exemple différent de celui d'Antoine. Supposons que l'on se demande, dans un tribunal, si l'on peut reconnaître l'accusée A (Madame Champfoin) comme responsable de l'acte B (elle a blessé violemment Monsieur Sringh).
Il se trouve que l'accusée a blessé la victime lors d'une crise de délire violente, due à l'absorption d'une drogue qu'on avait versé à son insu dans son verre (dans son délire, Monsieur Sringh lui est apparu somme un extraterrestre mandaté par l'ONU pour la supprimer, ce qu'il s'apprêtait à faire à l'aide d'une cigarette qui se trouvait en réalité être une sarbacane aztèque). Pour savoir si l'on peut reconnaître l'accusée responsable et coupable, on doit donc se demander si l'on peut reconnaître pénalement responsable quelqu'un dont le discernement était aboli au moment des faits. Est-on responsable d'un crime parce qu'on l'a commis, ou parce qu'on l'a commis délibérément ? Faut-il jouir de toutes ses capacités mentales pour pouvoir être considéré comme responsable de ses actes ? Est-ce parce que nous sommes dotés de discernement, de raison et de conscience, que nous pouvons être considérés comme libres, et donc responsables de nos actes ?
Il va de soi que cette question n'a plus rien à voir avec Madame Champfoin ou avec Monsieur Sringh. C'est un problème général, qui engage un débat fondamental concernant le lien entre discernement (raison, conscience), volonté, liberté et responsabilité. Et de toute évidence, ce débat n'est pas de nature technique : c'est un problème philosophique.
Il est donc tout à fait vain de vouloir dissocier les questions « spécifiques » que doit traiter l'avocat dans un tribunal, et les problèmes fondamentaux, qu'il conviendrait de laisser aux philosophes. Tout débat judiciaire (et, à plus forte raison, toute débat politique) implique des débats philosophiques : celui qui ignore tout de ces problèmes ne saurait donc être cet « orateur parfait » que cherche Cicéron.
d. Eloquence et vertu
On trouve dans le dernier extrait une thèse importante : c'est que l'apprentissage de l'éloquence doit nécessairement être accompagné d'une formation à la vertu. L'art oratoire est une arme : on pourrait même le considérer comme une "arme de persuasion massive", qui rend celui qui le maîtrise capable de conduire les foules là où il le veut. Il est donc tout à fait indispensable d'articuler la maîtrise de cet art à un apprentissage de la sagesse : seul doit l'acquérir celui qui se rend digne de le posséder.
Il est assez amusant de rapprocher cette caractérisation de l'éloquence, de celles que l'on peut trouver dans la tradition des arts martiaux (notamment dans la tradition asiatique) : si la valeur d'un art ou d'une technique dépend de l'usage qui en est fait, cela vaut avant tout pour les arts et les techniques de combat. Ainsi, maîtrise de l'art et maîtrise de soi doivent aller de pair, l'acquisition de la force suppose, exige celle de la sagesse. Comme le souligne Crassus, enseigner l'éloquence à ceux qui ignorent la vertu, c'est "donner des armes à des furieux".
L'éloquence est donc indissociable d'une recherche de la sagesse ; c'est-à-dire : de la philosophie.
30.01 Fin de l'étude des extraits de l'Apologie de Socrate
Les analyses effectuées à partir de l'extrait 1 sont confirmées par la lecture des extraits 2 et 3 : dans le premier, Socrate indique clairement qu'il refuse de recourir aux procédés oratoires habituels (c'est-à-dire ceux auxquels on est supposé recourir quand on est dans un tribunal). Ainsi, il ne fera pas défiler devant ses juges les membres de sa famille (dont ses enfants) pour exciter leur pitié. Pourquoi ?
Non (il le précise) par orgueil ou par mépris envers ses juges... mais parce qu'il les respecte. Or respecter un juge, c'est considérer qu'il assume sa fonction avec probité et dignité : et que par conséquent sa décision n'est déterminée que par sa raison, et par les lois. Par opposition, essayer d'attendrir un juge, vouloir le « prendre par les sentiments », c'est lui faire offense : car c'est supposer que son jugement peut être déterminé, non par la raison ou les lois, mais par ses émotions. C'est donc le considérer... comme une femme (nous sommes dans l'Antiquité), c'est-à-dire comme un être dont les jugements et les actes ne sont pas déterminées par la raison, mais par ses passions.
Donc :
a. là encore, Socrate va refuser de recourir aux procédés habituels de l'éloquence judiciaire ;
b. là encore, Socrate refuse donc de faire « ce qu'il est supposé faire » dans un tribunal : à savoir mobiliser tous les stratagèmes possibles pour sauver sa peau ;
c. là encore, ce refus semble ironique (« puisque je vous respecte.... je ne ferai pas ce que vous attendez de moi, et que l'on fait habituellement dans ces tribunaux »)
d. là encore, cette ironie provient seulement du fait que Socrate dit exactement ce qu'il pense (il est effectivement indigne d'un juge, selon Socrate, de laisser ses émotions influencer son jugement), et qu'il décrit effectivement la situation (il est parfaitement normal, pour un accusé, de tenter d'apitoyer ses juges en faisant défiler toute sa famille).
Même constat en ce qui concerne l'extrait 3. Il faut se rappeler ici que Socrate a déjà été reconnu coupable par la majorité des juges, que l'accusation a demandé la peine de mort, et que les juges devront obligatoirement choisir entre cette peine et celle que proposera Socrate. De sorte que Socrate doit évidemment proposer une peine acceptable (par un jury qui vient de le déclarer coupable) pour sauver sa vie.
Or la « peine » que va proposer Socrate... c'est d'être nourri au Prytanée. C'est-à-dire : d'être désormais entretenu aux frais de la Cité ; une récompense que l'on réservait à des citoyens auxquels la Cité était particulièrement redevable, selon un principe assez proche de notre « Légion d'Honneur ».
Demander une récompense comme châtiment, n'est-ce pas le comble de l'ironie ? Et pourtant : cette proposition est parfaitement logique ; elle exprime réellement ce que pense Socrate, et il est en fait absurde de supposer qu'il pourrait réclamer autre chose. En effet, puisqu'il considère qu'il est innocent et que, plus encore, il a mené une vie de citoyen exemplaire, il serait totalement absurde de sa part de réclamer une « peine » ! Comment quelqu'un qui ne prétend servir que la vérité et la justice proposerait-il à ses juges, alors qu'il pense sincèrement n'avoir rien commis de répréhensible, de l'enfermer ou de le bannir ? Celui qui ne cherche que la justice ne peut évidemment pas réclamer un châtiment à l'encontre de quelqu'un qu'il considère comme innocent ; même s'il s'agit de lui-même.
Là encore, ce qui rend donc le propos de Socrate « ironique », c'est tout simplement l'absurdité de ce qu'il devrait se passer : ce qui serait « normal », c'est qu'un citoyen qui se considère comme innocent propose à ses concitoyens de le punir. Pour sauver sa vie, Socrate devrait se condamner à la prison ou au bannissement, en châtiment... d'une vie exemplaire.
Suite à ces trois extraits, on peut comprendre les raisons pour lesquelles le procès de Socrate est devenu un événement symbolique, qui parcourt l'ensemble de l'histoire de la pensée occidentale. Elément-clé dans l’œuvre du « père des philosophes » (Platon), le procès de Socrate est encore discuté 25 siècles plus tard... et pas seulement dans les cours de HLP. Pour ne prendre qu'un exemple, il est mobilisé par Jacques Vergès, cette grande (et sulfureuse) figure du barreau français du XX° siècle, pour étayer cette stratégie de défense particulière à laquelle il a donné le nom de « défense de rupture » (stratégie qui repose sur le fait que l'accusé refuse catégoriquement de « jouer le jeu » du procès, et donc de dire et faire ce qu'il faudrait qu'il dise et fasse pour obtenir la clémence des juges).
Au fil de l'histoire, le procès de Socrate est devenu le symbole :
a. de la mise à mort de la philosophie par la sophistique, de la sagesse par l'éloquence
b. de la mise à mort du sage par la majorité
ces deux points aboutissant logiquement à faire du procès de Socrate le symbole
c. de la corruption de la démocratie par les démagogues, manipulateurs de l'opinion
C) Cicéron, ou la grande synthèse
Pour toute cette séquence, nous prendrons appui sur un recueil de textes de Cicéron que vous pouvez retrouver ici![]() Ciceron, Traité de l'orateur (extraits) (30.47 Ko).
Ciceron, Traité de l'orateur (extraits) (30.47 Ko).
1) Qui est Cicéron ?
Cicéron est avant tout un citoyen romain, dont la vie coïncide avec le déclin et la chute de la République romaine. A tel point d'ailleurs que l'on s'accorde généralement à retenir la date de sa mort (en -43 av J-C) comme date symbolisant la fin de la République ; et ce, même si l'Empire (ou le principat) n'est officiellement établi par Auguste qu'en -27.
Ceci nous conduit à un deuxième élément de réponse : Cicéron fut un homme politique romain, qui occupa la fonction la plus haute pour un magistrat romain dans la République (il fut consul), participa activement à la vie politique de son époque (au Sénat et dans les tribunaux), fut un fervent défenseur de la république, et mourut de cet engagement : s'il est assassiné en -43, c'est parce qu'il s'est attiré la haine mortelle de Marc Antoine en s'opposant violemment à lui (notamment dans les textes qui sont restés sous le nom de « Philippiques »).
Mais Cicéron est également un penseur, un philosophe romain, auquel on doit l'une des œuvres les plus prestigieuses du corpus de la philosophie romaine ; ses réflexions portent avant tout sur la politique, mais aussi sur la morale, l'art ou même la logique. Il figure ainsi dans la liste des auteurs du programme officiel de philosophie en classe terminale.
Enfin, Cicéron est également un maître d'éloquence, ou plus encore un maître de l'éloquence : il en est à la fois le plus grand théoricien dans l'Antiquité romaine (son traite De l'orateur a servi de bible à des générations d'écoliers et d'étudiants pour se former à l'art oratoire), et l'un des plus illustres praticiens : les discours et plaidoyers de Cicéron, qu'il aient effectivement été prononcés ou simplement publiés, dans les tribunaux ou au Sénat, font partie des monuments sacrés de la Rhétorique.
Alors, qui fut Cicéron, ou que fut-il ? Un homme politique ? Un philosophe ? Un maître d'éloquence ?
Il ne fut précisément rien de tout cela, parce qu'il fut tout cela à la fois ; plus encore, il voulut être (et fut effectivement) ce personnage qui réunit en lui, comme elles doivent l'être, ces trois figures essentielles ; c'est-à-dire : un ORATEUR.

Cicéron accusant Catilina, fresque réalisée entre 1882 et 1888 par Cesare Maccari
L'orateur, c'est la figure-clé de la pensée, de l'action et de la vie entière de Cicéron ; l'orateur, c'est le philosophe-qui-agit-dans-la-Cité-par-le-discours-éloquent.
Nous essayons donc de déterminer ce qui fait l'unité de ces trois éléments dans la pensée de Cicéron.
2) Pourquoi sagesse et éloquence sont indissociables.
a. le fond et la forme
Dans notre premier extrait, nous trouvons l'idée selon laquelle il est impossible de séparer réellement le « fond » et la « forme » du discours. Dans la mesure où un discours, par définition, est « ce qui dit quelque chose d'une certaine façon », il est parfaitement impossible de séparer ce qui est dit (l'objet du discours), et la façon de le dire. Par conséquent, traiter séparément du fond et de la forme, dissocier la réflexion sur les idées et les techniques oratoires, séparer l'art de penser et l'art de dire, c'est prendre un mauvais chemin.
Le deuxième extrait nous indique que ce « mauvais chemin » n'a pas été emprunté par les Anciens. Cicéron souligne que, chez Homère, si Pélée a confié Achille à Phénix, c'est pour lui enseigner à la fois l'art de bien vivre (de penser et d'agir de façon juste) et l'art de bien parler. De même, de grandes figures comme Périclès réunissent en elles la pensée et l'expression de la pensée, la sagesse et l'éloquence, la « philosophie » et la « rhétorique » ; plus encore, c'est justement l'éloquence qui permet d'articuler les deux moments de la sagesse (pensée juste, action juste) : car c'est par ses discours que l'orateur passe de la pensée à l'action, qu'il tente d'agir sur la réalité pour la rendre conforme à la vérité et à la justice. Le discours est l'arme dont dispose le penseur pour agir dans la Cité.
Comment se fait-il alors que la sagesse et l'éloquence, la pensée et le discours, la réflexion et la parole, la philosophie et la rhétorique... se soient séparés ? Et qui est responsable de cette séparation ?
23.01. 4) Philosophie et sophistique : Socrate accusé... ou accusateur ?
En prenant appui sur l'extrait n° 1, nous montrons en quoi Socrate opère un certain nombre de renversements.
Socrate commence en effet par montrer que le procès oppose en réalité deux types de discours : le discours de ses accusateurs, qui mobilise toutes les ressources de la rhétorique pour parvenir à persuader les juges. A ce discours éloquent s'oppose celui de Socrate : simple, dépouillé, sans art... mais vrai. De sorte que le procès devient le lieu de confrontation de types d'usage du langage : l'usage sophistique, qui mobilise toutes les ressources de l'art oratoire pour obtenir gain de cause en persuadant l'auditoire, et l'usage philosophique, qui n'utilise le langage que com:e un instrument mis au service de la recherche de la vérité. Le procès de Socrate devient ainsi le lieu où s'affrontent deux conceptions du discours : discours sophistique contre discours philosophique.
Mais ce renversement en entraîne un autre : puisque les juges vont devoir choisir entre le discours rhétorique-persuasif et le discours vrai, à qui vont-ils accorder leurs suffrages ? A celui qui parle bien, ou à celui qui dit la vérité ? Au discours éloquent, ou au discours vérace ? Vont-ils se laisser persuader par la rhétorique, ou convaincre par le raisonnement ? On voit ici que, en jugeant Socrate, les juges vont en fait... se juger eux-mêmes : vont-ils se laisser persuader par des discours mensongers mais éloquents, ou vont-ils au contraire résister aux séductions de la rhétorique pour ne prêter attention qu'à la vérité de ce qui est dit ?
Et à son tour, ce renversement en entraîne un troisième : puisque le déroulement d'un procès est une illustration de ce en quoi consiste la démocratie (les citoyens rassemblés doivent prendre une décision suite à un débat), la décision des juges sera une illustration de ce qu'il se passe dans une démocratie : lorsque le peuple est rassemblé, est-ce au meilleur orateur, à celui qui parle de la manière la plus éloquente, à celui qui maîtrise toutes les ficelles de la rhétorique qu'il accorde son suffrage ? Ou est-ce à celui qui, refusant de recourir à ces procédés oratoires, se borne à vouloir les éclairer en disant les choses telles qu'elles sont ? Qui « gagne » dans une démocratie ? Qui emporte la majorité ? Le discours éloquent ou le discours vrai ? Le sophiste ou le philosophe ? De la réponse à cette question dépend évidemment la valeur que l'on peut reconnaître à la démocratie : si la majorité se prononce en faveur du discours vrai, les décisions prises seront conformes à la justice, et la démocratie est le meilleur des systèmes. Mais si en revanche la majorité se laisse séduire par l'éloquence de l'orateur le plus habile, alors la démocratie est en réalité une « démago-cratie » : un système dans lequel celui qui détient le pouvoir est moins le peuple que celui qui sait le séduire et le manipuler par ses beaux discours : le démagogue.
L'extrait n° 1 opère donc un triple renversement :
a. L'opposition entre Socrate et ses accusateurs devient l'opposition entre sophistes et philosophes, entre discours rhétorique-mais-persuasif et discours sobre-mais-vrai.
b. Le jugement que les juges vont porter sur Socrate va être un jugement qu'ils porteront sur eux-mêmes : sont-ils des gens qu'il faut persuader (par l'éloquence) ou des hommes que l'on doit convaincre (par des faits et des arguments) ?
c) Le procès de Socrate devient ainsi le procès de la démocratie : dans une démocratie, est-ce la vérité qui triomphe, ou la démagogie ?
Nous posons alors une question : cet argumentaire de Socrate n'est-il pas lui-même très... rhétorique ? Dire que l'on ne fera pas de rhétorique, et qu'on s'abstiendra de toute éloquence pour ne dire que la vérité, n'est-ce pas encore... de la rhétorique ?
Nous apportons deux réponses. La première est qu'il est très difficile de considérer que Socrate cherche à plaider habilement sa cause pour sauver sa vie. Il pourrait sembler que, en affirmant à ses juges qu'ils devront choisir entre son discours (sans éloquence mais vrai) et celui de ses accusateurs (éloquent mais mensonger), Socrate les « pousse » à lui accorder leur suffrage... mais toute la suite du texte dément cette hypothèse. Socrate n'a manifestement pas cherché, lors de son procès, à « sauver sa peau » : en témoigne notamment la « peine » qu'il proposera dans l'extrait 3. Si Socrate avait voulu « persuader » ses juges de le laisser en vie, il s'y serait sans doute pris autrement.
C'est d'ailleurs ce qu'indique déjà la suite de l'extrait 1, qui apporte un second élément de réponse à notre question. Socrate prie ses juges de bien vouloir l'excuser : il ne sait pas parler le langage que l'on est supposé tenir dans un tribunal ; lui ne sait que parler le langage... de la vérité. Il sait bien que normalement, dans un tribunal, on n'est pas là pour dire les choses telles qu'elles sont, sans rhétorique : on est censé recourir à tous les procédés oratoires pour persuader l'auditoire conformément à ses intérêts. Mille pardons, dit donc Socrate, si je ne sais pas faire cela : veuillez m'excuser de ne dire que la vérité dans un langage simple.
Il est difficile de ne pas repérer dans ces propos un élément traditionnel de la rhétorique : l'ironie. Il y aurait donc au moins un élément rhétorique dans le discours de Socrate : sa dimension ironique. Et, de fait, on parle bien de « l'ironie » socratique.
Et pourtant... en quoi consiste précisément ici l'ironie ? En règle générale, un propos est « ironique » parce que le locuteur dit quelque chose qu'il ne pense manifestement pas (« une merveille, cette copie... ») ou parce qu'il dit quelque chose qui est manifestement en désaccord avec la situation (« c'est le moment de dormir... »). Or il n'y a rien de tel dans les propos de Socrate. Non seulement Socrate dit toujours ce qu'il pense, mais plus encore ce qu'il dit correspond effectivement à la situation :
a. il est parfaitement exact que ce qu'est supposé faire un accusé dans un tribunal, c'est mobiliser toutes les ressources de la rhétorique pour défendre ses intérêts ;
b. il est parfaitement exact que, dans un tribunal, on n'est pas supposé entendre, dans la bouche de l'accusation ou de la défense, des paroles sobres et soucieuses avant tout de vérité. Aujourd'hui encore, il suffit de voir comment sont habillés les avocats pour comprendre que, ce qui leur est demandé, ce n'est certainement pas de chercher la vérité, mais de faire preuve d'éloquence pour plaider une cause. Tout procès d'Assises repose sur la confrontation de deux discours dont le but est de persuader le jury, par tous les moyens possibles (recours aux émotions, gestuelle théâtrale (« effets de manche »), dramatisation...)
Si donc le propos de Socrate est « ironique », c'est justement... parce qu'il dit exactement ce qu'il pense, et qu'il décrit effectivement la situation. De sorte que, si le propos de Socrate est en désaccord flagrant avec la situation... c'est parce que la situation est en désaccord flagrant avec la recherche de la vérité ou de la justice.
16.01 : (Fin de l'étude du texte de Gorgias).
Quel est alors le but poursuivi par Gorgias dans son texte ? Il faut ici distinguer les deux réponses donées par Gorgias dans son texte, et leur accorder des valeurs très différentes. La première consiste à dire que Gorgias, justement, a ici mis son art au service de la justice, en lavant Hélène d'une accusation injuste. Cette réponse pose un double problème : d'une part, si l'on suit le texte, on doit admettre que Gorgias aurait pu démontrer la thèse contraire.... sans que nous piuissions déterminer laquelle est la thèse juste ; dans cgacun des cas, la position qui nous aurait paru juste est celle qu'aurait défendue Gorgias. Par ailleurs, on peut se demander ce que peut être l'intérêt d'une telle "défense d'Hélène"... 7 siècles après les faits, alors que les jugements des Athéniens peuvent difficilement interférer avec le sort de la principale intéresée... Il faut donc se tourner vers la seconde raison donnée par le texte. Si Gorgias a écroit son texte, c'est pour son propre divertissement : l'éloquence apparaît donc ici comme un jeu, par lequel l'auteur jouit de son propre savoir-faire, de son habileté, de sa virtuosité. Ce qui nous conduit à un troisième motif, probablement plus réel encore que le second : ce texte est une "démonstration" ; non pas au sens d'une démonstration mathématiqie, mais au sens que prend ce terme lors d'une "démonstration" de judo (par exemple). Il s'agit pour un praticien de manifester son habileté, de montrer sa virtuosité, en manifestant la puissance que son art lui confère. En ce sens, le texte de Gorgias est bien une vitrine, par laquelle un maître fait une "démonstration" de son art, c'est-à-dire aussi bien de la puissance de cet art que de la maîtrise qu'il en a.
B) La critique philosophique de la sophistique : Socrate et Platon
1) Qu'est-ce que la philosophie ?
Nous nous tournons maintenant verts le courant qui va s'opposer radicalement au mouvement sophistique : le courant... philosophique. Pour comprendre l'opposition entre philosophie et sophistique, il est nécessaire de repartir de ce qui constitue le projet initial, fondateur de ce nouveau domaine que l'on va appeler « philosophie ». On considère souvent que le « premier philosophe » de l'histoire occidentale est SOCRATE, ce citoyen athénien du V° siècle av. J-C. De fait, si l'on considère la liste des philosophes du programme de terminale, on voit que le premier philosophe dans l'ordre historique est Platon : or Platon fut le disciple de Socrate. Et si Socrate n'est pas lui-même le premier philosophe de la liste, c'est tout simplement parce qu'il s'agit d'une liste d'auteurs, et que Socrate lui-même n'a rien écrit.

Socrate
Comprendre ce qu'est la « philosophie », c'est donc comprendre en quoi consiste la rupture opérée par Socrate : qu'est-ce qui apparaît avec lui, quelle est la démarche qu'il a introduite dans l'histoire ? Le principe fondamental de la démarche socratique est que l'homme doit fonder ses jugements et son action sur des justifications rationnelles. En d'autres termes, pour déterminer ce qui est vrai, ce qui est juste (ce qu'il doit penser, ce qu'il doit faire), l'homme doit faire usage de la faculté inscrite dans sa nature, celle qui le différencie de tous les animaux et le caractérise en tant qu'être humain : la raison. Ce qui définit donc la démarche « philosophique », c'est la recherche de la sagesse (sophia) par l'usage de la raison.
C'est cette démarche que l'on retrouve encore, plus de 20 siècles plus tard, dans l'Humanisme de la Renaissance, dans le rationalisme du XVII° siècle, ou encore dans la philosophie des Lumières : le principe fondamental de toute la pensée des Lumières, c'est que l'homme, pour déterminer ce qui est vrai et ce qui est juste, pour savoir ce qu'il doit penser et ce qu'il doit faire, pour fonder ses jugements et ses actes, doit suivre ce que lui dictent ses facultés naturelles, c'est-à-dire avant tout : sa raison.
2) Socrate : le plus sage des hommes ?
Cette démarche, Socrate va l'incarner, d'une manière un peu paradoxale. Car si tout « savoir » véritable implique que l'on soit capable de justifier rationnellement ce que l'on sait, la recherche du savoir commence nécessairement par une mise en doute : suis-je capable de justifier, par des arguments rationnels, ce que je crois savoir ? Et, pour commencer, suis-je capable de dire précisément de quoi il s'agit ? Il va de soi que je peux pas prétendre « savoir » que A est B (par exemple : que la vertu peut s'enseigner) si je ne suis même pas capable de dire précisément ce que j'entends par « vertu » ; toute connaissance rationnelle débute nécessairement par une définition claire de ce que l'on cherche, de ce que l'on examine.
C'est surtout cette mise en doute qui s'incarne dans la vie de Socrate. Un proche de Socrate (Chéréphon) qui avait consulté l'oracle de Delphes, s'était entendu répondre par l'oracle que « nul n'était plus sage que Socrate ». Informé de la sentence de l'oracle, Socrate s'était montré perplexe : comment diable pouvait-il être désigné par l'oracle comme le plus sage des hommes... alors qu'il n'était savant dans aucun domaine ? Ayant entrepris de « vérifier » la parole de l'oracle, Socrate était allé trouver des Athéniens supposés détenir un grand savoir (savoir leur conférant une autorité) ; or ces entretiens révèlent que leur prétendu savoir... n'est en fait qu'une apparence. Ce que montrent les dialogues menés par Socrate, tes que Platon les relate, c'est que ces prétendus « experts » sont en fait incapables de justifier leurs jugements par de véritables arguments et que, pire encore, ils ne sont même pas capables de définir ce qui constitue l'objet de leur savoir. L'homme politique a bien du mal à déterminer ce sur quoi porte son « savoir », et se montre incapable de définir en quoi consiste ce sur quoi il se prétend pourtant savant : la justice. De même le chef d'armée se montrera incapable de définir le courage, le sophiste s'empêtrera dans des contradictions sans fin lorsqu'il cherche à définir la rhétorique, etc.
Si l'on ajoute à cela le fait que Socrate menait principalement ses entretiens sur l'agora, en public, on comprend alors le caractère assez subversif de sa démarche ; le propre du dialogue socratique, dans sa forme initiale, c'est de montrer que les détenteurs d'une autorité (politique ou autre) fondée sur un savoir... sont en fait loin d'être aussi savants qu'ils ne le croient (et que donc leur autorité est bien moins fondée qu'on ne le suppose). Et, en ce sens, l'oracle se trouve bel et bien vérifié. Si « nul n'est plus sage que Socrate », ce n'est pas parce que Socrate lui-même serait savant ; mais bien parce que ceux qui se croient savants (et que l'on considère comme tels)... sont en fait loin de l'être. De sorte qu'il se trouvent en fait être ignorants deux fois : non seulement ils ne savent pas, mais ils ne savent même pas qu'ils ne savent pas : ils croient savoir ce que, en réalité, ils ignorent. Socrate n'est certes pas savant : mais il ne croit pas non plus l'être ; il sait... qu'il ne sait pas.
3) Le procès de Socrate
Pour comprendre en quoi cette attitude s'oppose à la démarche des Sophistes, et en quoi elle aboutit à un rejet radical de la rhétorique, nous prenons appui sur un événement qui s'est effectivement produit au tournant du V°-IV° siècle av. J-C à Athènes : le procès de Socrate.
Dans les dialogues rédigés par Platon (dialogues qui sont généralement des récits d'entretiens que Socrate aurait eu avec différents interlocuteurs), trois sont consacrés à la fin de la vie de Socrate : le premier, auquel nous allons nous intéresser, relate les propos tenus par Socrate lors de son procès : c'est « L'apologie de Socrate ». Le second raconte un entretien que Socrate aurait eu après sa condamnation, alors qu'il se trouvait en prison, avec un dénommé Criton (qui donne son nom au dialogue). Le troisième est consacré à la mort de Socrate : c'est le « Phédon ».
)
"La mort de Socrate", par le peintre DAVID (1787)
Nous rappelons en quoi a consisté ce procès, quels étaient les accusateurs (l'un deux est un Sophiste), les chefs d'accusation (impiété et corruption de la jeunesse) et la peine encourue (la peine de mort). Nous rappelons également quelques modalités de ce type de procès : les accusateurs et l'accusé parlent en leur nom (il n'y a pas d'avocats), le jury est composé de 501 citoyens athéniens, et doit d'abord se prononcer sur le fait que l'accusé soit bel et bien coupable ; ce n'est qu'une fois la culpabilité reconnue que la seconde phase du procès commence, phase au cours de laquelle les accusateurs, puis l'accusé, doivent proposer une peine. Les juges devront alors choisir l'une des deux peines proposées.
09.01. Nous illustrons à présent le discours sophistique en prenant appui sur des extraits d'un texte de Gorgias, l'Eloge d'Hélène. Gorgias est l'un des pères du mouvement sophistique, et l'Eloge est l'une des principales oeuvres qui nous sont parvenues intégralement.
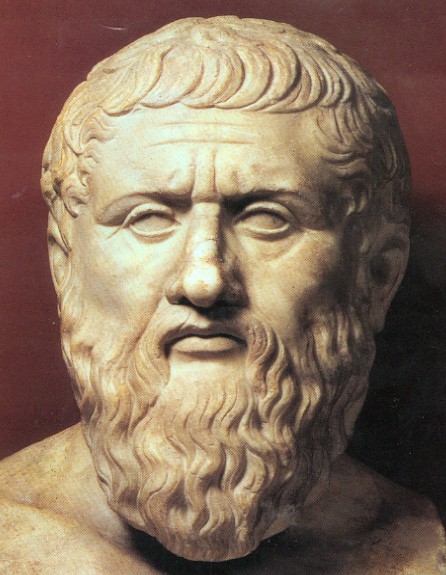
Gorgias
1. Nous commençons par souligner le fait que le texte se présente comme un plaidoyer à caractère judiciaire (c'est un discours de défense, une "apologie" d'Hélène, qui vise à répondre aux accusations dont elle fait l'objet). Nous retrouvons donc l'inscription du discours sophistique dans le débat judiciaire, où il s'agit moins d'établir un savoir que de défendre une cause, en cherchant à emporter l'adhésion du public. Par ailleurs, la défense porte sur une question qui ne peut pas faire l'objet d'un savoir certain (comme ce serait le cas si l'on demandait : Hélène a-t-elle quitté son mari Ménélas (roi de Sparte) pour suivre un membre d'une Cité rivale (Pâris)?) ; la question n'est pas en effet de savoir si Hélène a commis un acte, mais si elle peut être considérée comme responsable de cet acte. Le problème porte sur une question éminemment problématique de responsabilité individuelle, qui peut faire l'objet d'un débat.
[Nous soulignons au passage que ce débat traduit lui-même un changement dans la perspective judiciaire dans l'Antiquité : il ne s'agit plus seulement de corréler un acte et un châtiment (ex: Oedipe a tué son père et épousé sa mère, il doit donc être châtié), mais de questionner les motifs, les raisons qui ont poussé un individu à commettre cet acte, pour savoir si on peut le considérer lui-même comme "fautif", coupable, criminel. Ce glisssement se traduit déjà dans l'écart entre l'optique adoptée par Oedipe lui-même dans la pièce de Sophocle "Oedipe Roi", dans laquelle Oedipe ne remet aucunement en cause le fait que, puisqu'il a commis ces actes, il est criminel), et celle qu'il adopte dans "Oedipe à Colone" (où il fait remarquer que les souffrances qu'il endure sont (au moins en partie) injustifiées, puisque "ce n'est pas sa faute" s'il a commis ses actes : il ignorait (et il n'est en rien responsable de cette ignorance) que son adversaire était son père, il ignorait que celle qu'il épousait était sa mère.]
2. Nous montrons ensuite que le texte repose sur une structure logique très caractéristique de l'argumentaire sophistique : le défenseur commence par exposer l'ensemble des possibilités (pour quelles raisons Hélène a-t-elle pu suivre Pâris), avant de démontrer, pour chacune de ces possibilités, qu'elle ne peut pas être tenue pour responsable. L'avantage de cette démarche est qu'elle "coupe l'herbe sous le pied" de l'adversaire, en exposant par avance ce que sont les différentes possibilités qui peuvent être envisagées : si aucune de ces possibilités ne premet de maintenir la responsabilité d'Hélène, il est impossible de considérer Hélène comme responsable.
3. Les quatre possibilités retenues par Gorgias sont les suivantes : soit Hélène est soumise à un décret des dieux, à la fatalité ; soit elle a été ravie par la force ; soit elle a été persuadée par un discours ; soit elle a cédé à une passion amoureuse. Le but de Gorgias est donc de montrer que, quelle que soit la possibilité retenue, la responsabilité d'Hélène n'est pas engagée.
En ce qui concerne le premier point, l'argumentaire est simple : le plus faible ne peut (par définition) résister au plus fort, or les dieux sont incomparablement plus forts que les hommes, donc Hélène ne pouvait pas résister à la volonté des dieux. Dans cette optique, ce n'est pas Hélène qui est responsable de sa fuite, mais bien les dieux. Cet argument est analogue à celui que l'on trouve en ce qui concerne la seconde possibilité : si Hélène a été ravie par contrainte, par une force à laquelle elle ne pouvait pas résister, elle n'est pas responsable de sa fuite.
4. La possibilité la plus intéressante (c'est elle qui donne en réalité sa raison d'être à l'Eloge) est la suivante : en quel sens peut-on dire que, si Hélène a été persuadée par un discours, elle n'est pas responsable ? Ce point exige de montrer que le discours (de même que la volonté des dieux ou la force physique) exerce sur l'âme une contrainte à laquelle il est impossible de résister. En ce sens, plaider l'irresponsabilité d'Hélène, c'est affirmer la toute puissance du discours.
En quoi peut-on alors considérer le discours comme "tout puissant" ? Le premier point relevé par Gorgias est que le discours agit sur les émotions de ceux qui l'écoutent : le discours fait naître la joie ou la peine, la crainte ou la pitié, etc. La puissance du discours repose donc avant tout, non sur sa capacité à contraindre la pensée, mais à façonner les émotions. Gorgias prend alors appui sur le cas du discours poétique pour montrer cette puissance émotive, émotionnelle du discours, qui peut à son gré faire naître dans l'âme les émotions qu'il veut. De sorte que l'âme de l'auditeur apparaît ici comme doublement passive : (a) l'âme est passive face aux émotions : elle les ressent, elle ne les décide pas. Le terme même de "passion" indique ce caractère passif de l'âme face aux sentiments qui naissent en elle et peuvent la submerger (b) ces émotions sont elles-mêmes produites dans l'âme par un sujet extérieur, par l'orateur, dont le discours produit ces émotions. Si donc une personne agit sous le coup de l'émotion suscitée en elle par le discours, le responsable de ses actes, c'est bien le discours (ou l'orateur).
Mais cependant, on doit reconnaître que l'homme, en tant qu'homme, n'est pas seulement déterminé par ses émotions : ses actes sont aussi (ou du moins ils doivent l'être) déterminés par ce qu'il pense. Encore faut-il préciser en quoi consiste cette "pensée", et distinguer ce qui est de l'ordre d'un savoir (fondé sur des preuves, permettant d'atteindre une certitude), et ce qui n'est que de l'ordre de la croyance, de "l'opinion". Et Gorgias précise aussitôt que le discours n'est puissant que sur l'opinion, et non sur le savoir. Lorsque l'homme dispose de preuves permettant de fonder une certitude, la puissance du discours (même éloquent) est faible. (Nous illustrons ce point en indiquant que le discours le plus éloquent est faible s'il s'agit de faire penser à un mathématicien que le théorème de Pythagore est faux, alors qu'il en possède la démonstration). En revanche, lorsque l'homme ne dispose pas d'un savoir certain, s'il est obligé de s'en remettre à des hypothèses plus ou moins plausibles, vraisemblables, alors l'éloquence de celui qui veut le persuader devient décisive.
Or (et c'est le pont-clé du texte), ce recours à l'opinion est en réalité nécessaire pour l'homme, dans presque tous les domaines de la vie ! Si bien que ce qui s'apparentait à une concession (le discours éloquent n'est puissant que lorsque nous fondons nos jugements et nos actions sur des opinions....) se trouve en fait être une affirmation de la puissance générale du discours. Nous touchons ici à une caractéristique-clé du mouvement sophistique, que l'on pourrait appeler son "scepticisme". Si l'on exclut (pour simplifier) quelques domaines comme les mathématiques, où il peut sembler que l'on puisse atteindre des vérités par le seul usage de la raison (calcul, démonstration), Gorgias souligne dans son texte que dès qu'il s'agit de la réalité factuelle, pratique, de la vie concrète... il est impossible d'atteindre une certitude absolue, à l'aide du seul raisonnement. S'agit-il de la connaissance du passé ? L'homme est obligé de prendre appui sur des témoignages (qui peuvent être inexacts, voire volontairement faussés), sur sa mémoire (qui est faillible), etc. S'agit-il de la connaissance de l'avenir ? L'homme en est évidemment réduit à des conjectures, des hypothèses plus ou moins probables, mais jamais sa raison ne peut lui dire avec certitude ce que l'avenir "nous réserve". S'agit-il enfin du présent ? C'est d'abord par les sens que nous percevons la réalité : nous ne conaissons la réalité que telle qu'elle nous apparaît, et non temle qu'elle est, par l'intermédiaire de nos sensations : nous voyons, entendons, sentons, touchons... or rien ne garantit que les choses soient telles qu'elles nous apparaissent. Pour nous en tenir à une idée simple : le témoignage de nos sens est souvent trompeur ; si les ciseaux nous paraissent plus froids que la gomme, ce n'est pas parce qu'ils sont d'une température différente, mais bien parce que les premiers, étant faits d'un métal conducteur de chaleur, nous semblent froids, alors que la seconde (qui nous renvoie notre chaleur) nous semble chaude.
Pour Gorgias, nous ne saisisons jamais de façon certaine la réalité, par la raison : nous nous mouvons dans un monde d'apparences, faits de souvenirs, d'hypothèses, de sensations, sur lesquels nous pouvons seulement fonder des opinions concernant le réel. Par conséquent, dire que le discours peut façonner nos opinions, c'est tout simplement dire que le discours façonne ce sur quoi reposent aussi bien notre connaissance du monde que les motifs de nos actions.
L'art du discours apparaît alors bien comme ce qu'il est : un outil puissant, capable de façonner comme il l'entend (c'est-à-dire : tel que l'entend l'orateur éloquent) les pensées et les actions des hommes. Et l'on voit alors ce qui fonde l'ambivalence de l'art du discours : si, entre les mains d'un sage, on peut considérer que l'éloquence permet de "faire croire" au peuple... ce qui est vrai, et à le faire agir... de façon juste, en revanche aux mains d'un individu mauvais il devient une arme au service de l'erreur et de l'injustice.
Cette ambivalence n'est pas du tout niée par Gorgias dans son texte : l'éloquence est une arme et, comme toute arme, sa valeur dépend de l'usage qui en est fait. Tout au plus peut-on dire que, si l'éloquence est mise au service de l'erreur et de l'injustice, ce n'est pas la faute du maître de rhétorique, du sophiste : de même que ce n'est pas la faute du professeur de biologie si des disciples utilisent leurs connaissances pour construires des armes bactériologiques...
19.12. 3) Nous interrogeons à présent les raisons pour lesquelles le courant sophistique est apparu à Athènes, au V° siècle av. J.-C. Nous mettons en lumière 3 dynamiques :
(a) un progrès du "rationalisme" : on cherche ce plus en plus à trouver des explications rationnelles à des phénomènes auxquelles étaient traditionnellement accordées des explications religieuses ou magiques. Nous l'illustrons avec le cas des phénomènes météorologiques (orages), et par l'anecdote du bélier unicorne (confrontation de l'interprétation comme "présage" par le devin Lampon, et de l'explication physiologique par Anaxagore).
→ Nous montrons alors que cette orientation tend à privilégier le rôle du discours argumentatif, puisqu'à la "parole d'autorité", indiscutable et qui n'a pas à être validée par une procédure de justification rationnelle, se substitue la rivalité des explications, dont chacune doit démontrer sa supériorité sur les autres. Dans le cadre d'une discussion rationnelle, la meilleur explication n'est pas celle qui est affirmée par le détenteur d'une autorité, mais celle qui apparaît la plus convaincante suite à un débat.
(b) un recentrage sur l'homme. La pensée ne délaisse pas les dieux, mais elle tend à substituer à une interrogation portant sur la nature et l'action des dieux (à laquelle répondent les récits « cosmogoniques ») un questionnement portant sur l'homme. Qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce qui le distingue des animaux ? Dans quel type de société doit-il vivre ? Que doit-il faire ? Quel est le critère de la parole vraie, de l'action juste ? Nous illustrons ce glissement dans le domaine de la tragédie : de la parole qui témoigne de la volonté des dieux dans Les Perses d'Eschyle, on passe aux débats (qui peuvent être envahissants) portants sur les motifs, les déterminations humaines des personnages d'Euripide. Pourquoi Hécube a-t-elle fait ce qu'elle a fait ? Quels étaient les motifs explicites ? Quelles étaient les motivations cachées ? A-t-elle fait le bon choix ?
→ On voit que, là encore, cette dynamique tend à nous reconduire à l'importance de la parole et du débat. D'une part, parce que le langage est (nous l'avons vu) l'essence de l'homme, ce sur qui repose son humanité et son humanisation ; et d'autre part parce que c'est encore grâce au langage qu'il va être possible de répondre aux questionnements portant sur la vérité, la justice, les motivations, les justifications, etc. C'est par un discours que l'on montre ce qui peut être considéré comme vrai, ou non (peut-on se fier à ce que nous disent nos sens ? Seul un raisonnement pourra nous le dire... ce qui est déjà un élément de réponse). C'est par un discours que l'on montre qu'une décision était légitime, etc.
On souligne qu'il s'agit moins ici de produire des démonstrations « mathématiques » que de discerner ce qui semble le plus approprié, le plus plausible, le plus justifiable par un discours persuasif. Là encore, si dans les Perses d'Eschyle trois phrases suffisent à indiquer la faute de Xerxès et à justifier son châtiment par les dieux (châtiment qu'il n'y a pas à discuter, et qu'il serait vain de vouloir contrer), dans les pièces d'Euripide la moindre décision est à l'origine d'un débat contradictoire entre le « pour » et le « contre », au point d'ailleurs que l'on se demande parfois si la décision n'est pas seulement le prétexte à l'ouverture du débat (ainsi de la discussion qu'entame Hécube, censée être plongée dans le désespoir le plus profond après la chute de Troie, concernant la part de l'inné et de l'acquis dans le caractères des hommes...)
(c) une valorisation de la technique. A partir du mythe de Prométhée tel qu'il nous est raconté par Platon (dans le dialogue Protagoras), nous montrons en quoi la pensée grecque s'oriente vers une valorisation de la technique comme activité propre de l'homme. La technique est ce par quoi l'homme transforme la nature et affirme sa puissance sur elle ; elle est ce que les hommes ont pris aux dieux (et qui doit être contrôlé, régulé par ce don des dieux qu'est le sens politique). Mais si la technique est ce qui permet à l'homme de manipuler la matière, de la plier à sa volonté, de la mettre à son service, se pose dès lors la question d'une technique des hommes. Y a-t-il une « technique » permettant de manipuler les hommes, de les plier à notre volonté (autrement que par la force) ? Y aurait-il un art permettant de se rendre « comme maître et possesseur »... de la foule, ou de la majorité ?
→ Là encore, le rôle du langage et du discours apparaissent : car l'art de mener les hommes là où on veut qu'ils aillent, l'art de leur faire croire ce que l'on veut leur faire penser, l'art de leur faire commettre avec enthousiasme ce que l'on veut qu'ils fassent... c'est avant tout l'art de la parole. Si l'homme est susceptible d'être assujetti par une « technique », c'est bien par une technique dont le discours est l'objet.
4) On comprend alors pourquoi le mouvement sophistique trouve son épanouissement à Athènes au V° siècle. Si Athènes est le centre du pouvoir dans la Grèce du V° siècle, si elle est une terre d'accueil pour les intellectuels de toute origine, elle est surtout une démocratie. Elle est donc une Cité dans laquelle ce sont les citoyens qui détiennent le pouvoir. Mais elle est par là même une Cité où celui qui détient le pouvoir de façonner l'opinion de la majorité dispose lui-même du pouvoir... et l'on comprend alors l'enjeu que représente la rhétorique pour l'aristocratie athénienne. Si l'opinion de la majorité est « façonnable » par le discours, et s'il existe un art du discours en tant qu'art de persuader, alors celui qui dispose de cet art est celui qui dispose du pouvoir dans une démocratie.
Nous soulignons l'enjeu politique fondamental impliqué par cette dernière remarque :
(a) si la majorité des citoyens se laisse persuader par les arguments les plus rationnels, si c'est la valeur logique des arguments qui décide du jugement de la majorité, alors « l'art du discours » en tant qu'art de persuader n'est rien d'autre que l'art de convaincre en produisant des argumentaires logiques, lucides et rigoureux. Dans cette optique, la « rhétorique » se confond avec la philosophie, la science et la logique.
(b) Mais si la majorité des citoyens se laisse persuader par les discours les plus émouvants, les plus flatteurs, les plus beaux, les plus en accord avec les passions et les intérêts de la foule... alors l'art de persuader n'est plus du tout l'art de convaincre : il devient l'art de flatter, d'émouvoir, l'art de « faire croire », non pas ce qui est vrai, mais ce qui est conforme à la volonté de l'orateur, en jouant habilement des ressources de la parole. Et dès lors (et c'est un point très important), si cet art peut s'enseigner, et qu'il peut être payé chèrement... l'art du discours devient le moyen dont dispose l'aristocratie pour maintenir sa domination dans une démocratie !
12.12. Nous entamons la seconde partie du cours consacré au langage. Cette partie repose sur l'étude du débat philosophique fondamental au sein de l'Antiquité, qui va opposer les représentants de la sophistique (que nous étudierons d'abord), et de la philosophie ; nous chercherons dans un troisième temps à élucider la manière dont la doctrine de Cicéron cherche à surmonter cette opposition à travers la figure de l'orateur idéal.
II. Sophistique et philosophie dans l'Antiquité.
A) La naissance de la rhétorique
Nous commençons par quelques rappels concernant l'émergence de la rhétorique en Sicile (ce point a déjà été abordé dans le volet "littérature" en HLP). Cette émergence nous permet de poser les caractères fondamentaux de la rhétorique : un art dont la finalité est la persuasion, dans un contexte agonistique, dans lequel la certitude est inaccessible et où toutes les ressources du discours sont mobilisées. Nous examinons le rapport entre vérité et vraisemblance (dont nous illustrons l'opposition possible avec l'exemple de l'agression d'un individu fort par un individu faible, chacun ayant intérêt à masquer une partie de la vérité s'il veut être persuasif), ainsi que la place de l'argumentation logique. Le point important est que la validité logique du discours est elle-même un moyen au service de la persuasion (et non du savoir) : ce qui apparaît nettement dans l'affrontement (fameux) entre Tisias et Corax, chacun présentant un argumentaire logiquement inattaquable (et, en fait, analogue)... mais aboutissant à une conclusion opposée !
Nous illustrons l'art rhétorique sicilien avec un extrait de l'Hymne à Hermès (issu des Hymnes homériques), dans lequel Hermès sollicite les ressources de la rhétorique pour plaider sa cause face à Apollon.
B) La sophistique
1) Nous commençons par définir la notion de sophistique, à en préciser les acteurs et le contexte dans lequel ils se sont affirmés.
2) Nous précisons les caractéristiques fondamentales de l'enseignement sophistique (et ce qui en fait la nouveauté dans le contexte grec de l'Antiquité) : il s'agit d'un enseignement intellectuel pour la jeunesse, dispensé par des professionnels rémunérés, portant sur un domaine dont l'enjeu politique est décisif : apprendre "l'art de parler" en tant qu'art de persuader, c'est aussi apprendre à devenir un citoyen puissant dans un contexte démocratique.
28.11. Restitution des travaux effectués, et correction. Nous consacrons l'essentiel de la reprise à la question d'interprétation : comment repérer les différents éléments de réponse présents dans le texte ? Comment les regrouper selon deux axes principaux ? Comment construire le travail d'explication (justification, illustration) ? Nous montrons que le texte d'Isocrate s'articule à deux axes clairs : le premier se rapporte au domaine de la pensée et du savoir (le langage permet la réflexion, la discussion, la recherche, la découverte et la transmission du savoir) ; le second se rapporte au domaine politique : le langage pêrmet de différencier le juste de l'injuste, il permet la coexistence sociale, il permet la formulation des lois, le blâme des criminels et la louange des citoyens exemplaires. Après avoir traité chacun des axes, nous synthétisons le propos d'Isocrate en montrant que le langage est ce qui permet à l'homme de développer son humanité, en lui permettant d'accéder pleinement à son statut d'animal pensant, rationnel, et à son statut d'animal politique.
C'est cette articulation du langage et de la vérité et de la justice qui nous servira de mpoint d'appui pour la suite du cours, consacrée au débat entre sophistique et philosophique dans l'Antiquité.
21.11. La séquence est consacrée à un travail sur table (2 heures). Le travail se divise en quatre parties (la dernière est facultative). La première est un questionnaire à choix multiple, constitué à partir des questions déjà présentes sur le site (rubrique "quiz"). La seconde demande la définition de 5 termes-clé. La troisième est une partie argumentative : il s'agit de justifier et d'illustrer, à l'aide des arguments et des exemples étudiés en cours, 3 thèses imposées (sur quatre proposées). La quatrième consiste à questionner la légitimité du rapport posé par Isocrate entre langage, justice et vérité.
14.11. La séance est divisée en deux parties. Dans la première heure, nous traitons la question de réflexion liée au texte de Barthes pour montrer en quoi nous pouvons chercher à nous émanciper de cette "prison" que constitue le langage. Les différentes thèses soutenues sont exposées sous la forme d'un corrigé que vous pouvez ![]() trouver ici (34.04 Ko). La deuxième partie est consacrée à la réfaction sur table d'une question d'interprétation sur un texte d'Isocrate. Nous avons d'abord procédé à une première lecture du texte ensemble, en soulignant les éléments clé. La question d'interprétation est la suivante : en quel sens peut-on dire avec Isocrate que le langage est la faculté naturelle de l'homme qui "lui a apporté le plus de bien" ?
trouver ici (34.04 Ko). La deuxième partie est consacrée à la réfaction sur table d'une question d'interprétation sur un texte d'Isocrate. Nous avons d'abord procédé à une première lecture du texte ensemble, en soulignant les éléments clé. La question d'interprétation est la suivante : en quel sens peut-on dire avec Isocrate que le langage est la faculté naturelle de l'homme qui "lui a apporté le plus de bien" ?
Le sujet peut être ![]() téléchargé ici (22.69 Ko).
téléchargé ici (22.69 Ko).
07.11. Nous terminons l'applicaton de la méthodologie de la question de réflexion sur le texte de Ricoeur en soutenant deux autres thèses :
(1) le débat ne détruit pas le conflit, il ne le résout pas, ne le fait pas disparaître : il lui ouvre seulement un espace de négociation. Il faut prendre garde à ne pas confondre négociation et "consensus" : il n'y a aucune raison de penser que des individus dont les idées, les valeurs, les intérêts sont divergents seront nécessairement d'accord à la fin de la discussion. En subsituant la négociation argumentée au rapport de force physique, le débat ne met donc pas fin a conflit... qui reprendra donc sa forme initiale si la négociation échoue. Nous illustrons ce point à travers des formes récentes de "conflit social", qui oscillent entre "dialogue social" (entre "partenaires sociaux") et rapport de force.
(2) le dialogue peut lui-même devenir une forme de conflit, quand il devient polémique, controverse. Sans même basculer dans la "violence verbale", le débat peut devenir affrontement, "joute" oratoire au sein de laquelle des adversaires rivalisent, non pour se convaincre mutuellement, mais pour persader l'auditoire qui les écoute. Nous illustrons cette dimension "agonistique" à travers l'exemple du débat politique télévisé.
Ces différents argumentaires sont présentés sous la forme d'un corrigé de question de réflexion que vous pouvez ![]() télécharger ici (31.53 Ko). [Le document contient également le corrigé de la question de réflexion portant sur le texte de Ricoeur.]
télécharger ici (31.53 Ko). [Le document contient également le corrigé de la question de réflexion portant sur le texte de Ricoeur.]
Nous mobilisions à présent un autre support d'entraînement pour la question de réflexion. Le texte d'appui est tiré de la leçon inaugurale prononcée par Roland Barthes au Collège de France, que vous pouvez ![]() télécharger ici (24.21 Ko), accompagné de ses deux questions. Nous examinons d'abord les éléments (du texte et du cours) qui permettent de soutenir l'affirmation selon laquelle la langue est fasciste (question d'interprétation) : l'idée centrale est que la langue impose un schème de pensée à partir duquel nous interprétons le réel, schème dont nous ne pouvons sortir (puisque nous pensons en lui) et qui est toujours idéologiquement orienté. Le langage repose donc sur un double assujettissement : assujettissement de la réalité à une "grille" de lecture, assujettissement des individus à un schème interprétatif.
télécharger ici (24.21 Ko), accompagné de ses deux questions. Nous examinons d'abord les éléments (du texte et du cours) qui permettent de soutenir l'affirmation selon laquelle la langue est fasciste (question d'interprétation) : l'idée centrale est que la langue impose un schème de pensée à partir duquel nous interprétons le réel, schème dont nous ne pouvons sortir (puisque nous pensons en lui) et qui est toujours idéologiquement orienté. Le langage repose donc sur un double assujettissement : assujettissement de la réalité à une "grille" de lecture, assujettissement des individus à un schème interprétatif.
17.10. Nous prenons comme support de mise en oeuvre de la méthodologie le texte de Ricoeur (texte 5 du recueil), extrait de Langage politique et rhétorique.
Comme question d'interprétation, nous demandons "En quoi le débat est-il le fondement de la démocratie ?"
1. Le premier élément du texte que nous sélectionnons est celui qui est indiqué au début : la naissance des démocraties est liée à l'ouverture d'un espace public de discussion (avec ce qui lui est lié : la liberté d'expression et de presse). La démocratie apparaît donc indissociable de l'ouverture d'un espace de débat public.
--> justification. Nous voulons expliquer pourquoi la démocratie suppose l'ouverture d'un espace de débat public. Pourquoi ne peut-il pas y avoir de démocratie sans espace public de discussion ? Nous indiquons deux raisons (arguments)
[Attention : dans la mesure où il s'agit ici de mettre en lumière l'application de la méthode, je développe intentionnellement l'exposé ; dans une épreuve de type bac, une seule raison suffirait.]
a. Une démocratie repose sur le fait que le peuple (l'ensemble des citoyens) est souverain (dispose du pouvoir législatif). Or ceci n'a de sens que si chaque citoyen peut produire son propre jugement ; et nous avons montré (avec Kant) qu'il ne peut y avoir de liberté de pensée (de possibilité pour chacun de "penser par soi-même") sans liberté d'expression et de presse. Pour qu'un citoyen puisse produire son propre jugement, il doit avoir accès à des informations diversifiées, à des points de vue divergents, à des argumentaires différents, etc. Pour que le citoyen puisse assumer son rôle dans une démocratie, il est donc nécessaire qu'il accède à un espace public au sein duquel les idées sont exposées, justifiées, illustrées...
--> illustration. Pour illustrer le fait que les citoyens ne peuvent jouer leur rôle (de membres du souverain) en se prononçant sur les questions d'intérêt général, que s'ils disposent d'un espace de libre information / discussion, nous prenons l'exemple de la question de la commercialisation des OGM. C'est bien une question d'intérêt général, puisqu'elle concerne aussi bien la santé publique, que la sécurité alimentaire, que l'écologie, etc. Mais comment les citoyens pourraient-ils juger de cette question si la communauté scientifique n'était pas laissée libre d'exprimer et de publier les connaisances qui permettent de fonder un jugement ? L'importance de la vulgarisation des données scientifiques dans un espace public de discussion est ici primordiale.
b. Une démocratie rspose sur le fait que le peuple est souverain ; ce qui implique que chaque citoyen participe (de façon directe ou indirecte) à l'élaboration de la loi. Or ceci est impossible si l'on refuse au citoyen le droit de prendre la parole, de défendre son point de vue, etc. Le citoyen ne peut jouer son rôle au sein du peuple que si on lui laisse la possibilité de prendre part au débat public.
--> illustration : dans le cas de la loi sur le "mariage pour tous", il était nécessaire de laisser chacun s'exprimer pour que la décision finale puisse être considérée comme l'expression de la volonté "du peuple". Il n'y a de souveraineté du peuple que si chaque citoyen a été laissé libre de participer au débat public précédant le vote de la loi, si les différents points de vue ont pu s'exprimer, etc. Le débat public, c'est le moment de la délibération publique, ou chacun peut proposer ses arguments... et prendre connaissance de ceux des autres. Si un seul point de vue a été entendu, comment dire que la décision finale reflète le jugement... "du peuple" ?
2. le second élément que nous sélectionnons est celui qui est indiqué dans la seconde partie du texte : le débat public est ce qui permet de négocier les conflits entre les individus qui composent la société.
--> justification : dans une démocratie, la loi adoptée est celle qui a été validée par la majorité. Mais pourquoi les individus accepteraient-ils de se soumettre à une règle (avec laquelle il ne sont pas nécessairement d'accord) pour la seule raison qu'elle a été adoptée par une majorité de citoyens ? Nous montrons que, pour qu'un individu puisse considérer le vote majoritaire comme légitime (et donc justifier sa propre obéissance à la loi), il faut impérativement que le vote ait été précédé d'un débat public au sein duquel chaque avis aura été laissé libre de s'exprimer et de défendre son point de vue. Je peux accepter de me soumettre au vote majoritaire si je sais que ceux qui ont voté ont été correctement informés, que j'ai pu faire part de mes arguments, etc. Mais pourquoi admettrais-je de me soumettre au vote d'une majorité qui a été manipulée, à laquelle on n'a fait entendre qu'un "son de cloche" ?
--> Illustration : toute société, et plus encore toute société moderne, est traversée par des divergences d'opinions, de croyances, de valeurs, etc. Ce sont ces divergences qui se manifestent aujourd'hui dans les débats portant sur l'extension de la PMA (procréation médicalement asistée). Ces divergences sont telles qu'il n'y a aucune raison de supposer que tous les citoyens tomberont un jour "d'accord" sur ce qu'il convient de faire (étendre ou non l'accès à la PMA). Mais comment faire en sorte que tous les citoyens se soumettent in fine à la loi validée par la majorité ? Pour obtenir ce "consensus" (malgré les divergences), il est nécessaire que le vote majoritaire ait été précédé d'un débat public au sein duquel chacun a pu s'exprimer, défendre ses positions, etc. C'est parce que chacun a pu s'exprimer, parce que les différents arguments ont pu être entendus, que le vote final trouvera une légitimité (même aux yeux de ceux qui seront en désaccord avec lui). Le vote majoritaire n'a de valeur que si chacun a pu être éclairé ; ceux qui défendent l'idée selon laquelle l'extension pourrait porter préjudice au développement de l'enfant doivent pouvoir faire part de leurs arguments ; ceux qui indiquent que les statistiques disponibles démentent ces craintes doivent pouvoir le montrer. Ensuite chacun pourra faire part de son jugement, et ce jugement pourra être considéré comme valide.
Bilan : en suivant le texte, nous pouvons donc soutenir que le débat public est le fondement de la démocratie, dans la mesure où il permet à la fois au citoyen de jouer son rôle (de membre du Souverain), et au vote majoritaire de fonder sa légitimité. Il n'y a donc ni citoyen autonome, ni majorité éclairée sans débat public : il n'y a pas de démocratie sans débat.
Comme question de réflexion, nous envisageons l'interrogation suivante : "le dialogue met-il fin aux conflits ?"
Thèse-réponse n°1 : le dialogue met fin au rapport de forces violent entre les individus
[Attention : là encore, le but est de mettre en oeuvre la démarche explicative : le développement proposé est donc plus long que celui qui serait demandé dans une épreuve de bac, du moins en ce qui concerne l'épreuve de première. Ainsi, dans la justification qui suit, une seule raison suffirait.]
--> Justification : le dialogue se définit comme un échange verbal entre individus, qui confrontent leurs points de vue. Or ceci suppose :
a. que chacun reconnaisse l'autre comme un sujet, porteur d'idées et d'arguments qui méritent d'être écoutés. Deux individus qui dialoguent ne sont pas des sauvages en guerre, cherchant à imposer "leur" vérité, mais des partenaires dans une recherche commune de la vérité.
b. qu'à la force physique (qui permettrait au plus fort d'imposer sa volonté) on substitue la force des arguments. Le plus "fort" n'est pas celui qui dispose de la plus grande force de contrainte, mais celui qui tient le discours le plus rationnel, celui qui dispose des meilleurs arguments, celui qui saura convaincre. Le combat physique cède ainsi la place à un concours (au double sens du terme : con-courir, c'est à la fois faire la course contre quelqu'un... mais aussi courir avec lui) de rationalité : qui a raison ?
c. que chacun accepte la règle du jeu, selon laquelle le point de vue le plus raisonnable devra être accordé. Il n'y a aucun sens à "dialoguer" si l'on accepte pas au départ la possibilité de changer d'avis, de se laisser convaincre (dans le cas contraire, c'est un dialogue... de sourds). L'autre n'est plus un ennemi à terrasser, mais celui qui me permet de découvrir ma propre pensée, de vaincre mes propres préjugés etc. L'interlocuteur n'est plus mon ennemi : c'est mon allié dans la lutte contre l'erreur.
10.10. A la prise de parole dans les délibérations relatives à la loi correspond le premier "genre" distingué par la rhétorique de l'Antiquité: le genre délibératif. La caractéristique majeure du genre délibératif est sa capacité de convaincre l'assemblée, par des argumentaires solides. Cela ne veut pas dire que les autres traits de la rhétorique (talent oratoire, etc.) n'y jouent aucun rôle, mais ici il s'agit avant tout de montrer que la position que l'on défend est la plus raisonnable. Car pour un Grec de l'Antiquité, ce qui est conforme à la raison est toujours ce qui est conforme au Bien commun, et donc à la justice.
Mais le droit n'est pas seulement ce au sujet de quoi on délibère ; dans la démocratie athénienne, le citoyen n'est pas seulement celui qui contribue à l'élaboration des lois : il est aussi celui qui, à tout moment, peut citer à comparaître un autre citoyen pour non-respect des lois. Nous insistons sur le fait que, dans la démocratie athénienne, il n'y a pas de "ministère public": c'est aux citoyens que revient la charge de veiller au respect des lois et d'accuser ceux qui commettent des infractions. Être citoyen, c'est donc participer à l'espace judiciaire, en tant qu'accusateur, ce qui explique la présence de ces personnages ambivalents : les sycophantes. Le sycophante est un citoyen dont la profession est d'accuser ceux qui ne respectent pas les lois (s'il gagne le procès, il reçoit une partie de ce que doit verser l'accusé). Il s'agit d'un personnage ambigu, dans la mesure où si, d'un côté, le civisme est son métier (il passe son temps à veiller au respect des lois), de l'autre il ne le fait pas, justement, par civisme mais par intérêt personnel.
Être citoyen, c'est donc également être susceptible d'être accusé (éventuellement par un sycophante), et donc devoir prendre la parole au tribunal pour se défendre. Nous insistons sur le fait qu'aucun citoyen de jouit de "l'impunité" à Athènes : même les citoyens les plus prestigieux peuvent être cités à comparaître (on pourrait même dire que plus les citoyens occupent une place de premier plan, et plus ils risquent de se retrouver mis en accusation). Car à Athènes (contrairement à ce qu'il se passera à Rome, où la défense sera confiée à un "patron", à un protecteur qui engage sa propre renommée dans le procès), c'est l'accusé qui doit assurer lui-même sa propre défense. D'où l'existnce d'un second personnage, le "logographe" (également assez mal vu), chargé de rédiger les plaidoyers que les citoyens réciteront ensuite devant le tribunal.
A ce second type de discours correspond ainsi le second genre de la rhétorique : le genre "judiciaire". La caractéristique-clé du genre judiciaire est son caractère persuasif. Ici, il ne s'agit pas seulement de construire des argumentaires, mais d'utiliser toutes les ressources de l'éloquence pour emporter les voix du jury. Et comme le but est moins de faire apparaître la vérité que de faire croire que l'on soutient une cause juste (innocence / culpabilité de l'accusé), ce qui est recherché est avant tout la vraisemblance. Celui qui veut persuader l'auditoire doit savoir s'affranchir de l'exigence de vérité, qu'il n'est pas forcément possible de connaître et qui, par ailleurs, n'est pas toujours vraisemblable, pour construire le discours le plus susceptible d'être cru par les membres du jury.
Nous terminons cette mise en lumière du rôle politique de la parole dans la Cité antique en indiquant le troisième registre de discours à vocation politique ; c'est celui qui permet, notamment lors des cérémonies funéraires ou des célébrations, de "fédérer" l'ensemble des citoyens autour des valeurs et des lois communes, en glorifiant celui qui en constituait une incarnation (c'est du moins ce que l'éloge doit faire apparaître...). Ces discours, qui rassemblent la communauté des citoyens dans la célébration d'une appartenance à un même monde d'idées, de pratiques et de valeurs, consolidant ainsi ce que nous appellerions aujourd'hui "l'identité nationale", par-delà les oppositions de clans et de doctrines (nous indiquons le parallèle que l'on pourrait faire aujourd'hui avec les différents éloges adressés à Jacques Chirac par les membres de partis les plus divers), correspondent au troisième genre de la rhétorique : le genre épidictique.
Nous présentons les modalités de l'épreuve du baccalauréat : texte, question d'interprétation, question de réflexion.
Nous indiquons les principes méthodologiques.
1. En ce qui concerne la question d'interprétation : il s'agit de repérer, restituer et expliquer les éléments du texte qui permettent de répondre à la question posée. Pour structurer l'explication, il faut construire deux (ou trois) paragraphes explicatifs dans lesquels un passage du texte (qui apporte un élément de réponse à la question posée) est ;
_ restitué (que dit l'auteur ?),
_ expliqué (pourquoi ? il faut essayer de justifier ce que dit l'auteur),
_ illustré (par un exemple précis)
2. En ce qui concerne la question de réflexion : il s'agit de construire une réponse personnelle à la question posée, en prenant appui sur le texte ET sur le cours et la culture personnelle. Là encore, il faut essayer de construire deux paragraphes argumentatifs qui :
_ donnent un élément de réponse à la question posée
_ justifient cet élément (argument)
_ illustrent cet élément (exemple)
03.10. Nous terminons l'analyse du rapport entre langage et société en analysant le rôle "acculturant" du langage.
Ce dernier point nous conduit à marquer la relation entre langue et identité culturelle. Si nous rappelons que tout individu pense dans une langue, et que la langue n'est jamais une création de l'individu (c'est la société qui est l'auteur de la langue), il faut admettre que l'individu pense dans un matériau qui a été fabriqué par la société. En ce sens, la pensée individuelle est socialement déterminée par la langue.
Or une langue n'est jamais neutre d'un point de vue "idéologique". Toute langue absorbe, intègre, exprime et véhicule la "culture" (la vision du monde, lamanière de vivre) de la communauté qui la parle. La langue est l'instrument qui permet de "classer" les choses du monde, de les répertorier, mais aussi de les hiérarchiser. A travers ses classifications et ses hiérarchisations, la langue exprime donc les priorités de la communauté. Nous illustrons cette idée avec le cas de la langue française. L'une des deux propriétés fondamentales d'un nom (commun), en français (l'autre étant le nombre : singulier /pluriel) est le genre. Désigner une chose, c'est d'abord la classer dans l'une de ces deux catégories fondamentales : le masculin, le féminin. Cette disctinction 'est pas neutre: elle exprime déjà une cerraine vision du monde, qui fait du genre un élément fondamental de tout être. Mais la langue exprime également ce qu'est la catégorie supérieure : d'un point de vue grammatical, "le masculin l'emporte". Un seul élément masculin suffit à transformer un collectif féminin en "ils", l'accord se fera donc au masculin, etc. Cette domination du masculin se retrouve même dans le vocabulaire : la plupart des termes qui désignent une fonction d'autorité ou de prestige sont masculins : le chef, l'auteur, le penseur, le Proviseur, etc. C'est donc une vision du rapport entre l'homme et la femme qui est véhiculée par la langue française (qui apparaît ici notoirement misogyne). Et si l'individu pense dans cette langue, il pense donc dans un matériau qui fait du genre une propriété fondamentale de tout être, et où le genre masculin est dominant.
En ce sens, apprendre une langue, c'est apprendre bien plus que du vocabulaire ou de la grammaire: cest apprendre la vision du monde, la culture de la communauté qui parle cette langue ; s'approprier une langue, c'est s'approprier une identité culturelle, c'est "s'acculturer".
Nous illustrons ce lien entre culture, langue et pensée à travers deux exemples. Le premier est un exemple littéraire : dans 1984, le but du "newspeak" (novlangue) est précisément de forger une langue conforme aux idées et aux valeurs du pouvoir : si on pense dans la langue, alors en contrôlant la langue, on contrôle la pensée. Le but du newspeak est précisément de faire en sorte que l'on ne puisse pas dire (et donc penser) ce que l'on ne doit pas penser (par exemple en transformant le sens des mots "dangereux" : war is peace, freedom is slavery, ignorance is strength).
Le second exemple est emprunté à l'histoire.La réforme de l'alphabet (1928) par Ataturk (Mustafa Kemal) n'est pas seulement une réforme linguistique. Elle sert de supportà une "révolution culturelle" visée par le dirigeant Turc : le but est de faire entrer la Turquie dans la "modernité", ce qui implique (pour Ataturk) une occidentalisation de la culture. En transformant l'alphabet, on fait en sorte que les jeunes Turcs puissent seulement lire et écrire dans une langue occidentalisée. Cette occidentalisation du langage est au service d'une occidentalisation de la pensée, de la culture, qui doit rompre avec l'histoire et les traditions issues du passé.
4) Langage et politique
a) L'homme comme animal politique
Nous envisageons à présent le rôle que le langage peut jouer dans le développement de l'humanité de l'homme en tant qu' "animal politique". En repartant de l'analyse de cette formule (d'Aristote), nous montrons que l'homme n'est pas seulement un "animal social", c'est-à-dire un animal qui, par instinct ou par intérêt, aurait besoin de vivre en société. Nous montrons que l'homme est un être qui a besoin, pour devenir pleinement homme, de vivre dans une Cité au sein de laquelle les rapports sociaux sont régis par le droit, conformément à une exigence de justice. C'est si vrai que, pour Aristote, l'homme ne peut pas même construire de sociétés s'il ne se soucie pas du Bien Commun (critère de la justice). En prenant appui sur le mythe de Prométhée (tel qu'il nous est raconté dans le dialogue Protagoras, de Platon), nous illustrons l'idée selon laquelle c'est le sens de la justice qui permet aux hommes de vivre-ensemble, en société. Nous remarquons au passage qu'une société démocratique est impossible (elle n'aboutit qu'à la domination de l'intérêt de la majorité) si les citoyens sacrifient le bien commun à leur intérêt personnel.
Quel rôle joue alors le langage dans cette nature "politique" de l'animal humain ?
b) Le langage et la différenciation du juste et de l'injuste
En prenant appui sur le texte d'ARISTOTE (recueil), nous commençons par souligner que, pour Aristote, c'est bien le langage qui nous permet de différencier l'utile du nuisible, mais plus encore le juste de l'injuste. Si la voix (voire le cri...) suffit à exprimer l'agréable ou le désagréable, nous avons besoin des mots pour désigner ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. La nature qui, pour Aristote, ne fait rien en vain, nous a donc donné l'instrument qui convient à notre nature d'animal politique : le langage.
c) Langage et droit
Par ailleurs, l'institution chargée de dire le juste et l'injuste dans la Cité grecque, c'est le droit. Or le droit, c'est du langage. C'est l'une des grandes découvertes de la Grêce antique que d'avoir remplacé des règles orales, appartenant à un petit groupe social (seul habilité à les conserver... et à les prononcer), par le "droit positif", c'est-à-dire un système de règles publiques, accessibles à tous, et auxquelles chacun peut se réferer pour faire valoir ses droits. La Cité grecque est le lieu d'éclosion des "textes de loi" en tant que textes publics ("nomos"), qui régissent les rapports sociaux au sein de la société. Nous soulignons que chaque Cité de la Grèce antique est fière de sa Constitution, dont elle réfère généralement la rédaction à un Père fondateur (Lycurgue à Sparte, Solon à Athènes, etc.)
d) Langage et délibération
Cette nature publique du droit se rfenforce évidemment dès que nous entrons dans une république, et plus encore si celle-ci se veut démocratique. Ce qui caractérise une République (qui signifie en latin : "chose publique"), c'est que la politique y est l'affaire du peuple pris dans son entier, une chose qui regarde tout citoyen ; et si nous intégrons le principe fondamental de la démocratie, nous pouvons ajouter que tout citoyen se doit de participer à l'élaboration du droit. C'est précisément dans cette participation que le citoyen assume et affirme sa citoyenneté ; être citoyen dans une démocratie, c'est participer au débat public, prendre la parole.
L'espace linguistique (celui de l'échange, de la discussion, du débat, de la délibération, et enfin celui du vote par lequel le citoyen fait entendre sa "voix") devient ainsi l'espace politique par excellence, celui dans lequel la prise de parole devient l'acte civique essentiel. C'est à cet acte de langage que se rattache l'un des trois grands genres de la "rhétorique" (terme sur lequel nous alllons bientôt revenir) : le genre délibératif.
26.09. Nous terminons l'analyse du texte de Kant. Nous montrons d'abord que, pour sortir les individus de l'état de minorité dans lequel ils se trouvent, il est vain de compter sur l'action des autorités (politiques, religieuses ou autres). En effet, ces autorités font généralement en sorte que les individus restent mineurs pour mieux pouvoir les dominer ; elles ne cessent de montrer aux individus qu'il serait dangereux de penser par soi-même et de s'écarter du discours établi. Nous prenons l'exemple du domaine religieux : les autorités religieuses (du XVIII° siècle....) ont tendance à maintenir les fidèles sous leur tutelle, en leur affirmant que la "libre-pensée" mène tout droit à l'enfer en conduisant à l'hérésie (qui repose sur l'erreur dans le domaine religieux) ou au "libertinage".
Mais par ailleurs il apparaît illusoire également de compter sur l'individu pris isolément (qui trouve dans sa soumision à l'autorité une source de confort et de sécurité... et qui se trouve effectivement en danger s'il rejette le joug des normes établies).
Pour Kant, la sortie de "l'état de minorité" ne passera donc ni par l'émancipation de l'individu par les autorités, ni par la libération de l'individu par lui-même, mais par l'émancipation du peuple par lui-même. Comment le peuple peut-il apprendre à penser par lui-même ? Pourquoi "le peuple" peut-il ce que l'individu considéré isolément ne peut pas ? Et à quelles conditions ? Pour Kant, pour que le peuple apprenne à penser par lui-même, il faut et il suffit de lui laisser la liberté de s'exprimer. Car si la liberté d'expression est garantie, alors les penseurs, ceux qui ont déjà secoué le joug de la pensée dominante, pourront publier leurs pensées. Et en se familiarisant avec leurs argumentaires, les individus du peuple apprendront à former leur propre jugement. C'est donc en ayant accès aux raisonnements de ceux qui pensent, que ceux qui ne pensent pas encore par eux-mêmes apprendront à raisonner, et donc, à penser.
Nous insistons sur le fait suivant : pour Kant (comme pour la plupart des penseurs des Lumières), la "liberté d'expression" ne désigne pas du tout le droit reconnu à n'importe qui de dire n'importe quoi. Elle ne vise pas à donner à n'importe quel individu le droit d'exprimer "son opinion", même de façon stupide. La liberté d'expression doit accorder à ceux qui pensent le droit de penser publiquement : de communiquer leurs raisonnements au peuple. C'est ce qu'illustre le projet de l'Encyclopédie, qui n'était évidemment pas de laisser n'importe qui écrire n'importe quoi, mais de permettre à tous les citoyens d'accéder à l'exercice de la pensée, tel qu'il était pratiqué par... les penseurs.
On voit donc que, pour Kant, la condition de la liberté de pensée est la liberté d'expression. C'est en laissant un peuple libre de s'exprimer que ceux qui, parmi le peuple, savent déjà penser, apprendront aux autres à le faire en leur communiquant leurs raisonnements.
3) Langage et société
Nous nous tournons maintenant vers une autre propriété naturelle de l'homme : sa sociabilité. L'homme ne vit ni seul, ni en troupeau ou en meute, il vit en société : c'est un "animal social" (formule d'Aristote). La question est donc de savoir ce qu'est le rôle joué par le langage dans la sociabilité de l'homme.
Nous commençons par une idée simple : le langage est le support fondamental du rapport social, en tant que ce rapport est avant tout un rapport de communication. On peut penser une société sans rapports physiques entre les hommes (Isaac Asimov l'a imaginé), mais une société sans comunication verbale entre les hommes ne serait pas une société (et il est d'ailleurs probable que les hommes y perdraient ce qui fait leur humanité).
Par ailleurs, le recours au langage ne permet pas seulement de s'exprimer et de communiquer : il permet de "se comprendre", et de se faire comprendre, par les membres de la communauté à laquelle on appartient. "Nous parlons le même langage", "nous nous comprenons", "je vous entends" : autant de formules qui indiquent que la communauté linguistique cimente la communauté sociale. On comprend ainsi par opposition que la "mésentente", "l'incompréhension", les "malentendus" sont en revanche des facteurs de discorde entre les individus. Nous illustrons cette idée à l'aide du mythe de la Tour de Babel (si Dieu a créé la diversité des langues, c'est parce qu'il a voulu la discorde entre les hommes).
On comprend ainsi que toute comunauté tende à produire "son" langage, qui fonctionne comme un marqueur (volontaire ou non) d'appartenance à la communauté. Il y a une "langue des savants" comme il y a une "langue des banlieues", une "langue populaire", une langue des jeunes, etc. Parler une certaine langue, c'est manifester et / ou revendiquer son appartenance à une certaine communauté. Ainsi, un certain vocabulaire (argot, verlan), une certaine syntaxe, un certain accent peuvent marquer immédiatement l'appartenance sociale d'un individu. La langue est donc un facteur de socialisation, mais aussi "d'intégration" communautaire.
19.09. Nous dressons un premier bilan d'étape : les deux affirmations que nous avons soutenues sont pour le moment les suivantes :
a. Le langage fait partie de la nature de l'homme
b. Le langage est le support de la culture en ce qu'il est la condition de la pensée rationnelle : l'homme pense dans le langage, et c'est par l'argumentation et le dialogue qu'il peut former sa pensée.
La thèse b nous amène à présent à une thèse (c) : s'il n'y a pas de pensée sans langage, alors il ne peut pas y avoir non plus de liberté de pensée sans liberté d'expression.
C'est cette thèse que nous allons soutenir en prenant appui sur l'analyse du texte 3 du recueil (texte de KANT). Nous présentons succinctement la pensée de KANT en posant les principes de la philosophie des Lumières, en tant que mouvement de pensée européen. Le fondement de la philosophie des Lumières et que l'homme doit vivre conformément aux facultés qui font de lui un être humain, c'est-à-dire d'abord la raison et la conscience. C'est en cela que consiste la liberté véritable, et non dans l'obéissance aux désirs. Nous prenons appui sur le cas de l'alcoolique pour montrer que celui qui n'a pas la force de résister à son désir (de boire) pour suivre sa volonté (arrêter de boire) n'est pas libre : il est l'esclave de son désir. En revanche, celui qui a la force de résister à son désir pour suivre sa volonté est "auto-nome", il se dicte à lui-même ses propres règles ("ne plus boire") et il s'y conforme. Si l'on se demande maintenant ce qui détermine la volonté (pourquoi notre alcoolique a-t-il pris la décision de ne plus boire ?), on voit que les deux facultés qui guident ici la volonté sont la raison (qui lui montre que l'alcoolisme a des conséquences désastreuses sur sa santé, sur sa vie profesionnelle, familiale, etc.) et sa conscience (qui souligne les conséquences que son alcoolisme a sur ses proches, sur ses reponsabilités parentales, etc.) Nous pouvons donc conclure avec les Lumières que la liberté consiste à agir en suivant notre raison et notre conscience.
La question est alors de mettre en lumière le lien qui existe entre deux formes de liberté : la liberté de pensée, et la liberté d'expression.
En prenant appui sur le texte, nous montrons que la première repose sur le fait de "penser par soi-même". C'est cette capacité à penser par soi-même qui définit ce que Kant appelle : la "majorité". Est majeur celui qui est capable de penser par lui-même.
Or il existe selon Kant deux types de "minorité" : de la première, nous ne sommes pas responsables. Ainsi, quand nous étions enfants, notre raison et notre conscience n'étaient pas parvenues à maturité, ce qui nous empêchait de former un jugement valable. C'est la raison pour laquelle les enfants ont besoin d'un tuteur : le tuteur, dont la raison et la conscience sont parvenues à maturité, peut penser "à la place" de l'enfant pour déterminer ce qui est bien pour lui (et pour les autres). Le tuteur sait mieux que l'enfant qu'il lui faut aller se coucher à une heure raisonnable, il sait mieux que l'enfant qu'il faut aller à l'école, etc. La responsabilité du tuteur, c'est donc d'imposer sa volonté tant que l'enfant n'est pas capable de produire son propre jugement.
Mais il existe selon le texte un deuxième type de minorité ; et de celle-là, nous sommes responsables. C'est celle qui caractérise l'individu qui n'a pas le courage de penser par lui-même. Nous interrogeons alors les raisons pour lesquelles le fait de penser par soi-même exige du courage, et nous mettons en lumière deux raisons :
(a) penser par soi-même exige de faire l'effort de penser. Penser exige un travail : il faut s'informer, analyser, confronter des discours différents, dialoguer, etc. Ceci exige de remettre en cause nos préjugés, ce qui n'est jamais facile ; douter de ce que nous avions toujours admis comme "évident", "allant de soi" exige un effort.
Pour illustrer ce point, nous prenons l'exemple de ce qui constitue bel et bien un "pré-jugé" actuel : le fait que "la science" fait autorité dans le domaine du savoir. Il va de soi pour un occidental d'aujourd'hui que "ce qui est scientifiquement démontré" ne saurait être remis en cause, que pour savoir ce qui est "vrai", le mieux est de s'en remettre à la science. Qui oserait aujourd'hui affirmer que "la science le prouve... mais je ne suis pas d'accord" ? Or si nous remontons de quelques siècles en arrière, on voit que c'est d'une toute autre autorité que l'on n'aurait pas oser douter. Même pour des scientifiques comme Copernis ou Galilée, il était absolument impossible que la Bible soit erronée. La Bible est la Parole de Dieu, et Dieu ne se trompe pas, ni ne nous trompe. Donc ce que dit la Bible est vrai. Si donc elle nous semble se tromper... c'est que nous la lisons mal. On ne peut pas, on ne doit pas douter de la Parole de Dieu. D'où l'individu tenait-il cet étrange préjugé ? Nous répondrions aujourd'hui : de la société dans laquelle il vivait, de son éducation, du discours des autorités de cette époque, etc. Mais il en va de même aujourd'hui : pourquoi un européen "normal" d'aujourd'hui accepte-t-il "la science" comme une autorité suprême dans le domaine du savoir ? Probablement de ceci : toute la société dans laquelle il vit repose sur la science (notamment par le biais des techniques "scientifiques" que sont les technologies), toute l'instruction scolaire lui a présenté le discours "de la science" comme ce qui, étant vrai, peut et doit être enseigné à tous les enfants... comment en douter ? Il faudrait beaucoup de force pour remettre en cause cette "foi en la science" que toute notre société nous inculque... (alors même que cette remise en cause est, peut-être, une nécessité pour faire face aux défis du XXI° siècle, comme le défi environnemental).
Penser exige donc un effort. Ainsi, pour savoir "ce que je pense" en politique, il ne suffit pas de consulter ce qui me vient spontanément à l'esprit ; cela, c'est ce que mon éducation, mon milieu social, les médias auront déposé dans mon esprit. Ce que "je pense", c'est ce à quoi j'aboutirai une fois que j'aurai fait l'effort de penser. Et comme tout effort celui-ci exige du courage (ce qui ne signifie pas qu'il soit désagréable : tout sportif sait qu'on peut prendre plaisir à l'effort que l'on fait pour débelopper nos capacités).
(b) penser par soi-même implique de prendre le risque de s'écarter de l'opinion commune, de la "doxa". Or il est toujours dangereux de s'écarter de l'opinion dominante, de la morale collective. Car la société réagit toujours, par les moyens de répression les plus variés (du rire à la prison...) face à celui qui remet en cause les normes communes.
En prenant un exemple apparemment aussi superficiel que le vêtement, nous montrons que le corps social peut produire tout un dispositif de rétorsion face à celui qui retejetterait une norme communément admise et pour laquelle il n'existe pourtant aucune justification rationnelle. Ainsi, un homme qui tenterait de porter des jupes se trouverait confronté, de l'enfance à l'âge adulte, à une foule de "sanctions" sociales, qui iront du rire de ses camarades aux difficultés professionnelles (imaginons un prof de sport qui viendrait en jupe...) ou plus largement sociales (sa valeur sur le marché amoureux s'effondre...). La répression sera d'autant plus forte lorsque l'individu voudra s'affranchir de normes morales communément admises : car faire "ce que les autres considèrent comme mauvais", c'est forcément être considéré comme "coupable" par ces mêmes autres. Ainsi, un jeune anglais de 1950 qui aurait remis en cause la condamnation sociale de l'homosexualité et qui aurait voulu affirmer sa propre sexualité (qui paraît à notre société tout à fait acceptable) se serait rapidement vu confronté au dilemme que rencontra Alan Türing, l'un des inventeurs de l'informatique : la prison, ou la castration biochimique. Il est donc dangereux de remettre en cause les normes dominantes, les préjugés collectifs. Et comme tout ce qui est dangereux, cela exige.... du courage.
Il faut du courage pour être libre, car il faut du courage pour penser par soi-même.
12.09: 2) Le langage comme propre de l'homme.
Nous montrons d'abord (a) que tout homme dispose de la faculté du langage (mêmes'il peut perdre cette faculté, soit parce qu'il ne l'a pas réalisée durant son enfance, soit à la suite d'un traumatisme physique ou mental) ; s'il existe des sociétés sans écriture, il n'existe pas de société, de civilisations sans langage : toute société produit, crée, invente une ou plusieurs langues. Nous montrons ensuite (b) que seul l'homme dispose de cette faculté : les animaux peuvent s'exprimer et communiquer à l'aide de signaux (visuels, sonores, olfactifs...) instinctifs, mais aucune espèce animale n'invente de "langue". Nous pouvons donc bien placer le langage dans les caractéristiques propres de l'homme: le langage fait partie de la "nature" humaine.
Mais, si le langage n'est évidemment pas la seule caractéristique spécifique de l'homme, il n'en constitue pas pour autant une faculté "parmi d'autres". Nous allons montrer que le langage est la faculté qui permet le développement des autres caractéristiques de l'homme.
B) Langage et culture
1) Définition
Nous commençons par définir la notion de "culture" : dans son sens le plus large, la culture est composée de l'ensemble des domaines d'activité spécifiquement humains. Ce que l'homme fait et qu'il est le seul à faire fait partie de la culture. Ainsi la science, la politique, l'art, la religion (etc.) font partie du vaste ensemble de la culture. Nous cherchons donc à montrer que toutes les dimensions de la culture sont tributaires du langage.
2) Le langage et la pensée
Nous commençons par la caractéristique essentielle de l'homme, qui est d'être capable d'une pensée consciente et rationnelle (le fait d'être "doté de raison et de conscience" est ce qui caractérise l'homme dans la Déclaration Universelle des droits de l'homme). Or cette pensée n'est possible que par le langage, comme l'indiquent déjà :
_ le fait que la pensée (rationnelle) et le langage soient désignées par un seul et même mot dans la Grèce antique: "LOGOS"
_ le fait que dans la langue française, "penser" quelque chose soit équivalent au fait de "se dire" quelque chose.
En prenant appui sur le texte de Hegel (recueil, texte n° 2) nous montrons que, contrairement à ce que l'on suppose souvent, la pensée ne préexiste pas à sa formulation dans le langage. Car les mots sont le matériau de la pensée : penser, c'est (se) dire. Une pensée n'est pas réellement pensée avant d'être traduite en mots : on ne peut pas penser, même une thèse simple, sans la verbaliser. Les mots sont les matériaux de la pensée, les règles du langage (syntaxe, etc.) sont les règles de la pensée. De sorte qu'une idée mal formulée... n'est rien d'autre qu'une idée mal pensée.
Nous soulignons (avec Hegel) que cette nécessité du recours au langage n'est pas un problème, un défaut de la pensée. C'est au contraire parce qu'elle utilise des mots (qui peuvent être clairement définis) que la pensée peut être précise, c'est parce qu'elle s'exprime en phrases qu'elle trouve sa rigueur (respecter la syntaxe, c'est respecter les règles de la logique). Ce qui est "ineffable" (ce que l'on ne peut pas dire), c'est aussi ce que l'on ne peut pas véritablement penser. Et si certaines choses ne semblent pas pouvoir se dire dans le langage "normal", cela ne nous dispense pas de devoir les dire pour pouvoir les vivre pleinement : la poésie amoureuse n'a pas d'autre but que de permettre à l'amour de s'épanouir pleinement en créant la langue (poétique) en laquelle il trouve à s'exprimer.
Penser, c'est donc parler. Mais parler comment ?
Dans le domaine de la pensée rationnelle, il semble que la démarche la plus rigoureuse soit celle qui s'inspire de la méthode des mathématiciens : on affirme (théorème), on démontre (par un raisonnement logique), on illustre (par un exemple), on conclut (CQFD). Pourtant, cette démarche souffre évidemment d'un défaut remarquable : c'est que l'on n'y tient qu'un seul discours. Dans le domaine mathématique, c'est peut-être souhaitable, mais ailleurs ? Qu'en est-il, par exemple, dans le domaine politique ? "Penser" en politique, est-ce n'entendre / ne défendre qu'un seul point de vue ?
On comprend ainsi ce qui conduit à adopter une autre posture de "discours" : celle du DIALOGUE. Les premiers philosophes de l'histoire occidentale n'ont pas rédigé de "traités": ils ont rédigé des dialogues, dans lesquels des interlocuteurs échagent questions et réponses, thèses et anti-thèses, etc. SOCRATE n'a rien écrit, mais a passé sa vie à dialoguer sur la place publique (agora) avec les citoyens d'Athènes ; et PLATON a écrit des dialogues, dont l'un des "personnages" n'est autre que Socrate. Dans cette optique, "penser", ce n'est pas dérouler UN argumentaire, permettant de soutenir UN point de vue; c'est confronter des discours différents, des argumentaires contradictoires, des exemples divergents, etc.
Nous illustrons cette idée avec le vote (politique). Un vote n'a de sens que s'il exprime un jugement personnel (il est donc logique de ne pas accorder le droit de vote à quelqu'un qui ne peut pas penser par lui-même, comme un enfant). Mon vote doit exprimer "ce que je pense". Mais que pense-je ? Je ne le saurai qu'une fois que j'aurai fait l'effort de penser. Au départ, je peux avoir une "opinion" (dictée par le milieu familial, les médias, la tête d'un candidat, etc.) ; mais je n'aurai un jugement, exprimant ce que JE pense, qu'une fois que j'aurai effectué le travail qui définit la pensée. Or en quoi consiste ce travail ? Il s'agit d'abord de collecter de l'information (dans des sources diversifiées) ; mais il s'agit plus encore de confronter des discours différents, des argumentaires différents ; c'est en discutant avec des interlocuteurs de bords politiques différents que je pourrai découvrir ce que, moi, je pense. Si je n'écoute qu'un seul discours, j'en resterai prisonnier, et "ma" pensée... ne sera que le reflet de celle de l'autre.
On comprend ainsi pourquoi la pensée est, pour PLATON, un dialogue, même lorsque je pense en moi-même. "La pensée est un dialogue de l'âme avec elle-même" : c'est ce qu'affirme le texte n°1 du recueil.
Attention : il ne s'agit pas (du tout) de dire que, grâce au dialogue, nous aboutirons à une prise de position qui réconciliera tout le monde, à un "consensus". Il n'y a aucune raison de l'affirmer. Ce que permet le dialogue, ce n'est pas de déterminer "ce que pense tout le monde", mais bien ce que pense chacun. Des individus qui pensent peuvent très bien aboutir à des prises de position politiques différentes; ce qui importe c'est que le dialogue leur a permis de découvrir ce qu'était véritablement leur pensée.
A cet égard, nous concluons la séance par une question : si l'école a pour but de premettre à chacun de produire son propre jugement, de former un jugement "personnel, autonome et réfléchi", bref, de permettre à chacun de "penser par lui-même", ne devrait-elle pas faire davantage de place au dialogue, à la confrontation d'argumentaires différents ? Ne devrait-elle pas, par exemple, s'abstenir de défendre, dès l'enfance, UN point de vue politique (républicain, démocrate, laïque...) pour faire dialoguer des points de vue différents (anarchistes, monarchistes, etc.) ? Ne devrait-elle pas donner plus d'importance à la confrontation des discours d'historiens, comme le voulait Georges Duby ?
05.09.2019: Présentation générale de la spécialité (document polycopié) : caractéristiques, buts, modalités. La spécialité HLP se caractérise par un ensemble de rapports : rapports entre des approches disciplinaires différentes, rapport entre une période de réference et les questionnements contemporains. Présentation du programme, des épreuves, du site internet. Présentation générale de la discipline : qu'est-ce que la philosophie ? On montre que l'espace propre de la réflexion philosophique est celui au sein duquel des problèmes se posent, qui exigent de l'homme une réflexion rationnelle, mais face auxquels il ne peut s'en remettre à une démarche d'argumentation exclusivement scientifique (ex : philosophie politique).
Approche du Thème n° 1 : le langage. Dans une première partie du cours, nous essaierons de montrer pourquoi il est logique d'initier une spécialité "Humanités" par une réflexion sur le langage. Le langage est en effet aussi bien une faculté spécifique de l'homme (elle fait donc partie de la nature de l'homme), et une faculté qui lui permet de développer ses autres caractères essentiels : pensée rationnelle, vie sociale, politique, artistique, religieuse. Elle est donc ce qui permet à l'homme de développer sa propre "humanité". En ce sens, elle est le fondement de la culture.
I) Le langage : sa nature et ses enjeux philosophiques.
A) Langage et nature humaine
1) Définitions : langage, nature
Nous commençons par définir le langage comme une faculté, capacité de s'exprimer et de communiquer à l'aide d'un système de signes conventionnels. Nous montrons que cette faculté est propre à l'homme.
Nous analysons la notion de "nature" : la nature d'un être, d'une chose, est ce qui le caractérise, ce qui le définit. La nature humaine rassemble donc l'ensemble des éléments qui définissent l'être humain, qui le différencient de tous les animaux.
Nous pouvons déduire de ces deux définitions que le langage fait partie de l'essence, de la nature de l'homme.
Ajouter un commentaire