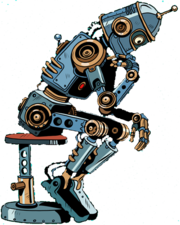Cahier de textes TS
Vous trouverez ici le cahier de textes des TS4. Pour des raisons de commodité, il est présenté sous une forme blog : la dernière date renseignée se trouve donc en haut du document. J'ajoute parfois des liens internes, que vous pouvez consulter pour obtenir des précisions sur le contenu d'une séquence. Si quelque chose vous laisse perplexe (point de cours, élément de méthodologie, etc.) n'hésitez pas à mobiliser l'espace posez vos questions...
31.01. On construit une correction de conclusion d'explication pour le texte de Léo Strauss. Synthèse du texte et mise en perspective. On indique le problème auquel se cofnronte une optique jusnaturaliste : si le droit naturel prend appui sur une conception de la nature de l'homme, et qu'il existe une pluralité culturelle de conceptions de la nature de l'homme, de quel droit une culture peut-elle imposer sa propre conception du droit naturel ? Nous montrons en quoi ce problème est un enjeu majeur du droit international : d'un côté, affirmer l'universalité des droits proclamés dans la Déclaration Universelle des droits de l'homme, c'est reconnaître notre devoir de les faire respecter. De l'autre, imposer par la force le respect de ces droits à un pays qui ne les reconnaît pas, c'est porter atteinte au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
La question est alors : comment faire en sorte que tout être humain puisse jouir de (ce que nous considérons être) ses droits fondamentaux, sans imposer notre conception de la justice à tous les pays du monde ? Nous envisageons une première possibilité, issue de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et qui consistrerait à reconnaître à tout homme le droit de résister à l'oppression dans son pays. Mais cette solution ne paraît pas satisfaisante : d'un côté, sa situation n'en est pas radicalement modifiée, et de l'autre on peut interroger le droit que possède une assemblée d'Etats de reconnaître le droit d'entrer en guerre contre leur gouvernement à des citoyens de pays non signataires... C'est ce qui explique que le droit de résistance à l'oppression disparaisse dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.
En revanche, un droit nouveau apparaît, qui constitue la solution du problème soulevé précédemment : pour faire en sorte que tout homme puisse vivre dans le respect de (ce que nous affirmons être) ses droits fondamentaux, sans imposer le respect de la Charte à tous les Etats du monde, on peut lui reconnaître le "droit de fuir la persécution" dans son pays, ce qui implique la reconnaissance de notre devoir de l'accueillir : c'est le droit d'asile.
Deuxième heure : devoir sur table : interrogation de cours en vue du bac blanc. Vous trouverez le corrigé en ligne à la fin de l'épreuve.
28.01. On montre en quoi la notion de droit naturel constitue le fondement de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, précisément dans la mesure où elle vise à inscrire le droit naturel dans le droit positif.retour sur le sens de l'énoncé "tous leshommes naissent et demeurent libres et égaux en droits" : cet énoncé est absurde si l'on se réfère aux droits positifs : c'est un énoncé du droit naturel, qui est inscrit dans le texte (positif) de la DDHC. On indique la critique à laquelle peut être soumise l'idée de droit naturel: si le droit naturel suppose une "nature" de l'homme, la question de ce en quoi consiste cette nature n'est-elle pas une question à laquelle il n'existe que des réponses... culturelles ? Le fait de considérer que la "nature" de l'homme est d'être doté de raison et de conscience, est-il moins culturel que le fait de considérer que ml'homme est par nature une créature que Dieu a faite à son image, et dont la faculté essentielle est la foi ?
Restitution du DM et éléments de correction (Alain, Bonheur et travail)
Attention : DS prévu jeudi 31 janvier; s'entraîner à l'aide des quiz disponibles sur le site.

21.01. Appendice : précisions sur droit et justice. On prend appui sur un texte de Léo Strauss pour interroger la manière dont le droit peut être posé comme un critère de la justice. L'analyse suivie du texte permet de préciser le sens et la rationalité du positivisme juridique (Kelsen), ainsi que sa critique, puis de revenir sur les principes du relativisme culturel (qui permet de faire face à la diversité des idéaux culturels sans justifier un impérialisme déterminé). La critique du déterminisme culturel nous reconduit à la nécessité d'un "droit naturel".
17.01. 3) Troisième voie:la sublimation. Analyse historique de la notion de sublimation, et de son sens au sein de la psychanalyse de Freud. On montre ce que sont les principes-clés de la sublimation (délimitation d'un espace de satisfaction pulsionnel, différenciation des participants, élaboration de règles techniques), et on indique en quoi peut consister la sublimation des pulsions agressives (guerre-tournoi-sport-échecs...) et celle des pulsions sexuelles (érotisme). On rappelle les limites que Freud lui-même posait au processus de sublimation (toute société doit maintenir des espaces de libération pulsionnelle non sublimée) et on l'illustre avec des scénarii de science-fiction (Pierre Boulle, "Les jeux de l'esprit".)

Un "jeu de l'esprit"...
14.01.C) Vers une recherche de solutions. 1) Première voie : la voie épicurienne. Rappels sur la doctrine épicurienne. On montre que cette voie correspond à une "réduction du conflit à zéro" : immoralité minimale (il ne peut pas être immoral de satisfaire un besoin fondamental, nos besoins fondamentaux n'ont rien d'immoraux), malheur minimal (suppresion de la frustration, de l'angoisse, etc.) Mais aussi : moralité minimale (il n'y a rien de moralement méritant à chercher son propre bonheur) et jouissance minimale (du moins selon Bataille : les plaisirs que l'on tire de la satisfaction de nos désirs naturels et nécessaires sont de faible intensité).
2) Seconde voie : l'amour selon Kierkegaard. On montre comment le conflit entre l'acte effectué "par désir, par intérêt" et l'acte effectué "par obligation morale" est dépassé dans l'acte d'amour. L'acte effectué par amour n'est accompli ni par intérêt, ni par obligation, mais... par amour. Dans l'amour, mon intérêt et l'intérêt de l'autre se corrèlent, sa souffrance et ma souffrace se répondent. Analyse de la formule (de Nietzsche) selon laquelle "'ce qui se fait par amour se fait par-delà Bien et Mal". Application à l'amour familial (un père qui se réveille à trois heures du matin parce que son enfant crie ne le fait ni par plaisir, ni par obligation morale), à l'amour érotique (exemple du cadeau), à l'amour religieux (amour du prochain). On montre que, en retour, l'acte d'amour s'inscrit encore dans l'ordre du désir (en tant qu'amour), et qu'il appartient encore à l'ordre du devoir (il est même LE devoir religieux pour Kierkegaard). Remarque finale : la vie "par amour" ne conduit ni à la "morale" (qu'elle peut contredire), ni au "bonheur" (elle peut impliquer la souffrance) , mais à un autre état : la Joie.
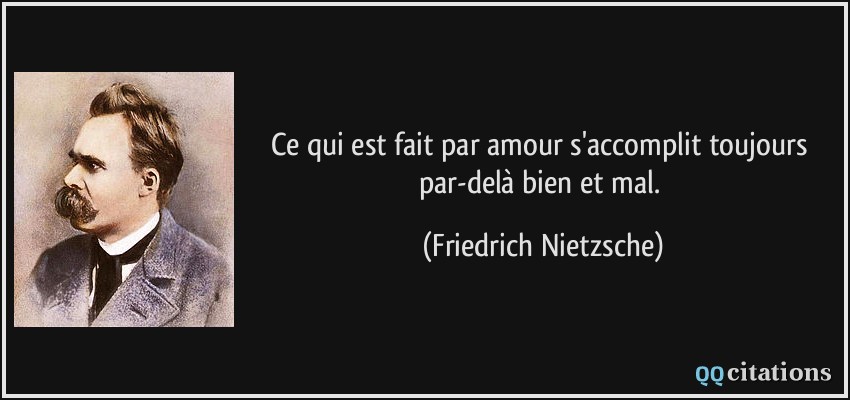
10.01. Le devoir reconnu à l'Etat de garantir à chaque citoyen la possibilité de satisfaire ses besoins fondamentaux conduit à reconnaître un nouveau type de "droits", différents des droits civiques ou politiques : les droits sociaux. Et l'on voit alors apparaître l'enjeu politique de la question du "droit au bonheur" : admettre que l'Etat doit permettre à chacun de satisfaire ses besoins fondamentaux, c'est admettre la légitimité d'un volet social de l'intervention de l'Etat, qui devrait ainsi garantir un droit à l'alimentation (accès à l'eau potable, etc.), un droit au logement (etc.) mais aussi un droit d'accès à des services de santé (possibilité d'accoucher à l'hôpital, etc.), à un service d'éducation, à un accès à la culture (ces deux derniers rejoignant ce que nous avons préalablement désignés comme "besoins culturels" de l'homme. C'est donc légitimer l'instauration de "services publics" (d'éducation), de prestations sociales (sécurité sociale, etc.) financés par l'impôt : ce qui constitue un enjeu-clé pour l'opposition entre les conceptions "libérale" (axée sur la garantie des droits politiques) et "sociale" (qui y ajoute la garantie des droits sociaux) de l'Etat. La distinction entre les deux est par exemple illustrée par le parcours de Martin Luther King, pour lequel la lutte pour les droits civiques n'était que le premier volet d'un combat politique dont le second temps était la lutte pour les droits sociaux des populations noires.... du Sud comme du Nord.
V) Bonheur et morale : désir et devoir. A) Définitions des notions. B) Désir et devoir : les termes du conflit. 1) Pourquoi la morale s'oppose au plaisir : on montre pourquoi, chez Kant, il est impossible d'être véritablement moral si l'on agit par plaisir : il ne suffit pas qu'une action soit effectuée conformément au devoir pour avoir une valeur morale : il faut qu'elle soit effectuée par devoir, et non par plaisir ou intérêt. Dans cette optique, l'acte le plus méritoire est l'acte "surérogatoire", qui exige un sacrifice si radical de notre intérêt qu'on ne peut même plus le considérer comme une devoir. 2) En quoi le désir s'oppose à la morale : nous montrons avec Bataille que l'interdit fait naître le désir de sa transgression et que, le plaisir impliquant une "mise en jeu", le plaisir maximal implique la violation d'un interdit radical (tabou). Donc : la morale semble s'opposer à la réalisation de nos désirs, et nos désirs semblent impliquer une violation de nos devoirs.
![La morale est le contraire du bonheur depuis que [...] - Francis Picabia... La morale est le contraire du bonheur depuis que [...] - Francis Picabia...](https://dicocitations.lemonde.fr/imagescitations/La_morale_est_le_contraire_du_bonheur_depuis_que_-_Francis_Picabia-87131.png)
07.01. IV) Bonheur et politique : le bonheur est-il un droit ? Nous prenons appui sur la question : "y a-t-il un droit au bonheur ?" pour envisager les enjeux politiques de la notion de Bonheur. L'analyse de la notion "droit à" conduit au départ à un échec. Si l'on prend la notion de "droit à" au sens faible (droit de...), la notion n'a pas grand sens : elle se borne à énoncer que le bonheur n'est ni interdit, ni obligatoire. Être heureux n'est ni un crime ni un délit, être malheureux non plus ; soit... Si l'on prend la notion de "droit à" dans son sens fort (l'Etat doit me garantir l'accès à l'exercice effectif de ce droit), la notion devient absurde, ou dangereuse. Comment l'Etat pourrait-il garantir le bonheur de tous ? Et l'Etat peut-il décider ce qui peut rendre les hommes heureux ? Nous envisageons une première solution à travers la notion de "droit à la poursuite du bonheur" telle qu'elle figure dans la Déclaration d'indépendance des Etats-Unis. Mais ce droit n'apparaît en fait que comme une reformulation du droit à la liberté : chacun a un droit égal à poursuivre le bonheur comme il l'entend, de vivre conformément à sa conception du bonheur (ce qui implique qu'un individu n'empêche pas les autres de faire de même). Nous envisageons alors une autre possibilité, qui repose sur la distinction entre désirs et besoins. L'Etat n'a évidemment pas pour rôle de satisfaire tous les désirs de tous les individus ; mais ne peut-on considérer qu'il aurait le devoir de permettre à chaque citoyen de satisfaire ses besoins fondamentaux ?
20.12. III) Morale et politique. A) La morale et la justice : le Bien et le Bien commun B) Droit et morale dans une conception paternaliste de l'Etat. Si l'Etat joue le rôle du père à l'égard de ses sujets, alors il doit veiller à la fois à la satisfaction des besoins des individus, mais aussi à leur moralité et (éventuellement) à leur Salut. Dans cette optique, l'Etat doit imposer le respect des normes et des valeurs morales qu'il considère comme valables et légitimes. C) La critique républicaine du paternalisme. On montre que, si l'indivdu est considéré comme étant doté de raison et de conscience, il cesse d'être un sujet pour devenir citoyen : il est capable de déterminer par lui-même ce qui est bon pour lui (sa conception du bonheur), ce qui est conforme au Bien commun (conception de la justice), ce qui est conforme au Bien (sa conception morale). Il devient alors totalement illégitime de la part de l'Etat de lui imposer une conception du bonheur, de la justice ou de la morale : le seul principe légitime est alors celui de la liberté. Chacun doit avoir un droit égal à vivre conformément à sa conception du bonheur, de la justice et de la morale, et l'Etat n'est là que pour garantir cette égalité des libertés (en empêchant un individu d'imposer ses valeurs ou son intérêt à autrui).
 L'Etat est-il un maître d'école pour adultes ?
L'Etat est-il un maître d'école pour adultes ?
D) Politique et religion : le cas de la tolérance. 1) La tolérance selon John Locke. Nous montrons pourquoi, selon Locke, un Etat qui veut imposer une croyance religieuse (a) cherche l'impossible (nous ne choisissons pas nos croyances) (b) fait ce qu'on ne lui demande pas (l'Etat n'a pas été instauré pour des raisons religieuses, mais pour garantir la coexistence pacifique, respectueuse des droits naturels come la propriété privée), et surtout (c) ne fait pas ce qu'on lui demande : car en voulant imposer une croyance, l'Etat suscite de l'opposition violente de la désobéissance civile, de l'insurrection. 2) Morale et tolérance. Nous montrons en quoi les arguments de Locke sont mobilisables pour la question de la morale : un Etat qui voudrait imposer une morale veut l'impossible, fait ce qu'on ne lui demande pas et ne fait pas ce qu'on lui demande (c'est lorsque l'Etat m'impose d'agir contre ma conscience qu'il suscite la révolte). D'où : un Etat républicain doit s'abstenir de toute prise de position dans le domaine moral : le droit ne doit pas viser à faire respecter une morale, mais à garantir la coexistence pacifique dans le respect des droits naturels.

Apppendice : l'action juste est-elle nécessairement morale ? Cette dissociation de la justice et de la morale pose l'épineuse question de l'adéquation entre justice et morale. Combattre l'injustice, est-ce respecter les normes morales ? Nous examinons l'argument de Sartre, selon lequel l'engagement politique peut s'avérer incompatible avec la recherche de la vertu : le combat contre l'injustice peut exiger le recours à des moyens "immoraux", ce qu'illustre la pièce de Sartre, Les mains sales. On illustre la thèse de Sartre avec le recours à la délation volontaire de Résistants par les services secrets britanniques durant la seconde Guerre mondiale (afin de livrer des informations fausses à l'ennemi). Nous terminons avec la critique formulée par Camus : la lutte politique peut-elle contredire dans ses modalités les principes au nom desquels elle prétend combattre ? Peut-on sacrifier la vie d'innocents au nom de la lutte contre la tyrannie ? Illustration avec la pièce Les Justes de Camus.
Bonnes vacances !

Image extraite d'une représentation des Mains sales : le Juste peut-il rester pur ?
17.12. [Distribution du DM : explication du texte d'Alain sur bonheur et travail] Autre mise en perspective du texte : la mise en dialogie avec le propos d'un autre auteur. On choisit Durkheim, selon lequel la conscience est aussi la faculté individuelle porteuse du jugement moral. Mais on montre (1) que pour Durkheim il ne peut pas y avoir de morale naturelle (car il n'existe pas de "nature" de l'homme : toute morale est culturelle ; (2) que pour Durkheim la conscience n'est pas une faculté innée, inscrite dans la nature de chacun, puisque la morale est toujours une production sociale : la conscience morale se forge par la socialisation (éducation, imitation, identification, rôle de la langue) ; (3) qu'il ne peut donc pas y avoir pour Durkheim une morale naturelle universelle, mais des morales culturelles et collectives ; (4) que si chez Rousseau la conscience est ce qui fonde la liberté de l'homme, ce qui lui permet de rompre avec l'influence (corruptrice) de la société, la conscience ne peut pas jouer ce rôle chez Durkheim, puisqu'elle apparaît avant tout chez Durkheim comme l'intériorisation des normes sociales. Durkheim résout donc les problèmes que soulève l'approche de Rousseau (pluralité des morales, diversité culturelle, logique de la tolérance)... mais il soulève des problèmes que Rousseau pouvait résoudre, notamment : (1) comment justifier le fait que la société impose une morale à l'individu ? N'est-ce pas contradictoire avec le principe même de respect de la liberté individuelle... qui est justement le principe-clé de la morale des sociétés occidentales modernes ? (2) comment dès lors imposer le respect des lois, si l'on ne peut plus considérer que les lois sont légitimées par une morale universelle, sont en accord avec "la" conscience ?

....et il est encore plus interdit d'imposer !
13.12. Troisième paragraphe : la conscience est un "instinct divin", qui doit guider la raison. On analyse la dimension "divine" de la conscience, dont nous montrons qu'elle ne doit pas être comprise comme une simple "métaphore". La connaissance du bien et du mal est bien une connaissance divine que l'homme s'est appropriée dans la Bible, mais Rousseau supprime le fait que cette appropriation est un péché (le péché) : si la conscience "rend l'homme semblable à Dieu".... c'est parce que l'homme, comme l'y a invité le serpent, a voulu se rendre semblable à Dieu, ce qui est le péché par excellence ! Nous montrons également la dimension polémique de l'affirmation selon laquelle, sans la conscience, la rason ne peut que "s'égarer d'erreurs en erreurs". La raison est une faculté des moyens (elle nious indique les moyens les plus efficaces d'atteindre un but) et non des fins selon Rousseau ; sans la tutellede la conscience, la raison peut donc nous indiquer comment atteindre efficacement un but moralement barbare. Ceci contredit la vision unitaire du "progrès", mais correspond beaucoup à ce que le 20 siècle (et notamment le nazisme) va faire apparaître.

On oublie parfois ce qu'était Réellement le fruit défendu...
Méthdologie de la conclusion, et application. 1ere piste de discussion (problématisation du propos de l'auteur) : est-il raisonnable d'admettre l'existence d'une morale naturelle universelle ? Coment rendre compte dans ce cas de l'extraordinaire diversité des morales ? Et comment maintenir la validité universelle de l'une d'entre elles, sans légitimer des postures colonialistes, impérialistes ? Illustration du dilemme avec le cas de l'excision : les pratiques tribales sont-elles "barbares" ?
10.12. Application de la méthodologie du dévelopement au texte de Rousseau. Premier paragraphe : la conscience comme faculté naturelle, et donc innée, de justice et de vertu (en quoi peut-on dire que la conscience est naturelle ? en quoi peut-on considérer les pincipes de la morale comme naturels ? L'exemple du monstre). Second paragraphe : la conscience morale n'est pas de l'ordre du jugement, mais du sentiment (le cas de la pitié comme sentiment moral naturel ; bonne conscience et mauvaise conscience sont des sentiments).

06.12. Méthodologie de l'explication de texte. Parcours préparatoire. Construction d'une introduction : a) Auteur, oeuvre, date b) thème c) question d) thèse e) étapes du texte. Précisions concernant le "plan" du texte : il s'agit bien de reconstituer et de faire apparaître la logique d'un raisonnement. Construction d'un développement : le séquençage du texte, les 4 étapes de l'explication : a) reformulation et analyse des mots-clé, b) justification, c) illustration, d) retour à la thèse du texte. Application de la méthodologie au texte de Rousseau sur la conscience morale : la morale comme faculté morale naturelle. Construction de l'introduction.
03.12.3) L'approche déontologique... et ses limites (Kant contre Benjamin Constant). Mise en lumière des problèmes communs : a) nous sommes renvoyés à un autre critère (qu'est-ce qu'une "bonne" conséquence ? une "bonne" intention, etc. b) nous sommes portés à légitimer moralement des comportements qui semblent condamnables. La question du critère de la morale pose donc problème.
29.11. II) La morale. A) Définitions (morale, devoir) B) Quel est le critère d'un jugement moral ? Confrontation des différentes réponses, et critique. 1) L'approche conséquentialiste... et ses limites 2) L'approche intentionnaliste... et ses limites.
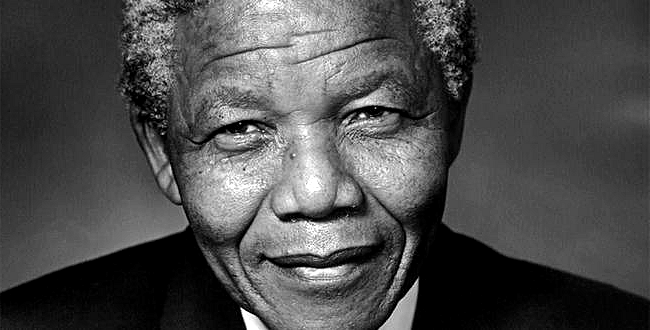
Une morale conséquentialiste : Nelson Mandela, selon lequel il n'y a rien de moral dans le fait de mobiliser des moyens inefficaces pour lutter contre l'injustice.
26.11. Seconde critique de la doctrine épicurienne : que deviennent les désirs individuels dans la sagesse ? Si un désir est propre à l'individu, alors il ne s'agit pas d'un désir naturel ; le bonheur exige-t-il le renoncement à tous les désirs qui sous sont ptopres ? Exigerait-il un renoncement à ce qui fait notre unicité ? Extension de la notion de besoin : est un besoin pour l'homme ce qui lui est nécesaire pour rester ce qu'il est (un homme : besoins physiologiques, besoins culturels), mais aussi pour être celui qu'il est. Le retour aux besoins impliquerait donc la prise en compte de nos désirs identitaires : Nietzsche. Le bonheur est tentative de réaliser les désirs qui sont constitutifs de notre identité, humaine et individuelle (les autres, ceux qui nous sont imposés par le conformisme social, sont à rejeter). Mise en relation du bonheur et de la liberté : le bonheur exige de savoir ce que nous sommes (ce qu'est notre nature), et de devenir qui nous sommes (de chercher et de réaliser notre identité).

22.11. Applications contemporaines du principe épicurien : la simplicité volontaire : la recherche du bonheur comme recherche d'une vie en conformité avec notre identité (et donc ausi avec nos idées et nos valeurs). Critique de la société de consommation comme société de frustration (analyse du rôle de la publicité) et de culpabilité (relation de la consommation de masse avec l'exploitation de l'homme par l'homme, et la destruction des ressources naturelles). Pour être heureux, il faut donc réapprendre à nous satisfaire de ce dont nous avons réellement besoin. Analyse de la notion de besoin : est un besoin pour une chose ce qui lui est nécessaire pour rester conforme à sa nature (remplir sa fonction pour un objet technique, rester vivant pour être vivant) ; mais les besoins de l'homme ne se limitent pas aux "désirs primaires" : ils intègrent l'ensemble des facteurs qui permettent à l'homme de réaliser son humanité. On peut donc intégrer à la recherche du bonheur la recherche de la satisfaction des besoins culturels.

19.11. Eléments de corrigé du DM. 3) La solution épicurienne. La typologie épicurienne des désirs. La maîtrise des désirs. Le bonheur comme retour à la = notre nature. Synthèse : la méthode du bonheur consiste à apprendre à ne désirer que des désirs naturels (et nécessaires).
15.11. Deuxième chapitre : Bonheur et Morale. I) Le bonheur A) Définitions (bonheur, plaisir, désir) B) Le bonheur exige-t-il la réalisation de tous nos désirs ? 1) Première réponse : dans la mesure où le bonheur exclut la frustration, il semble exiger que l'on cherche à satisfaire tous nos désirs 2) Contre-réponse : la recherche d'une satisfaction de tous les désirs conduit à l'échec (frustration, angoisse, culpabilité)
12.11. d) les raisons politiques de croire en la liberté. La notion d' "idée-force" (Alfred Fouillée) nous indique en quoi la croyance en la liberté peut être une croyance qui tend à se donner raison à elle-même. Celui qui ne croit pas en la posibilité de la liberté se donnera raison à lui-même, car aucune libération n'est possible pour celui qui se résigne à la soumission ; en revanche, un peuple (ou un individu) qui croit en la possibilité de son émancipation se donne raison à lui-même : il rend la liberté possible (mais non certaine !) en mettant en oeuvre les conditions de sa libération. Nous ilustrons cette affirmation avec le cas des "Printemps Arabes". Nous cherchons à préciser ce que sont ces conditions, ce qui nous conduit au rôle de la confiance et de l'espérance. Ce sont donc d'abord cette confiance (mutuelle des individus) et cette espérance qu'un pouvoir dictatorial doit détruire pour maintenir sa domination. Bilan.

V pour Vendetta, encore : la sacralisation de la sécurité est-elle la voie de la tyrannie?
08.11. C) La remise en cause du déterminisme. 1) La critique sartrienne : choix et situation. On développe l'argumentaire sartrien en prenant appui sur le contexte de l'Occupation : pourquoi la liberté y était-elle maximale ? En quoi sommes-nous "condamnés" à être libres ? Mise en actualité : le choix d'un boat-people est-il libre ? On montre que c'est précisément le fait qu'il le soit qui éclaire le tragique de sa situation. Inversement, on souligne le choix que nous avons à opérer. 2) Les raisons de croire en la liberté. a) les raisons juridiques (la liberté comme condition de la responsabilité) b) les raisons morales (la liberté comme condition de possibilité de la morale : la croyance en la liberté comme devoir moral : Kant) c) les raisons religieuses : analyse du problème que pose la question de la liberté dans le domaine religieux : un dieu cruel (la damnation : analyse de la notion de prédestination chez Luther) responsable du mal commis par l'homme , ou un dieu impuissant (Hans Jonas).

Ivan Karamazov discutant avec son frère : "je me prépare à rendre mon billet à Dieu..."
05.11. Fin de l'analyse du capital culturel et bilan. On pose la question de la "culture populaire" : peut-on enbcore parler aujourd'hui de culture populaire ? On examine la critique effectuée par Pasolini (la destruction de la culture populaire par les médias de masse). La légitimation de la reproduction sociale par le système scolaire républicain.
18.10. Analyse n° 2 : la réussite scolaire reste (notamment en France) fortement liée à l'origine sociale. Essais d'explication (on prend appui sur les analyses de Bourdieu) : rôle du capital économique, du capital social et du capital culturel dans la réussite scolaire. On développe le cas du capital culturel.
![]()
15.10. 3) L'enjeu de l'école pour le déterminisme social. a) la reproduction sociale dans la société d'Ancien Régime : son caractère incompatible avec la liberté b) le rôle de l'école dans le système républicain : casser la reproduction sociale en rendant la réussite sociale dépendante du mérite. c) l'école joue-t-elle son rôle ? Analyse n° 1 : la réussite sociale est (en France : appui sur les statistiques de l'INSEE) fortement corrélée à la réussite scolaire.
Dissertation à rendre pour le 15 novembre (et non le 12, comme indiqué sur le sujet), à partir du dossier-support. (cliquez sur le lien pour le télécharger)
11.10. B) Le déterminisme social. 1) Illustrations (habitudes, idées, désirs, croyances, valeurs... on développe le cas des pratiques vestimentaires et des croyances religieuses). 2) Principes du déterminisme social : Durkheim. La norme sociale comme norme contraignante. 2 photos de classe pour illustrer un changement de norme vestimentaire en 10 ans (regardez l'évasement des pantalons... et le nombre d'exceptions) :


(pour changer un peu du lycée Aiguerande...)
08.10. 6) Déterminisme corporel et déterminisme matérialiste. Retour sur le matérialisme des Lumières (Helvétius, d'Holbach) : le matérialisme aboutit bien au déterminisme, mais pas au réductionnisme corporel ; le cerveau n'est pas envisagé indépendamment du corps, et le corps est indissociable de son milieu (qui le façonne). C'est alors l'environnement social qui devient primordial, d'où l'importance accordée par Helvétius à l'éducation. On ne rétablit pas la liberté, mais on fait entrer une dimension sociale dans le déterminisme.
04.10. II) La liberté n'est-elle qu'une illusion ? A) Le déterminisme matérialiste. 1) Définitions (esprit, matière, déterminisme). 2) Approches du déterminisme corporel (anti-dépresseurs, déterminisme génétique, etc.) 3) Principes théoriques (le déterminisme cérébral, Gall) 4) Applications : destruction de la liberté et de la responsabilité (Lombroso). 5) Critique du déterminisme corporel. a) Critique scientifique (critique du réductionnisme) b) Critique politique : une théorie dangereuse (racisme, eugénisme, euthanasie à la fin du XIX° siècle

Les collections de Lombroso (en photo au centre)
01.10. 4) Les deux impératifs de la liberté. Ceci nous conduit à deux impératifs. Le premier découle du fait que, si l'acte libre est celui qui est déterminé par ce que JE pense, ce que JE crois, celui qui exprime des désirs qui sont réellement LES MIENS, bref : celui qui exprime ma véritable identité, alors je ne peux être libre... que si j'ai d'abord découvert cette identité. Le premier impératif est donc "connais-toi toi-même" (nous distingons en cours les deux sens possibles de cette formule, qui peut aussi bien avoir un sens universaliste, comme chez Socrate, qu'un sens individuel). Mais il ne suffit pas de savoir qui je suis pour être libre : il faut encore que cette dientité, que j'ai découverte, soit mise en oeuvre dans ma vie. Je dois réaliser cette identité par mes actes : une vie libre est celle qui exprime et réalise mon identité. Le second impératif est donc celui de Nietzsche : "Deviens qui tu es" : réalise par ta vie cette identité que tu découvres comme étant réellement la tienne.

Un psychanalyste qui avait beaucoup lu Nietzsche : Carl Gustav Jung
27.09. B) La liberté comme travail.
1) Un exemple : le droit de vote. Le vote n'a de sens que s'il est libre. Mais un vote libre n'est pas seulement un vote qui n'est pax contraint, c'est un vote qui exprime ce que je pense. Or je ne peux pas savoir "ce que je pense" en politique, avant d'avoir fait l'effort de penser. J'aurai découvert "ce que je pense" en politique une fois que j'aurai fait le travail de collecte de l'information, de confrontation des argumentaires, de participation au débat public qui me permet de former mon propre jugement. Le vote "spontané" est donc tout le contraire du vote libre ; c'est un vote qui n'exprime que mon "opinion" telle qu'elle est déterminée par mon milieu, les médias, etc. Ne peut être libre que celui qui a fait l'effort de penser par soi-même.
La formule (d'Horace, et reprise par Kant) qui marque la route qui conduit vers nous-mêmes : ose penser par toi-même.
2) Liberté et valeurs. Être libre, c'est agir "en conscience", suivre sa conscience. Mais que me dit ma conscience ? Là encore, je ne peux pas le savoir avant d'avoir fait l'effort de réflexion critique qui me permet de déterminer ce que sont MES valeurs. Mes valeurs "spontanées" ne sont pas les miennes, ce sont celles qui m'ont été transmises par mon milieu, mon éducation, etc. Cela vaut aussi bien dans le domaine moral que dans le domaine religieux : comment déterminer ce en quoi JE crois, si je ne mets jamais à distance les croyances que l'on m'a inculquées, si je n'explore pas d'autres croyances, etc. ?
3) Liberté et désirs. Être libren ce n'est pas suivre tous ses désirs, mais cela n'implique pas que l'on renonce à tous nos désirs. En revanche, je ne suis libre que si les désirs que cherche à satisfaire sont réellement les miens, et non ceux qui me sont imposés par mon éducation, par le système publicitaire, etc. Pour être libre, il faut donc que je commence par effectuer le travail qui me permettra de découvrir ce que sont mes véritables désirs. Le travail-type est ici le voyage, aussi bien intérieur qu'extérieur, qui me permet en parcourant le monde de me découvrir moi-même. Là encore, obéir à nos désirs "spontanés", cela n'a rien à voir avec le fait d'être libre : obéir à nos désirs spontanés, c'est le meilleur moyen de rester soumis aux désirs qui nous sont imposés.
Vous pouvez retrouver une version en ligne (développée) du cours sur liberté, raison et conscience en cliquant ici.
24.09. Exercice à rendre pour le 15.10: rédiger (sur la base du corrigé d'introduction distribué) les parties I et II du développement du sujet : "La liberté s'oppose-t-elle à l'égalité?"
4) Raison ou conscience ? Les enjeux d'un débat.
Nous avons dit que le,droit français, qui insistait sur le fait que tous les hommes sont dotés de raison et de conscience, les réunissait ensuite sous le terme de discernement. Pourtant, la question de savoir à quelle faculté on doit accorder la primauté a des enjeux importants. Pour Socrate ou Platon, c'est par l'usage de la raison que je peux savoir ce qui est légitime ou non. Bien raisonner, c'est savoir ce qui est juste ; et donc agir de façon rationnelle, c'est nécessairement être juste. Il y a donc, pour Socrate et Platon, un lien nécesaire entre raison et justice : celui qui raisonne juste agit justement. Le sage est celui qui, étant pleinement rationnel, est toujours raisonnable.
Cette idée jalonne toute l'histoire de la pensée occidentale ; on la retrouve dans l'Humanisme de la Renaissance (pour Erasme, celui qui raisonne bien, agit bien, et si leshommes sont méchants, c'est parce qu'ils sont fous), dans le rationalisme du XVII° siècle (pour Spinoza, la liberté consiste à suivre sa raison, et celui qui suit sa raison ne peut vouloir le mal), dans la philosophie des Lumières au XVIII° siècle (pour Kant, être libre c'est obéir à la raison, et celui qui obéit à la raison ne peut être immoral).
Pourtant, dans la pensée des Lumières, on voit surgir une opposition. Le terrain de cette opposition, c'est avant tout l'Histoire. Car si l'on admet que l'homme, en devant plus rationnel, devient nécessairement meilleur (du point de vue de la justice, de la morale), alors il semble que l'on puisse considérer l'Histoire comme un vaste processus au cours duquel l'Homme est devenu meilleur : l'Histoire est un progrès, au cours duquel l'homme passe d'un état primitif, barbare, à l'état de culture, de civilisation, où il est à la fois plus savant et plus juste. Il y a incontestablement eu un progrès de la raison dans le domaine du savoir : les connaissances humaines sont devenues de plus en plus rationnelles, pour enfin devenir scientifiques. Il y a incontestablement eu un progrès de la rationalité dans le domaine de la technique : les techniques humaines sont devenues de moins en moins magiques, empiriques, intuitives, pour devenir scientifiques avec les technologies (une technologie, c'est une technique fondée sur un savoir scientifique).

Mais lors, si l'on admet l'équation rationalité - justice, il faut admettre que l'homme, en devenant ainsi plus savant, plus rationnel, est nécessairement devenu plus juste, plus moral, meilleur.Il faudrait donc adjoindre au progrès scientifique, au progrès technique, un progrès éthique (social, politique, moral).
Or c'est justement cela que Rousseau remet en cause. Pour Rousseau, l'homme est incontestablement devenu plus savant, meilleur technicien, etc. Le progrès scientifique et etchnique, en tant que progrès de la rationalité, est indéniable. Mais l'homme n'est pas devenu meilleur pour autant. Il faut donc différencier radicalement le progrès de la raison (dans ses applications scientifiques et techniques) et le progrès de la justice et de la morale. Qu'est-ce à dire ? La justice et la morale ne seraient-elles donc pas fondées sur la raison ?
Pour Rousseau, la raison est la faculté qui nous permet de connaître et de mettre en oeuvre les moyens les plus efficaces (les plus rationnels) d'atteindre un but, un objectif, une fin ; mais elle ne peut pas nous dire quelle fin nous devons poursuivre. Si bien que la raison peut très bien nous dire comment atteindre efficacement un but horrible : c'est ce qu'illustrera au XX° siècle la "solution finale" nazie, processus horriblement rationnel, fondé sur la science et la technique les plus modernes. Ce n'est donc pas la raison qui doit commander chez l'homme, et il ne suffit pas d'être rationnel pour être juste. La raison doit être soumise à la tutelle de la conscience.

On peut donc dire que, pour Rousseau, la véritable liberté consiste bien à suivre les facultés qui font de nous un être humain ; mais la faculté ultime est la conscience. Je suis libre quand j'agis conformément à ma volonté, quand ma volonté est éclairée par ma raison, qui doit être dirigée par la conscience. Pour Rousseau, être libre, c'est suivre sa conscience. Ce n'est qu'à cette condition que l'on peut rétablir l'équation de la liberté et de la vertu : celui qui sera pleinement libre suivra toujours sa conscience, et celui qui suit toujours sa conscience ne sera jamais immoral.
20.09. Corrigé de l'introduction (distribution d'un corrigé rédigé analyse en classe). Introduction "de rattrapage" pour ceux qui le souhaitent : "La liberté est-elle un droit ?"
Chapitre 1 : la liberté. I) Qu'est-ce qu'être libre ?
A) Définition de la liberté.
1) Définition initiale. Nous partons de la définition commune: être libre, c'est "faire ce que l'on veut" : ne serait donc libre que celui qui peut faire tout ce qu'il veut, et qui n'est jamais obligé ou contraint de faire ce qu'il ne veut pas.
2) Critique. Nous montrons que cette définition rencontre de sérieuses difficultés : puis-je me considérer comme "non libre" parce que je ne peux pas être immortel ? parce que je ne peux pas remonter dans le temps ? parce que je ne peux pas m'envoler ? etc. La liberté n'aurait alors pas de sens pour l'homme : seul (un) Dieu pourrait être libre. Par ailleurs, cette caractérisation passe sous silence une distinction très importante : celle qui distingue la volonté et le désir. Je peux vouloir arrêter de boire (de l'alcool), de fumer, je peux vouloir être fidèle... sans cesser de désirer boire, fumer, ou sans cesser d'être tenté par l'infidélité. Il peut donc y avoir opposition entre volonté et désir. En quoi consiste alors la liberté ? Nous montrons que celui qui est incapable de résister à ses désirs pour suivre sa volonté n'est pas libre, il est dépendant, il est l'esclave de son désir, qu'il ne peut pas maîtriser, qui s'impose à lui et auquel il ne peut résister : il est donc soumis à ses désirs, c'est le contraire de la liberté. Au contraire, est libre, maître de lui-même celui qui sait résister à ses désirs pour accomplir sa volonté. La question est alors de savoir à quoi nouis obéissons quand nous suivons notre volonté. Nous avons montré que ce qui détermine la volonté, ce que je veux, ce sont les facultés qui me permettent de déterminer ce en quoi consiste "le meilleur choix" : le choix le plus intelligent, le plus pertinent, le plus stratégique, le plus efficace, le plus adapté. C'est la raison qui me permet de déterminer ce choix le plus "intelligent", le plus rationnel. Mais le choix le "meilleur", c'est aussi celui qui m'apparaît comme le plus juste, le plus légitime, le plus en accord avec mes valeurs : c'est alors la conscience (morale) qui entre en jeu.

3) Nous pouvons donc préciser notre définition de la liberté : est libre celui qui peut agir conformément à sa volonté, c'est-à-dire conformément à sa raison et sa conscience. Est libre celui qui obéit à ces deux facultés qui font de lui un être humain. On comprend alors l'importance de la raison et de la conscience aux yeux du droit. Ce qui fait de moi un sujet de droit, un être qui a des droits et des devoirs, c'est que je suis un être responsable de mes actes ; or ce qui fait que je suis responsable de mes actes, c'est que je suis libre ; or ce qui fait que je suis libre, c'est que je suis "doté de raison et de conscience", comme le proclame la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (ONU, 1948). Ne peut donc être considéré comme un sujet de droit, libre et responsable, qu'un être doté de raison et de conscience. Ceci apparaît notamment dans la question de la responsabilité pénale : le seul critère que reconnaît le droit français pour déclarer un être pénalement responsable de ses actes (et pouvant donc pêtre puni s'il transgresse la loi), c'est le "discernement", qui regroupe la raison (capacité d'analyser la situation, d'anticiper les conséquences d'un acte, etc.) et la conscience (capacité à différencier le bien du mal, le permis de l'interdit, etc.) Les animaux (pas de discernement) ne sont pas pénalement responsables ; et un être humain devient pénalement responsable à partir du moment où on lui reconnaît un discernement : seul peut être déclaré pénalement irresponsable celui dont le discernement était aboli au moment des faits. La liberté étant la capacité à suivre la raison et la conscience, ne peut être considéré comme libre, et donc responsable, que celui qui est doté de ces deux facultés.
Pour une étude juridique un peu plus approfondie de ce point (responsabilité pénale et maladie mentale), vous pouvez cliquer ici.

17.09. Suite de l'application au sujet témoin (dernière partie et conclusion) : la loi et le principe républicain (seule la liberté limite la liberté), la loi et l'intérêt général (Rousseau et la volonté générale) Fin de l'application de la méthodologie : que faire lorsque la loi ne respecte pas les conditions qui lui sont fixées ? Qu'est-ce qu'être libre face à une loi qui viole les libertés ? Analyse de la réponse donnée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (la résistance à l'oppression).
13.09. Application au sujet témoin. Analyse des termes + première et deuxième partie : en quoi les lois font-elles obstacle à la liberté ? en quoi les lois sont-elles nécessaires à la sauvegarde des libertés (Spinoza) ? Exercice à rendre : rédiger l'introduction du sujet : "la liberté s'oppose-t-elle à l'égalité ?"
10.09 : Application de la méthodologie de l'introduction à un sujet témoin (les lois s'opposent-elles à la liberté ?). Méthodologie de la dissertation (2). Présentation des consignes méthodologiques du développement : l'analyse des termes du sujet, la construction des paragraphes argumentatifs.
06.09.2018: Présentation de la discipline, du programme, des épreuves du bac et du site internet. Méthodologie de la dissertation (1). Présentation des consignes méthodologiques de l'introduction