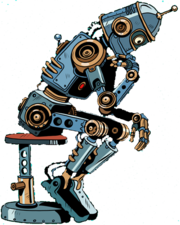Données personnelles et sécurité
Bases de données personnelles et politiques de sécurité :
une protection illusoire ?
[Extrait]
Article de Sylvia Preuss-Laussinotte, paru dans la revue Cultures et Conflits, 64 « Identifier et surveiller », Hiver 2006.
Article intégral disponible à l’adresse : http://conflits.revues.org/index2133.html
La sécurité, concept juridique contesté ?
L’aspect juridique de la notion de sécurité est rarement évoqué : elle est généralement renvoyée à des analyses de type sociologique ou de philosophie politique. On ne peut pourtant pas aborder les questions posées par les fichiers de sécurité sans tenter de cerner son sens juridique.
Il nous semble utile en préliminaire de relever un contre-sens qui tend à se répandre, et qui figure de longue date dans les discours des hommes politiques pour justifier les mesures de restriction aux libertés au nom de la sécurité : l’existence d’un prétendu « droit à la sécurité ». On relève parfois même une confusion entre « droit à la sûreté » (article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789) et un prétendu « droit à la sécurité », alors que ces deux notions sont antinomiques. En effet, dans une interprétation stricte, le droit à la sûreté renvoie à l’Habeas corpus anglais, si malmené au Royaume-Uni depuis les attaques terroristes et la nouvelle politique sécuritaire anglaise ; il interdit toute arrestation, toute détention arbitraire et se concrétise par l’obligation de présenter la personne arrêtée dans les plus brefs délais devant un juge qui statuera sur une éventuelle détention. Jean Rivero en donne une définition plus générale, qui la situe clairement dans la confrontation de l’individu au pouvoir :
« La sûreté est beaucoup plus qu’une liberté particulière ayant un objet déterminé […] elle est, plus largement, la garantie de la sécurité juridique de l’individu face au pouvoir. […] La sûreté constitue donc la protection avancée de toutes les libertés : c’est elle qui permet leur exercice paisible 18 ».
Thomas Hobbes, qui a théorisé de la manière la plus radicale l’importance de la sécurité dans le contrat social, l’a clairement décrite comme un attribut de l’Etat. C’est en échange de l’abandon par les hommes de toutes les libertés qu’ils possédaient dans l’état de nature – l’absence de limite à ces libertés entraînant une insécurité permanente – que le Leviathan va assurer leur sécurité, qui est au fondement même du contrat social. Hobbes ne reconnaît qu’une seule réserve à cet abandon général des libertés au Prince : le droit à la sûreté, autrement dit l’interdiction des arrestations et détentions arbitraires, seul droit que les hommes conservent.
Il ne s’agit pas ici d’un débat sur les notions générales de sûreté et de sécurité, bien difficile, mais sur la notion juridique de « droit à la sûreté », qui est très claire, et d’un prétendu « droit à la sécurité » extrêmement dangereux par le risque de confusion qu’il entraîne entre les domaines de la protection des droits et celui de la sécurité. Il est donc inquiétant de voir réapparaître aujourd’hui ce prétendu « droit à la sécurité », pourtant conceptuellement opposé aux droits fondamentaux. Est-il besoin de rappeler que dans tous les textes internationaux de protection des droits, la sécurité est toujours entendue comme autorisant l’Etat à restreindre les droits et libertés ? Ainsi, la sécurité est citée dans la Cour européenne des droits de l’Homme comme autorisant des restrictions par l’Etat à un ensemble de libertés et permettant même dans des cas extrêmes (état d’urgence, conflits, etc.) d’y déroger, sauf quatre hypothèses prévues à l’article 15 : droit à la vie (article 2), interdiction des tortures et peines ou traitements inhumains ou dégradants (articles 3), interdiction de l’esclavage et de la servitude (article 4), non rétroactivité de la loi pénale (article 7). C’est d’ailleurs ce dilemme qui est au cœur des débats actuels : jusqu’où la sécurité autorise-t-elle des atteintes aux droits fondamentaux sans atteindre, voire détruire, l’essence même de l’Etat démocratique ? Les expériences totalitaires qui se sont toutes fondées sur le droit pour accompagner leurs dérives en arguant de la sécurité doivent faire réfléchir.
[…]
La grande question qui reste posée est néanmoins celle-ci : pourquoi, connaissant pertinemment les fragilités des bases de données personnelles, les risques connus d’erreurs, de détournement, les Etats ou les organisations comme l’Europe pratiquent-ils cette surenchère en matière de fichiers de sécurité, dont le coût est considérable, surtout depuis l’intégration des éléments biométriques, et qui nécessitent des procédures de maintien permanentes, confiées à des entreprises privées, augmentant d’autant les risques ? On retrouve bien évidemment l’ancienne obsession du contrôle des populations, désormais affiné au point de penser parvenir à un contrôle minutieux et personnalisé de chaque individu ; mais la justification de cette fuite en avant dans des systèmes très coûteux est avant tout fondée sur la croyance en un résultat : celle de la prévision fiable, et donc la prévention possible, des risques sécuritaires de quelque horizon qu’ils viennent.
Ajouter un commentaire