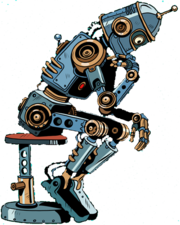Anne-Cécile Robert
"Liberté, c'est de ces détestables mots qui ont plus de valeur que de sens, qui chantent davantage qu'il ne parlent", a pu écrire Paul Valéry. Il est vrai que l'idée de liberté, ou la simple évocation de son nom, a été utilisée pour justifier toute sorte d'attitudes et de mesures, parfois carrément liberticides. […] Pourtant, si le mot liberté chante souvent davantage qu'il ne parle, la civilisation occidentale - pour ne parler que d'elle - était progressivement parvenue, à partir de la Renaissance augmentée des Lumières, à une définition commune de la liberté. Cette définition se traduisait, en particulier, par un corpus de droits (civiques et politiques) que transcrivent bien les différentes déclarations des droits de l'homme (1789, 1948) ou la convention adoptée par le Conseil de l'Europe en 1951. Cette reconnaissance formelle des libertés n'était, bien sûr, pas exclusive d'un débat sur leurs frontières ou leur dépassement. […].
Cependant, au-delà de ces débats, les grandes démocraties occidentales s'accordaient sur un socle de libertés dont la caractéristique consistait grosso modo à placer l'individu titulaire de droits au centre de l'organisation sociale. Il pouvait, bien sûr, survenir des périodes de régression comme la guerre d'Algérie avec la censure et la suspension des droits fondamentaux. Il pouvait aussi exister des poches de non-droit : tribunaux d'exception, régimes temporaires de mise à l'écart des libertés comme l'Etat d'urgence (Nouvelle-Calédonie, 1984, ou Irlande du Nord), statut juridique de certaines catégories d'individus comme les femmes, qui furent, jusqu'aux lois Roudy sur l'égalité professionnelle ou matrimoniale, les inférieures légales des hommes. Ces questions alimentaient un débat public plus ou moins vif suivant les sujets et les époques et articulaient la pensée sur le progrès. Mais la référence restait la même.
La grande nouveauté de la période mondialisée réside donc, non pas dans la formidable régression des libertés publiques insufflée par l'idéologie sécuritaire, mais dans le fait que cette régression soit théorisée, justifiée et organisée par les appareils traditionnels de la démocratie (intellectuels, classe politique, corps intermédiaires...). En outre, ce recul est en voie de fossilisation par le jeu des traités internationaux ou des mécanismes de la construction européenne. Le socle des droits politiques que l'on croyait relativement solide se trouve aujourd'hui rongé, mité, miné par des valeurs concurrentes et progressivement dominantes : la sécurité, mais aussi les "valeurs" issues du monde économique ou technique (la liberté des marchés compte davantage que celle des individus). L'enjeu n'est plus le dépassement ou les frontières des libertés, mais leur sauvegarde même face à ce qui apparaît comme un véritable renversement des valeurs.
Extrait de Javert, la revanche, « Manière de voir » 10/2003 (n°71), p. 94-95, un article de Anne-cécile ROBERT (membre du Comité de rédaction du Monde Diplomatique)
La totalité de l’article est disponible en ligne (version payante) sur le site du Cairn (wwww.cairn.info)
Ajouter un commentaire