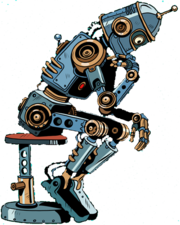Révolution cartographique 20
Nous avons vu avec l'Affaire des Chinois la manière dont la découverte des nouveaux mondes avait fait naître, au sein de l'espace religieux, des questions et des problèmes inédits ; et nous avons indiqué que ces problèmes étaient en fait annonciateurs d'une évolution philosophique fondamentale dans la pensée européenne, qui trouvera un aboutissement dans la pensée des Lumières au XVIII° siècle.
A cet égard, il faut prendre garde à un principe très important quand on fait de l'histoire culturelle : plutôt que de partir d'une époque pour en retrouver des "antécédents" dans les siècles antérieurs, il est souvent préférable de partir de l'émergence d'une idée pour, ensuite, l'éclairer à la lumière de ce qu'elle est devenue. Le mieux est souvent de suivre un cheminement, un parcours, tel qu'il s'est constitué historiquement, plutôt que de vouloir aller à contre-courant. Ainsi, il est trompeur de partir du "bon sauvage" des Lumières pour en retrouver des "précurseurs" à la Renaissance. L'amérindien du XVI° siècle n'est pas le brouillon, l'esquisse du Tahitien de Diderot ; mais le Tahitien de Diderot est bel et bien l'héritier, le descendant philosophique du "sauvage" de la Renaissance.
Quelles sont alors les tendances philosophiques qui émergent dans la pensée de la Renaissance et de l'âge classique du fait de la révolution géographique, et qui trouveront des prolongements dans la pensée des Lumières ?
Nous en examinerons quatre, qui sont d'ailleurs liées entre elles, même si ellles peuvent à l'occasion s'oppose : le scepticisme, le déterminisme, le relativisme, et la tolérance.
A. Révolution géographique et scepticisme
La révolution géographique conduit à une remise en cause de croyances que l'on considérait comme des certitudes absolues ; or si ce qui paraissait évident hier est aujourd'hui réfuté, ne doit-on pas envisager l'hypothèse selon laquelle ce qui nous paraît certain aujourd'hui pourrait se trouver réfuté... demain ?
Il ne s'agit pas ici seulement d'un raisonnement logique, ou analogique. La tendance est plus profonde. En montrant que les certitudes d'hier pouvaient être récusées aujourd'hui, les révolutions qui se produisent à la Renaissance tendent à faire basculer la pensée dans l'histoire : en lieu et place de vérités absolues, éternelles et universelles, on voit apparaître des croyances liées à des époques. Au lieu d'une vérité éternelle, on voit donc émerger une histoire des croyances.
Il ne s'agit plus de dire que, Augustin ayant affirmé qu'il n'y avait pas d'hommes dans la zone équatoriale, il n'y a pas d'hommes situés dans la zone équatoriale. Il ne s'agit plus de dire que, Aristote ayant affirmé que les dauphins ne mangent que sur le dos, les dauphins ne mangent que sur le dos. Certes, ni Aristote, ni Augustin ne changeront d'avis ; mais ils ne sont plus, désormais, les (seuls) critères de la vérité. L'expérience est devenue décisive, et l'expérience, elle, varie en fonction des époques. Nous avons désormais découvert qu'il y avait des hommes dans les régions équatoriales. Ce qui était une vérité affirmée par Aristote apparaît désormais comme une croyance des hommes du passé. Une vérité absolue a laissé la place à une croyance historiquement située.
Mais alors : ce que nous considérons comme un savoir certain ne serait-il, lui aussi, qu'une croyance de notre époque ? Nos certitudes ne seraient-elles... que les croyances réfutées de demain ?
Ce "doute" devant la valeur de nos certitudes, c'est chez Montaigne qu'il s'est exprimé le plus clairement. Dans les Essais, si nous pouvons réfuter les Anciens, ce n'est pas parce que, nous, nous avons raison : c'est parce que, eux, ils se trompaient. Et le fait même que nos plus illustres ancêtres (nous parlons d'Aristote, de Ptolémée et d'Augustin !) se soient trompés... doit nous conduire à admettre l'hypothèse selon laquelle nous pouvons en faire autant. Nos expériences, nos observations réfutent les savants du passé : mais pourquoi les expériences, les observations du futur ne viendraient-elles pas mettre à bas les convictions d'aujourd'hui ?
Il faudra plusieurs siècles pour que toutes les conséquences du recours à l'expérience soient tirées ; en fait, on peut admettre que ce n'est qu'au XX° siècle, avec des théoriciens comme Karl Popper, qu'on admettra définitivement la thèse selon laquelle, puisque le savoir scientifique prend appui sur des expériences... il ne peut jamais y avoir de certitude absolue dans le domaine des sciences ! Car des observations futures peuvent venir démentir les théories d'aujourd'hui.
A la Renaissance, nous n'en sommes pas là. Montaigne n'est pas Karl Popper. Mais ce qui est déjà là en revanche, c'est la possibilité du doute. Il faut ici citer le texte (très connu) de Montaigne, tiré des Essais (Apologie de Raymond Sebon) :
« Ptolemeus, qui a été un grand personnage, avait établi les bornes de notre monde. Tous les philosophes anciens ont pensé en tenir la mesure, sauf quelques îles écartées qui pouvaient échapper à leur connaissance. C'eût été pyrrhoniser [Pyrrhon était un philosophe grec de l'Antiquité, qui remettait en cause toute certitude], il y a mille ans, que de mettre en doute la science de la cosmographie et les opinions qui en étaient reçues d'un chacun. Voilà, de notre siècle, une grandeur infinie de terre ferme, non pas une île ou une contrée particulière, mais une partie égale à peu près en grandeur à celle que nous connaissions, qui vient d'être découverte. Les géographes à cette heure ne faillent pas d'assurer que meshuy tout est trouvé et que tout est vu. Savoir mon, si Ptolémée s'y est trompé autrefois sur les fondements de sa raison, si ce ne serait pas sottise de me fier maintenant à ce que ceux-ci en disent. »
Les scientifiques d'hier affirmaient comme une certitude... ce qui a été réfuté ; comment ne pas douter de ce que les scientifiques d'aujourd'hui considèrent comme certain ?
Les découvertes géographiques nous amènent donc à envisager nos propres certitudes comme des croyances, susceptibles d'être erronées. Mais ce doute rejaillit à son tour sur le sens qu'il convient de donner à la découverte d'autres cultures. Car ce que dévoilent ces découvertes, c'est que d'autres hommes, vivant à la même époque, ont des idées différentes. Il ne s'agit plus ici de la confrontation historique du savoir ancien et du savoir moderne, mais de la confrontation géographique entre ce que l'on pense ici et ce que l'on pense ailleurs. Mais si nous admettons que nous pouvons nous tromper, comme nos plus dignes ancêtres l'ont fait, comment affirmer avec certitude que ces autres peuples sont dans l'erreur, et que nous avons raison ?
La révolution géographique de la Renaissance aboutit ainsi de deux façons au "scepticisme" :
a. puisque la découverte des nouveaux mondes montre que les Européens d'hier se sont trompés, il faut envisager que les Européens d'aujourd'hui se trompent aussi ;
b. puisque la découverte des nouveaux mondes montre que d'autres cultures voient le monde différemment, il faut envisager le fait qu'ils aient raison, et que nous ayons tort.
B. Révolution géographique et nature humaine : vers un universalisme
Le dernier point mérite d'être précisé. En fait, personne à la Renaissance ne pense réellement que les sauvages aient raison, et que nous ayons tort. Personne ne prétend, par exemple, que le cannibalisme soit une pratique supérieure. Ce qui apparaît en revanche, ce sont deux idées... qui tendent d'ailleurs à se contredire ; et cette contradiction est importante; parce que c'est elle qui se retrouvera dans un curieux paradoxe de la philosophie des Lumières.
Il arrive assez régulièrement que les navigateurs, les missionnaires ou les penseurs dressent un portrait élogieux des habitants d'autres régions du globe ; et ce portrait élogieux s'articule souvent à une critique des moeurs européennes. On pourrait alors supposer que la culture du peuple en question est posée comme supérieure à la culture européenne. Mais ce n'est presque jamais le cas.
Au XVI° siècle, on voit déjà apparaître des dialogues dans lesquels un "sauvage" fait la leçon aux Européens. Mais, à bien y regarder, il s'agit essentiellement de textes dans lesquels les comportements des Européens sont critiqués... au nom de valeurs européennes ! Le sauvage qui "fait la leçon" est moins le membre d'une autre culture, que le porteur de valeurs qui sont censées être les nôtres et que nous ne respectons pas. Si le sauvage critique les moeurs des colons, ce n'est pas parce qu'elles entrent en contradiction avec sa culture, mais bien parce qu'elles entrent en conflit avec des valeurs qui, tout en étant les siennes, sont aussi censées être les nôtres.
C'est donc au nom de valeurs communes, de valeurs qui sont en fait posées comme universelles, que la critique des Européens est menée. Ce qui condamne les pratiques des colons, ce ne sont pas les valeurs des amérindiens, ni même les dogmes du christianisme : ce sont des valeurs humaines, dont le respect nous est dicté par la nature elle-même.
Aussi l'éloge des Indiens, des Chinois ou même des Turcs (mais si !), de même que la condamnation des Européens, ne se fait-elle pas à l'aune de l'opposition entre deux cultures : c'est bien l'humanité des uns, et l'inhumanité des autres qui est en jeu : le respect, en soi et en l'autre, de ce qui fait de nous des êtres humains. Marc Lescarbot, ce grand érudit, voyageur et écrivain du XVI° siècle (que nous avons déjà croisé : c'est lui qui avait écrit la première pièce de théâtre intégrant des rôles d'amérindiens), dans son Histoire de la Nouvelle France de 1609, ne cherche pas à montrer que les indigènes sont des humains (personne n'en doute), mais bien qu'ils font preuve de plus d'humanité que ceux qui prétendent les coloniser.
Pour la cruauté, quand je révoque en mémoire nos troubles derniers [il s'agit des guerres de religion], je crois que ni Espagnols, ni Flamands, ni Français, nous ne leur devons rien à cet égard, voire que nous les surpassons de plus de juste mesure. [Les Européens surpassent largement en cruauté les Indiens] Car ils ne savent pas ce que c'est que de (...) chauffer la plante des pieds, serrer les doigts, et autres choses plus horribles. Mais s'ils ont à faire mourir quelqu'un, ils le font sans supplices excogités. Et je dirai plus, que sans faire mention de nos troubles, et prenant nos nations de l'Europe dans l'état où elles sont aujourd'hui, je puis assurer que les Sauvages ont autant d'humanité et plus d'hospitalité que nous.
Il ne s'agit pas diu tout ici de considérer que la culture amérindienne est supérieure à la culture européenne : mais d'indiquer que les moeurs de ces hommes sont plus humaines.
Inversement, si Bartholomé de Las Casas souligne l'humanité des "sauvages"... c'est pour mieux souligner la sauvagerie inhumaine des Européens. Il n'est pas du tout question de "culture" dans ces lignes, ni de règles culturelles : mais bien de nature humaine, de loi naturelle, de loi humaine, de loi divine, d'humanité et de bestialité. L'humanité des "barbares" contraste violemment avec la barbarie des soi-disant "civilisés".
Nous citons ci-dessous quelques extraits de Las Casas, sans doute l'auteur du témoignage le plus vibrant du XVI° siècle (un siècle au cours duquel le lyrisme est une chose rare) :
Vous verrez dans ce Discours, Lecteur, tant de millions d'hommes mis à mort, qu'à grand peine y a-t-il eu tant d'Espagnols au monde depuis que leurs premiers pères, les Goths, entrèrent dans leur pays, que (...) les Espagnols ont tués et massacrés aux Indes Occidentales, par tous les moyens que la barbarie même pourroit imaginer et forger sur l'enclume de la cruauté.
Ces conquêtes sont iniques, tyranniques et par toute loi naturelle, humaine et divine condamnées, détestées et maudites...
Inhumaine, donc, l'attitude des Européens à l'égard des indigènes. Inhumaine, car elle bafoue à la fois le respect qu'un homme doit à un autre homme, mais aussi le respect qu'il se doit à lui-même en tant qu'être doté de dignité. L'idée se retrouvera 2 siècles plus tard, inchangée, chez un penseur des Lumières comme Emmanuel Kant. Mais ce qui est intéressant, c'est que le fondement de cette "dignité", sur laquelle repose le respect que l'homme se doit à lui-meme et à autrui est, lui aussi indiqué. Ce qui fait l'humanité de l'homme, c'est bien sûr le fait qu'il soit une créature faire à l'image de Dieu ; mais c'est aussi le fait qu'il soit doté de raison. Et Las Casas articule de façon saisissante le caractère raisonnable des sauvages, le caractère déraisonnable de leur extermination, et la "stupidité" (l'incompréhension stupéfaite) de ceux qui assistent au spectacle irrationnel et monstrueux d'un génocide auquel on ne peut donner de raison ; le messacre irrationnel de créatures raisonnables ne peut que rendre fou l'être doté de raison...
Etait-il raisonnable, pour avoir crié de nuit au pays qu'il y a un Dieu et un pape, et un Roi de Castille, qui est seigneur de ces pays, de tuer douze ou quinze ou vingt millions de pauvres créatures raisonnables, créées comme nous à l'image du Dieu vivant ? (...) Mais voire toute une gent, oui, une gent infinie, périr si misérablement et, comme il semble, sans aucune raison, c'est ce qui rend plusieurs étonnés et les rend comme stupides, examinant de tels effets par la règle de leur raison...
Il ne s'agit donc plus ici de persuader ou de convaincre l'auditoire, mais bien de le confronter à la violence choquante, traumatisante pour l'esprit, de ce qui relève de la sauvagerie pure à l'égard de créatures raisonnables ; il n'y a plus rien à "comprendre" dans ce que décrit Las Casas, et le lecteur est amené, par la cuauté des images, à partager la "stupidité" du sauvage qui cherche vainement à donner sens à un délire barbare :
Ils faisaient des gageures à qui d'un coup d'épée fendrait ou ouvrirait un home par le milieu, ou à qui plus habilement et plus dextrement lui taillerait la tête d'un coup d'épée, ou lui louvrirait mieux les entrailles d'un coup. Ils prenaient les petites créatures par les pieds, les arrachant des mamelles de leurs mères, et leur écrsant la tête contre les rochers. Ils jetaient les autres dans les rivières, se riant et se moquant. Ils dressaient de chiens à mettre en pièces, dès qu'ils les voyaient, et dans un Crédo, un Indien...
"Dans un Crédo" ; c'est-à-dire : le temps de dire le credo, la profession de foi chrétienne... Chez un libertin du 17e ou 18 siècle, la formule serait sarcastique ; mais Las Casas ne fait pas d'ironie. Ce que manifeste cette formule, c'est justement l'impossibilité ici de tout humour, et le caractère radicalement inhumain de ce rire qui résonne...
Du reste, lorsque la sauvagerie découle d'un raisonnement, cela ne fait que souligner la déraison qui jaillit de la logique, quand elle s'abstrait de toute humanité :
Le lendemain, il s'assembla beaucoup d'Indiens qui poursuivirent les Espagnols, leur faisant la guerre pour le grand désir qu'ils avaient de recouvrer leurs femmes et leurs filles. Voyant que les Indiens approchaient de près, les Espagnols ne voulurent point quitter le butin, mais mirent l'épée à travers le ventre des femmes et des filles, et n'en laissèrent vivante mpas une seule de toutes les quatre-vingts. Les Indiens de rompaient la poitrine de tristesse et de douleur, jetant des cris et disant telles paroles : "Oh les mauvais hommes ; ô les cruels Espagnols ! Tuez-vous les femmes ?..." comme s'ils eussent voulu dire : "Tuer les femmes ! Ce sont les actions d'hommes abominables et cruels comme les bêtes !"
Humanité des sauvages, inhumanité des Espagnols : le débat n'a pas lieu entre plusieurs cultures, mais entre nature et contre-nature, dignité humaine et barbarie. ce n'est pas la culture indienne qui est bafouée : c'est l'humanité de l'homme.
A l'inverse, lorsque les voyageurs louent les vertus des sauvages, des Orientaux ou des Chinois, ce sont encore des valeurs universelles qui sercvent de critère. Il n'y a pas réellement de "conflit de valeurs", encore moins de "choc des cultures" : car les vertus dont font preuve les Chinois sont précisément... les vertus fondamentales du christianisme. Nous avons déjà croisé cette idée avec Louis Le Comte ; elle est explicite dans les Nouveaux avis du grand royaume de la Chine rédigés par le Père Nicolas Lombard en 1602 :
Les Chinois sont bien faits et dispos de leurs personnes, mais encore mieux complexionnés et réglés en leurs façons. Ils ont naturellement une grande douceur et bénignité. (...) Quant à la bienséance extérieure, il me semble qu'en plusieurs choses ils ne se laissent pas vaincre par les Européens, ni en quelques unes par les Religieux mêmes. (...) Non seulement les Chinois ont-ils grand soin des choses extérieures... mais ils font encore grand compte de l'intérieur, ornant l'âme de vertus morales. Ainsi, ils font plusieurs oeuvres pies, comme de donner l'aumône aux pauvres, entretenir des hôpitaux dans toutes les villes, et des choses semblables.
Ceci fait écho au témoignage d'un autre jésuite, Valentin Carvalho, l'année précédente :
Le Mandarin sachant la cause du mal, envoya chercher dans sa maison un emplâtre. Il l'appliqua lui-même au patient, avec tant de signes d'amour que les nôtres demeurèrent fort consolés et édifiés de voir chez un Païen, grand Mandarin, une telle charité.
A l'évidence, il ne s'agit pas du tout ici de culture chinoise : mais de la conformité du comportement chinois à des règles de conduite sociales et morales inscrites aussi bien dans la sagesse asiatique que dans les principes chrétiens : des règles universelles, donc, prescrites par la nature. Ceci n'aboutit d'ailleurs pas du tout à éliminer les différences culturelles entre les peuples : il y a bien des spécificités des moeurs chinoises, qui s'éloignent en bien des points de nos coutumes. Mais là encore : ce qui permet de comparer les us et coutumes... c'est que les une tendent à s'approcher davantage que les autres des principes naturels de la vertu ; et en ce sens, un païen peut se conduire de façon plus chrétienne qu'un chrétien, dans la mesure même où il met sincèrement en oeuvre les principes de sa propre tradition :
La bonté du naturel des Chinois se montre par plusieurs belles vertus. Et en les comparant avec nos Européens, je me trouve dans une chose tout honteux. C'est quand je vois la grande paux, l'accord et la mansuétude dont ils usent ensemble généralement, chose qui me fait souvenir avec étonnement et avec horreur de cette fureur si ordinaire, qui rend frénétiques si souvent en Europe ceux-mêmes à qui l'Evangile de paix a été annoncée. Car ici [en Chine] ce serait aussi monstrueux de voir deux hommes se battre avec l'épée que ce serait de voir les alouettes joûter ensemble avec des lances. Aussi n'ont-ils aucunes armes chez eux, et le tiennent comme déshonneur d'en avoir. (...) Se mettre en fougue pour une parole... pour une démentie et autres telles occasions, ils l'estiment aussi sans raison que de vouloir aboyer plus fort que les chiens ou contregimber les mulets [lutter à coups de pieds contre des mulets.], et il s'en faut de beaucoup que pour de telles raisons ils veuillent tuer un homme. (Avis du Royaume de Chine, J. Le Pantoie, 1607)
La découverte de nouveaux mondes n'aboutit donc pas du tout ici à un constat de la différence profonde des cultures, ou à l'affirmation d'un conflit irréductible entre "leurs" valeurs et "les nôtres". L'exploration géographique n'aboutit absolument pas, chez les auteurs que nous venons de citer, à un "choc des cultures", mais au contraire à un accord fondamental de toutes les cultures sur un petit nombre de principes fondamentaux qui, eux, semblent naturels et universels.
Ce sont ces principes qui sont absolument "vrais", et que tout homme doit mettre en oeuvre, pour rester pleinement humain.
C) Révolution géographique et cultures : vers un "universalisme sceptique"
Ce qui est paradoxal, c'est que la même rencontre avec des peuples différents va aussi aboutir à une thèse quasiment inverse, chez d'autres auteurs. Car après tout, si ce qui est admis ici est contesté ailleurs, si les valeurs reconnues dans notre pays s'opposent à celles qui sont en vigueur dans le pays voisin, qui elles-mêmes diffèrent grandement de celles qu'affirment un troisième... on pourrait être tenté d'envisager l'idée selon laquelle il n'y a pas de valeurs universelles : il n'y aurait que des pratiques, des moeurs, des coutumes, des croyances valables en un lieu et à une époque déterminés, sans qu'aucune d'entre elles ne puisse prétendre à la "vérité".
Il n'y aurait donc pas de "vraies" croyances, inscrites dans la "nature" de l'homme, et qui seraient universellement valables ; mais bien des croyances diverses, relatives à chaque culture. Cette thèse définit ce que l'on appelle le relativisme culturel. Dans cette optique, il est absurde de se demander si la nudité est morale ou non : elles est admise aux Indes, elle n'est pas admise chez nous ; aucune des deux croyances n'est plus "vraie" que l'autre. Il n'y a pas de morale naturelle : il n'y a que des pratiques culturelles.
Cette idée est tout à fait révolutionnaire au XVI° siècle... et on ne la croise que très rarement de façon explicite. Il est d'ailleurs intéressant de voir comment certains auteurs reculent devant une conclusion qui, pour un lecteur actuel, semble pourtant s'imposer. A cet égard, le cas de cet ami de Montaigne que fut Pierre Charron est fascinant.
Dans le livre II de son oeuvre intitulée "De la sagesse" (publié en 1601), Charron proclame ce qui, à première vue, semble bien être une affirmation de "l'universalisme" tel que nous venons de le présenter. L'esprit réellement libre, c'est celui qui sait se détacher des croyances propres à sa culture, pour s'élever vers les idées et les valeurs universelles, inscrites dans la nature même de l'homme.
Or, le vray moyen d’obtenir et se maintenir en ceste belle liberté de jugement, et qui sera encore une autre belle leçon et disposition à la sagesse, c’est d’avoir un esprit universel, jettant sa veuë et consideration sur tout l’univers, et non l’asseoir en certain lieu, loy, coustume, et maniere de vie, mais (...) estre citoyen du monde, comme Socrates, et non d’une ville, embrassant par affection tout le genre humain.
La première application de cette disposition d'esprit, c'est de ne pas condamner ceux qui ont d'autres coutumes, d'autres pratiques, d'autres croyances, au seul prétexte que celles-ci ne sont pas celles que l'on rencontre dans notre propre société. L'esprit libre et éclairé est celui qui sait se départir d'un tel "esprit municipal" :
C’est sottise et foiblesse que de penser que l’on doibt croire et vivre par-tout comme en son village, en son pays, et que les accidens qui adviennent icy touchent et sont communs au reste du monde. Le sot, si l’on recite y avoir autres creances, coustumes, loix toutes contraires à celles qu’il void tenir et usiter, il les abomine et condamne promptement comme barbarie, ou bien il mescroit tels recits, tant il a l’ame asservie aux siennes municipales, qu’il estime estre les seules vrayes, naturelles, universelles.
Le sot, c'est donc celui qui appelle barbare ce qui heurte les moeurs de son pays ; et de ce point de vue, il existe des sorts dans tous les peuples, puisque tous les hommes ont tendance à condamner ce qui suit des usages différents des siens. Ici (comme souvent) Charron reprend mot à mot une formule bien connue de Montaigne : chacun appelle barbare ce qui n'est pas de son usage.
Chascun appelle barbarie ce qui n’est pas de son goust et usage, et semble que nous n’avons autre touche de la verité et de la raison que l’exemple et l’idée des opinions et usances du pays où nous sommes.
Encore une fois, il s'agit ici de la manière de voir qui correspond à la sottise... mais s'agit-il uniquement du sot ? Après tout, comment pouvons-nous savoir ce qui est vrai et juste, sans nous référer aux idées et aux valeurs qui sont celles de la société qui est la nôtre ? Ne suis-je pas alors "enfermé" dans les idées et les valeurs de la culture dans laquelle j'ai été élevé ? Les hommes des différents peuples ne seraient-ils pas voués à se considérer réciproquement comme des barbares ?
Pas du tout, nous dit Charron : car le sage est précisément celui qui sait s'élever au-dessus du conflit entre les croyances particulières, pour s'élever à un point de vue universel. Certes. Mais... ce point de vue universel nous dévoile-t-il des idées et des valeurs communes à tous les hommes ? Accède-t-on ainsi à des principes transculturels, inscrits dans la nature même de l'homme ? Trouvons-nous un sol ferme pour assurer nos jugements ?
Hélas, non. La sagesse à laquelle atteint celui qui s'élève au-dessus de tous les cultures... c'est celle qui consiste à de rien admettre comme absolument vrai. Que rien n'est admis quelque part, qui ne soit réfité ailleurs, et que les croyances et les pratiques humaines sont incroyablement diverses. Le sage, c'est bien celui qui "se connaît lui-même" ; et il se connaît lui-même dans la mesure où il sait ce que ceest qu'un homme ; mais savoir ce qu'est l'homme, ce n'est pas savoir ce que sont les principes inscrits dans la nature humaine : c'est savoir que les idées, les croyances et les coutumes sont absolument diverses, et que la seule sagesse et de ne s'étonner d'aucune.
Or, il se faut affranchir de ceste brutalité, et se faut presenter comme en un tableau ceste grande image de nostre mere nature en son entiere majesté, remarquer là dedans un royaume, un empire, et peust-estre ce monde (car c’est une grande et authentique opinion qu’il y en a plusieurs) comme le traict d’une poincte très delicate, et y lire une si generalle et constante varieté en toutes choses, tant d’humeurs, de jugemens, creances, coustumes, loix, tant de remuemens d’estats, changemens de fortune, tant de victoires et conquestes ensepvelies, tant de pompes, cours, grandeurs evanouyes : par là l’on apprend à se cognoistre, n’admirer rien, ne trouver rien nouveau ny estrange, s’affermir et resouldre par-tout.
Bien loin d'accéder à des principes universels, le sage est celui qui reconnaît et assume l'irréductible diversité des croyances et des coutumes, et qui n'en admet aucune comme "vraie". En ce sens, c'est bien à un scepticisme radical qu'aboutit la "sagesse" de Charron. Scepticisme qui reprend d'ailleurs à son compte la plupary des élément que nous avons rencontrés jusqu'à présent.
a. Ce que les Anciens tenaient pour absolument vrai... l'exploration du globe l'a démoli. Si nos plus dignes ancêtres se sont trompés, de quel droit considérerions-nous nos croyances actuelles comme des certitudes ?
Que l’on considere aussi ce que la descouverte du monde nouveau, Indes orientales et occidentales, nous a apprins : car nous voyons premierement que tous les anciens se sont mescomptez, pensant avoir trouvé la mesure de la terre habitable, et comprins toute la cosmographie, sauf quelques isles escartées, mescroyant les antipodes : car voylà un monde à peu près comme le nostre, tout en terre ferme, habité, peuplé, policé, distingué par royaumes et empires, garny de villes qui surpassent en beauté, grandeur, opulence, toutes celles qui sont en Asie, Afrique, Europe, il y a plusieurs milliers d’années. Et qui doubte que d’icy à quelque temps il ne s’en descouvre encore d’autres ? Si Ptolomée et les anciens se sont trompez autrefois, pourquoy ne se peust tromper encore celuy qui diroit que maintenant tout est descouvert et trouvé ? Je m’en voudrois bien fier en luy !
b. Ce que nous prenions pour le fondement de notre propre culture, reçu par un don spécial des dieux... l'exploration du globe nous indique qu'il se trouve déjà dans les traditions les plus anciennes de peuples éloignés. Ce qui semblait établir la supériorité de nos croyances... ne fait en réalité que l'apparenter aux croyances des autres peuples. Il est difficile de ne pas songer à Louis le Comte en lisant ces lignes :
Secondement nous trouvons qu’en ces nouvelles terres presque toutes les choses que nous estimons icy tant, et les tenons-nous avoir esté premierement revelées et envoyées du ciel, estoient en creance et observance commune plusieurs mille ans auparavant qu’en eussions ouy les premieres nouvelles, soit au faict de religion ; comme la creance d’un seul premier homme pere de tous, du deluge universel, d’un dieu qui vesquit autrefois en homme vierge et sainct, du jour du jugement, du purgatoire, resurrection des morts, observation des jeusnes, caresme, coelibat des prestres, ornemens d’eglise, surpelis, mitre, eaue benicte, adoration de la croix, circoncision pareille à la juifve et mahumetane...
Ceci ne vaut d'ailleurs pas seulement pour l'espace religieux : le même constat se retrouve pour les normes juridiques, pour les pratiques artistiques, pour les inventions techniques, etc. Et Charron mentionne au passage ce qui, pour les Européens de la Renaissance, fut une pilule assez amère : l'imprimerie, cette fierté de l'Europe, est en fait inscrite au patrimoine culturel asiatique depuis des siècles ! Le propos de Charron est donc directement articulé aux comptes-rendus récents des géographes, comme l'Histoire du grand Royaume de Chine de Mendoza (1589), auteur de la première description de la Chine depuis le Livre des Merveilles de Marco Polo :
« L'invention de l'imprimerie, comme tient la commune opinion, a commencé en Europe en l'an de grâce 1548, et est attribuée à un Allemand appelé Jean Gutenberg. Toutefois, suivant ce que les Chinois assurent, son premier commencement a été en leur royaume, d'où longtemps après l'usage seoit venu en Allemagne par la Russie et la Moscovie... des marchands qui venaient de Chine et de l'Arabie heureuse trafiquer en ladite Allemagne par la Mer Rouge y apportèrent des livres, sur lequel ledit Gutenberg prit motif et occasion d'en faire... Il est évident que cette invention est venue d'eux (Chinois), et qu'elle a depuis été communiquée à nous autres : et pour le croire, (il suffit de dire) qu'il se trouve entre eux aujourd'hui beaucoup de livres, lesquels ont été imprimés plus de cinq cents ans avant que jamais on en a commencé l'invention en Allemagne, selon notre compte : desquels livres j'en ai un par devers moi. »
Le symbole de la Renaissance ne se trouvait donc être qu'une invention des vieux Chinois, apportée en Europe par les Moscovites et les Arabes...
Face au spectacle bigarré des croyances et des coutumes et à l'effrondrement de nos certitudes, la posture de sagesse consiste donc à prendre acte du fait que rien n'est stable en ce monde, que les idées et les habitudes des hommes changent perpétuellement dans le temps et dans l'espace, que rien ne peut être tenu pour certain et que le sage, c'est celui qui, comme Socrate, ne prétend rien savoir, hormis qu'il ne sait rien.
Par tous ces discours nous tirons aisement ces conclusions : que ce grand corps que nous appellons le monde, n’est pas ce que nous pensons et jugeons ; que ny en son tout, ny en ses parties, il n’est pas tousiours mesme, ains en perpetuel flux et reflux ; qu’il n’y a rien dict, tenu, creu, en un temps et lieu, qui ne soit pareillement dict, tenu, creu, et aussi contredict, reprouvé, condamné ailleurs, estant l’esprit humain capable de toutes choses, roulant tousiours ainsi le monde, tantost le mesme, tantost divers ; que toutes choses sont enfermées et comprinses dedans ce cours et revolution de nature, subject à la naissance, changement, fin, à la mutation des temps, lieux, climats, ciels, airs, terroirs. Et de ces conclusions nous apprendrons à n’espouser rien, ne jurer à rien, n’admirer rien, ne se troubler de rien : mais quoy qu’il advienne, que l’on crie, tempeste, se resouldre à ce poinct, que c’est le cours du monde, c’est nature qui faict des siennes ; mais pourvoir, par prudence, qu’aucune chose ne nous blesse par nostre foiblesse et lascheté. C’est assez dict de cecy, de l’esprit universel et liberté du jugement.
La sagesse consiste donc bel et bien, pour Charron, à s'élever à un point de vue universel, qui dévoile à l'observateur le spectacle de l'humanité dans le temps et dans l'espace. Sage est celui qui sait s'abstraire de son appartenance culturelle, et qui sait remettre en cause ce qui est établi chez lui. Mais cet "esprit universel" n'atteint aucune certitude "naturelle", aucun principe universel, absolument vrai, si ce n'est celui-là : aucun principe n'est universel, rien ne peut etre considéré comme absolument vrai. Chez Charron, la révolution géographique aboutit à une création philosophique étrange : un universalisme sceptique.
Maintenant nous disons et donnons pour une belle et des premieres leçons de sagesse, retenir en surseance son jugement, c’est-à-dire soustenir, contenir et arrester son esprit dedans les barrieres de la consideration et action d’examiner, juger, poiser toutes choses (c’est sa vraye vie, son exercice perpetuel), sans s’obliger ou s’engager à opinion aucune, sans resouldre ou determiner, ny se coiffer ou espouser aucune chose. [...] C’est garder modestie et recognoistre de bonne foy la condition humaine pleine d’ignorance, foiblesse, incertitude (…). C’est aussi se tenir en repos et tranquillité loin des agitations et des vices qui viennent de l’impression, de l’opinion et science que nous pensons avoir des choses. (...) Et puis après c’est la doctrine et la practique de tous les sages, grands et habiles esprits, desquels la pluspart et les plus nobles ont faict expresse profession d’ignorer et doubter, disant qu’il n’y a rien en nature que le doubte, qu’il n’y a rien de certain que l’incertitude, que de toutes choses l’on peust egalement disputer, et cent pareilles. (...) Les dogmatistes et affirmatifs, qui sont venus depuis, d’esprit pedantesque, presomptueux, hayssent et condamnent arrogamment ceste reigle de sagesse, aymant mieux un affirmatif testu et contraire à leur party, qu’un modeste et paisible qui doubte et surseoit son jugement, c’est-à-dire un fol qu’un sage : semblables aux femmes qui ayment mieux qu’on les contredise jusques à injures, que si par froideur et mespris l’on ne leur disoit rien ; par où elles pensent être desdaignées et condamnées. En quoy ils montrent leur iniquité. Car pourquoy ne sera-il loysible de doubter et considerer comme ambiguës les choses sans rien determiner, comme à eux d’affirmer ? Mais pourquoy ne sera-il permis de candidement confesser que l’on ignore, puis que en verité l’on ignore, et tenir en suspens ce de quoy ne sommes asseurez ? Voyci donc la premiere liberté d’esprit, surseance et arrest de jugement ; c’est la plus seure assiette et l’estat plus heureux de nostre esprit, qui par elle demeure droict, ferme, rassis, inflexible, sans bransle et agitation aucune.
Pour ne pas être troublé (et ne pas être soi-même cause de trouble, contrairement aux dogmatiques de toutes les écoles) : faisons droit à toutes les croyances, et faisons valoir notre droit à n'en épouser aucune.
Mais Charron va plus loin. Car de son propre aveu, il n'est pas si facile de se départir de cet "esprit municipal" qui s'oppose à "l'esprit universel". Car les mots que nous employons pour penser, les jugements sur lesquels nous prenons appui pour raisonner, les valeurs grâce auxquelles nous évaluons... toutes ces choses, nous les avons reçues de notre éducation. Notre pensée même est façonnée par la société à laquelle nous appartenons. Nos concepts, nos idées, nos croyances, nos valeurs... toutes sont le fait des hommes qui nous ont formés.
Et Charron franchit le pas : même notre religion, que nous tenons pour directement révélée par Dieu, n'est en fait qu'une production humaine... de sorte que notre religion, ce n'est jamais que celle du lieu dans lequel nous sommes nés. Notre foi elle-même est le produit de notre culture, notre Dieu n'est que celui que notre éducation nous a appris a révérer... La religion n'est qu'une affaire de culture.
Or estant les religions et creances telles que dict est, estranges aux sens communs, surpassantes de bien loin toute la portée et intelligence humaine, elles ne doibvent ny ne peuvent estre prinses ny loger chez nous par moyens naturels et humains (autrement tant de grandes ames rares et excellentes qu’il y a eu y fussent arrivées) ; mais il faut qu’elles soyent apportées et baillées par revelation extraordinaire et celeste, prinses et receuës par inspiration divine et comme venant du ciel. Ainsi aussi disent tous qu’ils la tiennent et la croyent, et tous usent de ce jargon, que non des hommes ny d’aucune creature, ains de Dieu. Mais, à dire vray, sans rien flatter ny desguiser, il n’en est rien ; elles sont, quoy qu’on die, tenues par mains et moyens humains ; tesmoin premierement la maniere que les religions ont esté receuës au monde, et sont encore tous les jours par les particuliers ; la nation, le pays, le lieu, donne la religion ; l’on est de celle que le lieu auquel l’on est né et elevé, tient : nous sommes circoncis, baptisez, juifs, mahumetans, chrestiens, avant que nous sçachions que nous sommes hommes. La religion n’est pas de nostre choix et election.
Et pour Charron, c'est justement parce que la religion, loin d'être inscrite dans notre âme par Dieu, n'est qu'un produit de l'éducation, qu'elle peut aussi facilement être contredite tous les jours par notre conduite. Si les principes religieux étaient réellement dictés par Dieu, on voit mal comment ils pourraient être si aisément négligés ; le peu de force des commandements religieux est donc la preuve que ces commandements sont bien énoncés par des hommes, et non dictés par Dieu.
Tesmoin après la vie et les mœurs si mal accordantes avec la religion ; tesmoin que, par occasions humaines et bien legeres, l’on va contre la teneur de sa religion. Si elle tenoit et estoit plantée par une attache divine, chose du monde ne nous en pourroit esbranler, telle attache ne se romproit pas si aisement ; s’il y avoit de la touche et du rayon de la divinité, il paroistroit par-tout, et l’on produiroit des effects qui s’en sentiroient et seroient miraculeux, comme a dict la verité : si vous aviez une seule goutte de foy, vous remueriez les montagnes.
La religion n'est donc pas d'origine divine : elle n'est qu'une institution humaine, transmise par l'éducation, et façonnée par l'environnement culturel. Il y avait évidemment un certain courage à dire cela en 1602, et l'on comprend assez bien que le livre ait été mis à l'index (l'Index librorum prohibitorum, qui fixait la liste des livres que les catholiques n'étaient pas autorisés à lire). Ce passage semble ainsi confirmer la suspicion générale que le scepticisme oppose à toutes les croyances, le sage se gardant bien de devenir le fidèle de quelque église que ce soit.
Il ne faudrait pourtant pas oublier la suite du texte que nous venons de citer. Car la remise en cause de la religion des sots n'aboutit pas seulement à un "agnosticisme" prudent, rappelant à chacun que rien n'est sûr en matière de religion ; cette fois, on aboutit bel et bien à ce qui ressemble fort à une "religion naturelle", une religion dépouillée de tous ses artifices et qui semble inscrite dans la nature même de l'homme. En d'autres, c'est bien à une forme de déisme que "l'esprit universel" de Charron s'élève, dès qu'il prend appui sur l'irréductible diversité des religions humaines : une religion pure, réduite à quelques principes fondamentaux, en laquelle on reconnaît déjà les traits du "dieu des philosophes" du 17e siècle. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Charron fait référence à ceux qui veulent voir dans le Soleil l'astre divin : c'était l'argument de Copernic pour en faire le centre de la Création.
Or, quittant ceste orde et vilaine superstition (que je veux estre abominée par celuy que je desire icy duire et instruire à la sagesse), apprenons et guidons-nous à la vraye religion et pieté, de laquelle je veux donner icy quelques traicts et pourtraicts, comme petites lumieres. Il semble déjà bien que de tant de religions, celles semblent avoir plus d’apparence de verité, lesquelles, sans grande operation externe et corporelle, retirent l’ame au dedans et l’elevent par pure contemplation à admirer et adorer la grandeur et majesté immense de la premiere cause de toutes choses, et l’estre des estres, sans grande declaration ou determination d’icelle, ou prescription de son service ; ains la recognoissent indefiniment estre la bonté, perfection et infinité du tout incomprehensible et incognoissable, comme enseignent les pythagoriens et plus insignes philosophes. De tous ceux qui n’ont voulu se contenter de la creance spirituelle et interne, et de l’action de l’ame, mais encore ont voulu voir et avoir une divinité visible et aucunement perceptible par les sens du corps, ceux qui ont choisi le soleil pour Dieu, semblent avoir plus de raison que tous autres, à cause de sa grandeur, beauté, vertu esclatante et incogneuë, et certes digne, voire qui force tout le monde en admiration et reverence de soy : l’œil ne void rien de pareil en l’univers, ny d’approchant.
La "vraie religion et piété", c'est donc celle qui s'adresse au Créateur de toutes choses, en tant que la Création témoigne, aux yeux de l'esprit, de sa sagesse et de sa perfection. Ainsi, contempler le monde en son entier, c'est déjà s'élever vers la célébration de l'Auteur de toutes choses ; l'incroyable diversité des lieux, des choses, des êtres et des moeurs ne témoigne pas seulement de la folie de ceux qui prétendent enfermer le monde dans les canons de leurs croyances : elle témoigne aussi de la sagesse du Créateur.
Et ces deux mouvements sont constitutifs de la "vraie religion" :
a. observer le monde, c'est prendre conscience de la vanité des efforts humains visant à enfermer la réalité dans les quelques dogmes d'un système, qu'il soit scientifique ou religieux ; c'est aussi reconnaître la folie de ceux qui veulent ériger un système comme "le seul vrai", garant d'une vérité absolue. Charron assume ici tout le message du Socrate mis en scène dans l'Apologie de Socrate (rédigée par Platon) : si Socrate est, comme le veut l'oracle, "le plus sage des hommes", ce n'est pas uniquement parce qu'il sait qu'il ne sait rien : c'est aussi parce qu'il rappelle aux hommes que leur prétendue sagesse n'est rien aux yeux des dieux.
b. observer le monde, c'est prendre conscience de la sagesse et de la perfection du Créateur de toutes choses, et c'est comprendre qu'en lui seul peut se tenir "la vérité". Ce n'est qu'en s'en remettant à Dieu, et non à telle ou telle philosophie, telle ou telle religion, tel ou tel système astronomique, que nous pourrons atteindre la sagesse ; et nous ne nous en remettrons à Dieu que dans la mesure même où nous renonçons à faire d'un système humain le dépositaire de la vérité.
La religion est en la cognoissance de Dieu et de soy-mesme (car c’est une action relatifve entre les deux) : son office est d’elever Dieu au plus haut de tout son effort, et baisser l’homme au plus bas ; l’abattre comme perdu, et puis luy fournir des moyens de se relever, luy faire sentir sa misere et son rien, affin qu’en Dieu seul il mette sa confiance et son tout. L’office de religion est nous lier avec l’autheur et principe de tout bien, reunir et consolider l’homme à sa premiere cause comme en sa racine, en laquelle, tant qu’il demeure ferme et fiché, il se conserve à sa perfection : au contraire, quand il s’en separe, il seiche aussitost sur le pied.
Il y a donc un double mouvelent chez Charron : le premier nous conduit de l'observation du monde au scepticisme, destructeur de toute doctrine "vraie" ; dans le domaine religieux notamment, l'incroyable bigarure des croyances et des cultes nous conduit à refuser notre soumission à quelque église que ce soit. Mais le second nous reconduit du scepticisme jusqu'à une forme de piété naturelle, inscrite dans la nature même de l'âme, dès lors qu'elle est amenée, par le spectacle du monde, à reconnaître la gloire du Créateur ; le doute que nous opposons à toutes les religions humaines nous élève ainsi vers une religion purifiée, qui s'en remet d'autant plus à Dieu qu'elle remet en cause toutes les croyances humaines. La "religion vraie" à laquelle aboutit la sagesse sceptique, c'est la foi débarrassée de toute "religion".
Au XVI° siècle, un autre grand "articulateur" du scepticisme et de la théologie, Blaise Pascal, dira que "la vraie morale se moque de la morale" ; pour Pierre Charron, la "vraye religion"... se moque des religions.
Pour la tolérance :
Puisque aucune ne peut être considérée comme vraie, n'en condamnons aucune : ok.
Mais plus profond : la vraie religion commande la tolérance, dans la mesure même où elle les disqualifie toutes, tout en affirmant la transcendance d'un Dieu qui s'exprime dans la racine de chacune. D'où tolérance des Turcs.
Cette affirmation selon laquelle tous les hommes sont dotés d'une nature commune (ce sont des créatures dotées de raison, ce sont des créatures faites à l'image de Dieu), au sein laquelle sont inscrites des principes universels (respect de la dignité, charité, etc.) jouera un rôle capital pour la suite de l'histoire de la pensée européenne. Car c'est sur elle que les penseurs du XVII° siècle, et plus encore les penseurs des Lumières au siècle suivant prendront appui pour proclamer la liberté de tout homme, et le droit de tout homme à la liberté. La liberté, pour les penseurs des Lumières, ce n'est pas du tout d'obéir à ses instincts ou à ses désirs : c'est le fait de pouvoir agir conformément aux facultés constututives de la nature humaine, et aux principes qui y sont inscrits. Ainsi pour Kant (philosophe allemand des Lumières), la liberté consiste à ne pas être soumis à ses instincts, à ses désirs, à la peur, etc. mais bien à la faculté fondamentale de notre nature : la raison (et à la loi qu'elle nous dicte : la "loi morale") ; être libre, c'est (ne) suivre (que) sa raison. De même, pour Rousseau, la liberté consistera à n'être soumis ni à autrui, ni à nos instincts, mais bien à cette faculté proprement humaine qu'est la conscience : être libre, c'est (ne) suivre (que) sa conscience.
En affirmant que tous les êtres humains sont dotés d'une "nature humaine" (ce sont tous des "créatures raisonnables"), qui leur dicte des principes universels (notamment des principes moraux), les penseurs que nous avons cités posent donc les fondements d'une déclaration de la liberté de tous les êtres humains, dont le point d'aboutissement est l'article 1 de la Déclaration Universelle des droits de l'Homme (1948) : "Tous les hommes naissent et demeurent libres... ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité." Si tous les hommes sont doués de raison et de conscience, alors tous les hommes sont libres par nature, car la liberté consiste précisément à suivre sa raison et sa conscience. Et porter atteinte à cette liberté, c'est porter atteinte à la dignité : à celle de l'autre, mais aussi à la mienne, en tant que nous sommes tous deux des êtres doués de raison et de conscience.
1. Le mode de vie des autres hommes peut être supérieur au nôtre, non parce que leurs valeurs seraient supérieures aux nôtres, mais bien parce qu'ils ont les mêmes valeurs que nous, tout en les appliquant mieux. Cette idée court de la Renaissance jusqu'aux Lumières : les hommes d'autres peuples peuvent obéir mieux que nous aux valeurs que nous avons en commun. Et si elles nous sont communes, c'est parce qu'elles sont universelles (communes à tous les hommes) ; et si elles sont universelles, c'est parce qu'elles sont naturelles (inscrites dans la nature même de l'homme).
2. Le mode de vie des autres hommes est régi par des idées, des croyances et des pratiques propres à leur culture ; il en va de même pour nous. Il n'y a donc pas réellement de mode de vie qui puisse servir de modèle : il n'y a que des modes de vie, situés dans le temps et dans l'espace. Il n'y a pas de "nature" humaine : il n'y a que des cultures. La manière dont vit un individu n'est pas dictée par sa "nature", mais par la société dans laquelle il vit.
Ces deux tendances s'opposent :
1. la première conduit à redéfinir ce que peut être la "liberté" l'homme, en considérant que l'homme vraiment libre est celui qui obéit à sa nature, et plus encore aux facultés qui caractérisent la nature humaine (à commencer par la raison). C'est ce qui conduira à la conception de la liberté des Lumières, que l'on trouve par exemple chez Rousseau (chez qui la liberté consiste avant tout à obéir à cette autre "faculté naturelle" qu'est la conscience. Être libre, c'est suivre sa raison, quand celle-ci est guidée par la conscience.)
2. la seconde conduit à détruire la liberté de l'homme : ce que pense, ce que croit, ce que fait un homme n'est en fait que le produit du milieu (familial, social, culturel) dans lequel il s'est développé. C'est une posture déterministe. C'est elle qui trouvera un aboutissement dans le matérialisme des Lumières, comme celui du baron d'Holbach et d'Helvétius.
La rencontre avec d'autres cultures a donc fait émerger deux idées contradictoires : l'une aboutit à l'affirmation de la liberté de l'homme, en prenant appui sur la nature humaine. La seconde abutit à la négation de la liberté de l'homme, en prenant appui sur un déterminisme culturel.
C’est précisément sur cette question que Las Casas se trouve en difficulté : les sacrifices humains des Aztèques ne légitiment-ils pas une intervention civilisatrice ? Et c’est ici qu’il s’avère le plus moderne puisqu’il a l’audace de présenter ces sacrifices sanglants comme des preuves d’une sensibilité religieuse semblable à la nôtre même si elle se trompe d’objet.
Au XVI° siècle, on voit déjà apparaître des dialogues dans lesquels un "sauvage" fait la leçon aux Européens. Mais, à bien y regarder, il s'agit essentiellement de textes dans lesquels les comportements des Européens sont critiqués au nom de valeurs... européennes ! Le sauvage qui "fait la leçon" est moins le membre d'une autre culture, que le témoin des contradictions qui subsistent entre nos comportements... et nos valeurs. Si le sauvage critique nos moeurs, ce n'est pas parce qu'elles entrent en contradiction avec sa culture, mais bien parce qu'elles entrent en conflit avec des valeurs qui nous sont communes : des valeurs qui sont universelles, qui dépassent les différences culturelles, et qui pourront donc sans effort être présentées comme "naturelles".
On voit ici apparaître la manière très paradoxale dont la remise en cause de l'autorité du savoir hérité, qui substitue à un savoir intemporel une histoire des croyances, va s'articuler
Et inversement : pouvait-on reconnaître une valeur (et notamment une valeur morale) à des manières de vivre, alors même qu'elles n'étaient pas chrétiennes ? Le Turc du Moyen-Âge ne poussait pas à se poser ces questions : car dans son statut "d'infidèle" s'articulait à une sauvagerie morale, à laquelle on pouvait tout au plus reconnaître (et comment faire autrement ?) une puissance militaire (dans laquelle on pouvait d'ailleurs voir l'oeuvre de Satan lui-même.) Mais même le Turc, à la Renaissance, devient de plus en plus difficile à enfermer dans ce rôle diabolique. Car enfin, à bien y regarder, les Turcs ne sont pas (seulement) des créatures sanguinaires, ne rêvant que meurtre et pillage. Ici encore, la fréquentation des hommes est décisive. Et les méditations auxquelles leurs voyages ont parfois conduit, dès le XVI° siècle, les penseurs les plus intelligents de leur époque, a parfois de quoi faire rêver face aux résurgences de la xénophobie (et de l'islamophobie) la plus stupide.
Ainsi l'itinéraire (physique aussi bien qu'intellectuel) de Guillaume Postel est impensable avant le XVI° siècle. Les raisons mêmes de son premier voyage en Orient sont caractéristiques d'une époque : choisi pour accompagner l'ambassadeur de François Ier à Constantinople, il est spécialement chargé d'obtenir du Grand vizir la restitution de l'argent d'un négociant français originaire de Tours mort à Alger, ainsi que de rapporter des livres orientaux pour la bibliothèque du Roi. Il séjourne à Tunis, à Constantinople, mais aussi en Syrie et en Égypte.
Noter : c'est déjà la tolérance que les auteurs comme Ricci et Comte soulignaient chez les Asiatiques.
donc : apologie du Turc
pour deux raisons : sa tolérance religieuse + sa conformité aux principes chrétiens.(241-245)
On voit apparaître l'oecuménisme, proche du déisme, et la tolérance qui va avec.
Illustration avec l'affaire des Chinois. Bonté des Chinois : 195.
Pour la séparation science / religion : cf 260
Ajouter un commentaire