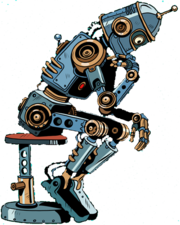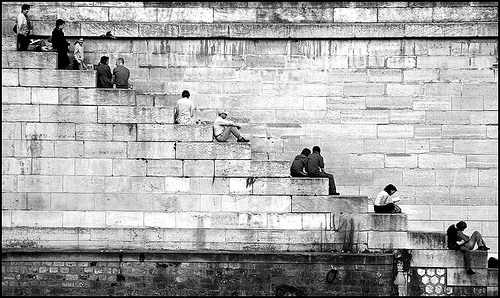Le regard de l'autre (2)
Nous poursuivons ici notre analyse de la conscience de soi, en approfondissant le rôle de l'Autre dans la constitution de notre identité. Pour ce faire, nous avions pris appui sur l'analyse sartrienne du rôle médiateur du regard de l'autre. Nous envisagerons ici deux autres textes : le premier sera encore de Sartre, mais issu cette fois de "L'existentialisme est un humanisme", le second sera un texte d'Alain, issu des "Propos sur l'éducation" (qui se trouve  ici)
ici)
Le premier texte de Sartre analysait (cf. page précédente) le "regard de l'autre". Rappelons que pour Sartre, en regardant autrui dans les yeux, ce ne sont pas ses yeux que je vois, mais son regard. Regarder autrui (qui me regarde) m'empêche de voir ces "objets" que sont ces yeux : les yeux disparaissent du champ de ma perception (ainsi, d'ailleurs, que le reste de ce qu'il y a dans mon champ de vision), le regard "masque" les yeux. Inversement, je ne peux regarder ses yeux qu'en faisant abstraction du regard (ce qui exige un effort volontaire). La formule des poètes "je me noie dans tes yeux" a un sens sartrien assez clair : le regard de l'autre fait disparaître le monde environnant, le regard agit comme une sorte de "trou noir" qui aspire la perception du monde. Lorsque je regarde quelqu'un dans les yeux, il m'est difficile de dénombrer les marches de l'escalier qui se trouve derrière lui... et il m'est même difficile de donner la couleur de ses yeux (car ce sont les yeux, non le regard, qui ont une couleur.)
On comprend ainsi comment Elton John a pu insérer dans une déclaration d'amour le fait qu'il était incapable de dire la couleur des yeux de l'être aimé. (So excuse me forgetting but these things I do / You see I've forgotten if they're green or they're blue...)
Celle qui a the sweetest eyes dans "Moulin Rouge" (reprise de Your Song)
Bien. Lorsque je regarde autrui qui me regarde, ce que je vois c'est son regard. Mais qu'est-ce que je vois quand je vois un regard ? Car un regard, ce n'est pas un "objet" que je pourrais voir. Quel est "l'objet" de ma perception lorsque je regarde le regard d'autrui qui me regarde ? La réponse est simple : ce que je vois... c'est que je suis vu. Regarder le regard d'autrui, c'est prendre conscience du fait que je suis regardé.
Soit. Mais encore une fois, "voir qu'on est vu", ce n'est pas vraiment un objet de perception. Qu'est-ce donc que je "vois" quand je vois autrui qui me regarde ? La réponse de Sartre est encore plus simple : ce que je vois quand je vois autrui me voir... c'est moi. Etrange ? Pas tant que ça. Car en prenant conscience du fait que je suis vu, que je suis regardé, je deviens capable de "me" voir moi-même, et de me voir comme seul autrui peut me voir : comme un objet de perception.
Magritte, Femme miroir
[Je passe ici sur l'objection selon laquelle je peux aussi me voir comme objet en me regardant dans un miroir : dans un miroir, "je me vois me voir"... mais en fait, non. Car celui qui me regarde dans un miroir ne "voit" absolument rien. La seule chose que je vois, c'est mon reflet, et non quelqu'un qui me regarde. Il m'est donc nettement plus facile de regarder mes yeux dans un miroir que ce n'est le cas face au regard d'autrui. Quant à savoir ce que je "vois" lorsque je tente de regarder mon regard dans un miroir... il n'est pas certain que cela fasse réellement abstraction du regard d'autrui.]
L'exemple de la honte (utilisé, nous l'avons vu, par Sartre) est très parlant. Lorsque je regarde ma voisine (ou mon voisin) se dévêtir par le trou d'une serrure, je ne me vois pas moi-même en train de regarder (ce qui m'épargne d'aileurs ce spectacle affligeant). Non seulement je ne me vois pas, mais ma conscience est tout entière focalisée sur le spectacle palpitant que je contemple : je suis "absorbé".
Mais voilà que j'entends derrière moi un "hum ! hum !" qui me signale que quelqu'un vient de me surprendre en train de me livrer à cette activité peu glorieuse. Aussitôt (nous dit Sartre), j'ai honte, je rougis, etc. Pourtant, autrui ne m'apporte aucune "connaissance" que je n'aie déjà : mais en prenant conscience qu'il me regarde je me vois moi-même à travers ses yeux. D'où la honte et ses stigmates corporels (rubéfaction, etc.) C'est donc bien moi que je vois lorsque je prends conscience du regard qu'autrui porte sur moi. Et, en portant un regard sur moi-même, je suis conduit à porter un regard moral sur ma conduite.
La logique du texte de Sartre est donc claire :
a) en voyant l'autre me regarder, ce que je vois, ce ne sont pas ses yeux, mais son regard.
b) en voyant le regard de l'autre, je vois que je suis vu
c) en voyant que je suis vu, je me vois moi-même à travers les yeux de l'autre.
Le regard de l'autre est donc un support privilégié de la conscience que j'ai de moi-même : il est l'intermédiaire entre moi et moi-même qui me permet de me saisir moi-même en tant qu'objet. Il ne s'agit plus ici de moi-même en tant que "chose qui pense" (pour cela, je n'ai pas besoin de l'autre) ; mais de moi-même en tant qu'individu, sujet doté d'un certain corps, d'un certain comportement, etc. Le regard de l'autre est le détour dont j'ai besoin pour pouvoir me voir, pour prendre conscience de ce que je suis en tant qu'individu.
"Regard critique" : une photo glanée sur la toile.
Mais Sartre, dans le second texte, va plus loin. Il énonce en effet que autrui est une "condition de mon existence", que je ne peux rien être sans faire intervenir le regard de l'autre. Voilà qui est plus mystérieux.
La clé du mystère est tout simplement que, par "ce que je suis", Sartre n'entend plus, comme Descartes, l'idée d'une "chose qui pense". Il s'agit bien maintenant de mon identité : je suis beau, ou fidèle, ou vaniteux, etc. Si autrui est une condition de mon existence, ce n'est pas parce qu'il faudrait qu'autrui existe pour que je pense : c'est parce qu'il faut qu'autrui existe pour que je puisse me définir comme beau, fidèle ou vaniteux. Pourquoi ? Là encore, la réponse est assez simple.
Prenons l'exemple de l'énoncé "je suis beau". Cet énoncé a-t-il un sens si je fais abstraction du regard de l'autre ? Non, dans la mesure où il est parfaitement impossible de dissocier le fait d'être beau et le fait d'être reconnu comme beau. Demandons nous si les femmes des portraits de Rubens sont belles, et faisons abstraction de tout contexte culturel. En voici un exemple :
Cette femme est-elle belle ? Prise de façon abstraite, cette question n'a aucun sens. Placée au milieu d'un défilé de mannequins actuels, on croirait une plaisanterie. Mais pour Rubens (dont je rappelle qu'il s'agit d'un peintre flamand du XVII°s)...? Il y a au moins deux raisons de croire qu'il estimait représenter là le type même de la beauté féminine. La première est que ce tableau s'intitule "Vénus au miroir" ; et on s'imagine mal une Vénus (déesse de l'Amour) disgracieuse. La seconde raison est que le modèle est Hélène Froment, qui n'est autre... que la (seconde) femme de Rubens !
On ose à peine imaginer ce qu'il aurait pensé, lui, de la plupart des mannequins actuels. Sans doute la dissociation radicale du corps beau et du corps sain l'aurait-elle laissé un peu perplexe.
Ce détour par la beauté nous montre bien ce qui, dans toute caractérisation d'un sujet, exige la médiation du regard des autres, et pas seulement du sujet lui-même : un corps "n'est" beau que relativement au regard que d'autres portent sur lui. Mais il en va de même avec les autres caractérisations : qu'est-ce qu'être courageux ? Puis-je être courageux alors même que les autres me considèrent comme le dernier des lâches ? Puis-je être courageux alors que personne d'autre que moi ne l'admet ? Il faudrait donner une bien curieuse définition du courage... De même, je ne saurais être désirable sans être désiré. Je ne saurais être humble si les autres me considèrent comme prétentieux ; je ne peux pas être sympathique si je suis seul à le penser ; je ne peux pas être tolérant si les autres me pensent sectaire ; ouvert d'esprit si tout le monde me trouve obtus, etc, etc.
Bref : le regard de l'autre est bien une condition de mon existence en tant que sujet doté de tels ou tels traits de caractères. Il n'est pas "difficile", mais impossible d'être quelque chose sans que cette qualité ne soit attestée par le regard de l'autre : dans la majorité des cas, "être..." implique, par définition, le fait d'"être reconnu comme..." par l'autre.
(Man Ray, Noire et blanche )
Je ne peux donc me constituer en tant qu'identité que par le regard de l'autre. Mais l'autre ne fait pas que me désigner (m'identifier) par ces prédicats, ces traits de caractère qu'il m'octroie. On peut également dire que l'autre "me porte à être" cette image qu'il se fait de ce que je suis. C'est ce que nous dit Alain dans le texte que nous avons vu ensemble.
Avant d'approfondir cette dernière formule, il faut affronter une question qui n'est pas très éloignée de celle qu'ont du affronter les TL au bac l'année dernière : suis-je prisonnier du regard d'autrui ? Si le regard d'autrui me définit, puis-je éviter d'être déterminé, dans mon identité même, par ce regard ?
On pourrait être tenté de répondre : évidemment non. Dans la mesure où le regard de l'autre ne se construit pas tout seul : il prend appui sur l'ensemble de mes actes, de mes comportements passés. En changeant de comportement, je changerai donc le regard que les autres portent sur moi. En d'autres termes, je suis certes déterminé, dans ce que je suis, par le regard des autres ; mais c'est moi-même qui détermine (au moins en partie : faisons pour l'instant abstraction de tout ce que les autres "projettent" sur moi) ce regard, par mes actes.
Mais les choses ne sont pas si simples. Car je ne peux pas séparer radicalement ce que je fais, et la manière dont les autres me regardent, me "voient". Il est évident que mes actes influencent le regard des autres ; mais la réciproque, elle aussi, est vraie : la manière dont les autres me regardent influence ce que je fais, et de deux manières.
"Le regard des autres" : tableau à l'argile d'un artiste contemporain, Jean-Claude Apert
La première concerne l'influence que le corps social en général exerce sur mon comportement. Comme le remarque Jung (un psychanalyste Suisse que nous allons bientôt recroiser), tout corps social tend à exercer une force sur les individus qui les conduit à "rester à leur place". Pour Jung, le corps social n'aime pas le désordre : la société aime l'ordre social. Or quelqu'un qui sort de la place qu'il occupait, c'est un désordre. Un individu qui quitte sa place, qui sort de son "personnage" est un individu qui devient imprévisible (car le comportement d'un individu est toujours "prévu" sur la base de la place qu'il occupe dans le corps social et de son comportement passé). Or un individu imprévisible, c'est un individu inquiétant. C'est un individu dont on ne sait plus, précisément, ce qu'il va faire : c'est un individu qui, s'il n'est pas "capable de tout", est du moins capable de ne plus être celui qu'il était. Or un individu qui n'"est plus lui-même" et qui est "imprévisible", c'est toujours un individu dangereux...
[Pour les curieux, voici l'un des textes où Jung aborde ce thème :
La société attend et se doit d’attendre de chaque individu qu’il assume et joue de façon aussi parfaite que possible le rôle qui lui est imparti ; ainsi, par exemple, d’un individu qui est un pasteur, la société escompte non seulement qu’il assume sans heurts les obligations de sa charge, mais aussi qu’il soit à tous moments et en toutes circonstances impeccablement dans la peau du personnage de pasteur. La société exige cela comme une sorte de garantie et de sécurité. Que chacun demeure à sa place et se cantonne dans son domaine : celui-ci est cordonnier et cet autre, poète. Nul n’est tenu d’être, à la fois, l’un et l’autre. Il ne semble d’ailleurs pas recommandable d’être les deux à la fois, car on devient vite suspect : cela a quelque chose d’inquiétant. Carl Jung, "Dialectique du moi et de l'inconscient", 1933)]
A chacun sa place... et les vaches seront bien gardées.
Nous avons vu dans notre cours sur la liberté le type de procédures que le corps social pouvait mettre en place pour maintenir chaque individu "à sa place" ; nous avons étudié, par exemple, la manière dont le système scolaire faisait en sorte de maintenir chaque individu dans son statut social d'origine. Et, de façon plus familiale, presque tous les enfants ont un jour fait l'expérience des résistances plus ou moins conscientes qu'ont suscitées leurs premières prises de parole en tant que sujet autonome (dans le domaine politique, social, etc.) Il n'est pas toujours facile pour les parents "d'être à l'écoute" de ce que dit leur enfant... quand il se met à vouloir émettre des jugements ! Il est tout à fait naturel (du point de vue... social) d'être tenté de le "remettre à sa place". C'est que l'enfant en question "crée un désordre" : il sort de sa place d'enfant, il franchit une frontière symbolique, et franchir une frontière symbolique c'est toujours transgresser un interdit social. Il est intéressant de se rappeler que, dans certaines tribus d'Amérique du Sud (en particulier les Indiens Guayaki, au Paraguay), les rites qui accompagnent le passage de l'enfant à l'âge adulte sont tout à fait analogues à ceux que la tribu effectue lorsqu'il s'agit de laver une faute, d'effacer la transgression d'un "tabou".
L'ethnologue auquel on doit une très belle étude des indiens Guayaki : Pierre Clastres
La seconde raison pour laquelle le regard d'autrui détermine (en partie) mon comportement nous est donnée par le texte de notre ami Alain.
Pour Alain, je peux regarder les nuages en espérant qu'il ne pleuve pas, et en manifestant ouvertement mon optimisme : cela ne changera rigoureusement rien à la météo. Les choses restent indifférentes aux espoirs que je place en elles. Elles sont ce qu'elles sont, un point c'est tout. Mais il n'en va pas de même pour les êtres humains. Bien évidemment, la représentation que je me donne d'un individu, de ce qu'il est et de ce qu'il sera, est en partie déterminée par ce qu'il a été jusqu'à présent. Ce qu'il fera, je l'imagine en partie à partir de ce qu'il a fait et, en ce sens, on peut dire que les attentes des autres sont façonnées par mon comportement.
Mais la réciproque est également vraie : ce que je ferai est façonné par les attentes que les autres forment à mon endroit. Mon comportement n'est pas étranger aux attentes que les autres suscitent : si nul n'a confiance en moi, je n'ai à me rendre digne d'aucune confiance... et je perds ainsi l'une des plus forts incitations à me conduire en homme qui justifierait cette confiance. Pour prendre un exemple précis, c'est la raison pour laquelle les indications "négatives" du dossier scolaire (avertissement, etc.) sont très régulièrement effacées, anéanties. Mon comportement n'est pas étranger au comportement qu'autrui anticipe de ma part : toute confiance est une dette que je contracte, et dont je ne peux m'acquitter qu'en me rendant digne, par mes actes, de la confiance qui a été placée en moi.
Jean Valjean-Gabin dans l'une des premières adaptations des Misérables au cinéma.
C'est très exactement ce qu'illustre la figure de Jean Valjean. La "conversion" du personnage de Hugo est à comprendre comme le chemin par lequel celui-ci s'acquitte d'une dette, celle qu'il a contractée envers l'Evêque qui l'a accueilli et dont il a volé l'argenterie. Ce que lui témoigne l'Evêque en affirmant (aux gendarmes) qu'il s'agissait d'un don, c'est sa confiance dans le fait qu'il peut devenir, ainsi qu'il le lui a (soi-disant) promis, "un honnête homme". Cette confiance, Jean Valjean commence par la trahir, en volant la pièce d'un petit ramoneur (Petit-Gervais). C'est le dernier acte du "premier" Jean Valjean... qui disparaît alors derrière "le père Madeleine". Mais, comme le veut Alain, si le bagnard est devenu philanthrope, c'est pour répondre à la confiance que l'Evêque lui avait témoignée. Jean Valjean est ici devenu ce qu'un autre avait cru qu'il pourrait devenir: sans la confiance de l'Evêque, la conversion de Jean Valjean n'a aucun sens dans le roman de Hugo.A l'opposé de l'Evêque se trouve celui qui refuse de briser le cercle : le personnage de Javert incarne le regard de celui qui refuse à autrui toute possibilité de devenir autre que ce qu'il a été. Pour Javert (mais n'est-ce pas l'essence de la police que de poursuivre les individus, non pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils ont fait ?) il n'y a qu'un seul Jean Valjean, qui est et ne peut être autre chose que le bagnard en fuite qu'il a connu.
Il y a donc un cercle entre mes actes et les attentes d'autrui : mes actes passés façonnent les attentes des autres ; mais ces attentes des autres façonnent mes actes à venir. Dans le vocable philosophique, on appelle cela une structure "dialectique" : mes actes agissent sur des attentes qui rétro-agissent sur mes actes : c'est parce que les autres me font confiance que je me rends digne de cette confiance, c'est parce qu'ils n'attendent rien de moi que je deviens celui dont il ne faut rien attendre. Les croyances humaines sont des prophéties auto-réalisatrices : le fait même de croire tend à faire advenir ce en quoi je crois. Croire en l'autre, c'est l'aider à devenir ce que je crois qu'il peut être.
Autrui n'est pas seulement celui qui me désigne comme ce que je suis (beau, prétentieux, courageux, etc.) ; il est aussi celui qui me porte à être celui qu'il m'imagine être... ou devenir.
Ajouter un commentaire