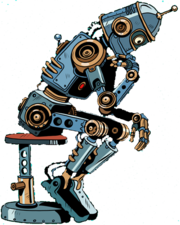Cahier de textes T3
Mercredi 07 septembre : accueil des élèves, présentation de la discipline (caractérisation, programme, épreuves...).
Etymologiquement, la philosophie est caractérisée par une démarche de recherche de la sagesse, c'est-à-dire :
_ de la connaissance vraie (le sage n'est pas un ignorant, il ne se trompe pas, de l'illusionne pas...)
_ de l'action juste (le sage ne commet jamais ce qu'il pense être injuste)
Cette recherche repose sur une remise en cause de toute autorité au profit d'une démarche de réflexion personnelle (rationnelle).
Jeudi 8 septembre (avec un peu d'avance) : A l'origine, toute démarche de recherche rationnelle de la vérité (et donc : l'ensemble des sciences) font partie de la "philosophie" ; jusqu'au 17e siècle, on ne dissocie pas réellement science et philosophie, et la quasi-totalité des grands "philosophes" du 17e siècle (Descartes, Leibniz, Pascal...) sont aussi de (très) grands scientifiques (mathématiciens, physiciens...), mais peuvent aussi être économistes, juristes, théologiens... Tant que la recherche repose sur une démarche d'argumentation rationnelle, il s'agit bien de "philosophie".
La séparation de la science et de la philosophie ne s'opère véritablement qu'à partir du 18e siècle, avec la transformation de la démarche scientifique, qui va prendre appui sur la méthode expérimentale, fondée sur (1) l'observation des faits (si possible en laboratoire), et (2) la formulation de lois permettant de rendre compte, sous une forme si possible mathématique, des observations. L'astronomie, la physique, la chimie, mais aussi la biologie et la médecine vont être les premières sciences à adopter la méthode expérimentale, considérée come la "méthode scientifique".
Or il existe des questions qui, tout en exigeant réflexion, ne peuvent pas être résolues par une démarche expérimentale. Par exemple, la question : "le recours à la violence peut-il être légitime ?", ne peut pas être résolue par des observations en laboratoire et des calculs mathématiques. Pas plus que la question de savoir si l'Etat le droit de porter atteinte aux libertés au nom de la sécurité, s'il existe une méthode permettant d'être heureux, etc.
Il y a donc des domaines porteurs de questions importantes, et qui exigent réflexion... mais qui ne peuvent être résolues par une démarche "scientifique". Des domaines dans lesquels on doit raisonner, mais sans pouvoir s'en remettre à la science. C'est ce domaine qui, peu à peu, va se différencier du domaine de la science sous le nom de "philosophie".
La frontière entre science et philosophie est fluctuante ; jusqu'au 19e siècle, l'étude rationnelle de l'esprit humain (psychologie), ou celle des sociétés humaines (sociologie) ne sont pas considérées comme relevant de la démarche expérimentale (on n'étudie pas les sociétés en laboratoire...) ; elles font donc partie de la philosophie, et non de la science.
C'est dans la seconde moitié du 19e siècle que des penseurs vont essayer de "sortir" la psychologie et la sociologie du domaine de la philosophie, pour les faire entrer dans le domaine des sciences. Ce sera notamment le projet de Freud pour la psychologie, de Durkheim pour la sociologie. Ces nouvelles sciences vont constituer ce que l'on appelle désormais : les "sciences humaines".
Il n'y a donc pas de frontière claire entre science et philosophie ; mais le domaine philosophique vise bien à prendre en charge les questions qui se posent à l'homme, qui exigent une démarche de réflexion rationnelle, mais qui ne peuvent pas être résolues par la science (même si la science peut contribuer à les éclairer). Ainsi, toutes les questions de "bioéthique" sont des questions philosophiques ; face à une question comme : "l'homme a-t-il le droit de développer des techniques dont les conséquences peuvent constituer un risque pour les générations futures ?", l'homme doit réfléchir ; il peut nourrir sa réflexion à l'aide de données scientifiques (quels risques ? quelles probabilités ? quelles solutions ?). Mais il ne pourra jamais répondre à cette question par des expériences en laboratoire ou des calculs mathématiques. L'homme doit donc réfléchir à des problèmes que la science ne peut résoudre. Il doit donc... philosopher.
Ajouter un commentaire