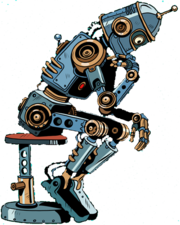Cahier de texte T5
Mardi 6 septembre : accueil des élèves, présentation de la discipline. (a) A partir de l'étymologie de "philosophie", nous dégageons l'idée selon laquelle la philosophie se définit comme une "recherche de la sagesse". (b) Une étude plus approfondie nous conduit à l'idée selon laquelle la philosophie repose sur une recherche rationnelle de la vérité et de la justice, fondée sur une démarche de remise en cause des préjugés et des discours d'autorité, au profit d'une réflexion argumentée. La philosophie se caractérise donc comme une démarche de recherche rationnelle, que l'on peut faire remonter à des penseurs de l'Antiquité comme Socrate, Platon, et Aristote.
Sous cette forme, elle ne se dissocie pas de la science. Et de fait, jusqu'au 17e siècle on ne dissocie pas clairement la science et la philosophie : le "philosophe" peut aussi bien désigner un physicien, un chimiste, un astronome, et inversement la quasi-totalité des grands philosophes du 17e siècle sont de grands scientifiques : Descartes, Pascal et Leibniz sont de très grands mathématiciens et physiciens...
La distinction entre science et philosophie ne s'opère qu'à partir du moment où le domaine de la "science" va se restreindre au champ dans lequel on peut mettre en oeuvre la "méthode expérimentale", conçue comme la seule méthode réellement scientifique. Cette méthode se caractérise par le fait que l'on analyse des observations, des expériences (réalisées si possible en laboratoire), pour formuler des lois (si possible sous forme mathématique). C'est cette démarche qui va fonder toute la science moderne, à partir du 18e siècle : astronomie, physique, chimie, biologie...
Or il existe des questions (importantes) auxquelles il faut réfléchir, mais auxquelles on ne peut pas répondre par la méthode expérimentale. Face à la question : "la violence peut-elle être légitime ?", il ne sert à rien de recourir à des expériences en laboratoire ou de faire des calculs mathématiques. Et pourtant, il serait très dangereux de laisser cette question aux préjugés ou aux discours d'autorité.... Il faut raisonner. De même, il est (très) souhaitable de se demander si l'Etat a le droit de porter atteinte aux libertés, au nom de la sécurité. Comme il est important de se demander s'il existe une méthode permettant d'être heureux, etc. Mais là encore, ce ne sont ni les expériences en laboratoire, ni les calculs mathématiques qui permettent de résoudre le problème.
Raisonner, là où la science ne peut résoudre les problèmes : c'est le propre de la philosophie.
Par exemple, tous les problèmes de "bioéthique" sont des problèmes philosophiques. A la question de savoir si l'on doit autoriser le clonage humain, il faut que les citoyens donnent une réponse réfléchie. La science peut éclairer le débat (comment peut-on cloner ? pour quelles applications ? quels sont les risques ?) ; mais elle ne peut pas du tout trancher la question. Ce n'est pas en faisant des expériences en labo ou des calculs mathématiques que l'on saura si l'on doit mettre en oeuvre le clonage. C'est une question politique et morale, qui engage notre responsabilité à l'égard des générations futures. Comme telle, elle exige de nous une réponse réfléchie ; mais elle ne peut obtenir aucune réponse scientifique.
La frontière entre science et philosophie est fluctuante. Jusqu'au 19e siècle, l'étude rationnelle de l'esprit humain (la "psychologie"), ou celle des sociétés humaines (la "sociologie") ne sont pas considérées comme des études "scientifiques" ; elles font donc partie du champ philosophique. C'est à la fin du 19e siècle que des penseurs vont tenter de rattacher la psychologie et la sociologie au domaine des sciences à part entière (des sciences expérimentales), les faisant ainsi sortir du champ philosophique. C'est ainsi que sont nées les "sciences humaines".
Ce qui est amusant, c'est que certains des penseurs qui ont le plus oeuvré pour faire en sorte que la psychologie (Freud) et la sociologie (Durkheim) ne soient plus considérées comme de la "philosophie", mais bien comme des sciences à part entière, font aujourd'hui partie du programme... de philosophie !
Il faut donc moins chercher à opposer science et philosophie, qu'à saisir ce qui fait leur unité (remise en cause des préjugés et argumentation rationnelle), pour mieux mettre en lumière leur différence (la possibilité de recourir à la démarche expérimentale).
Parmi les domaines au sein desquels chacun doit tenter d'apporter une réponse réfléchie et argumentée aux problèmes qu'il rencontre, mais où les expériences et les calculs sont de peu d'utilité, se trouve le domaine politique. C'est donc par un questionnement politique que nous allons débuter cette année.
Ajouter un commentaire