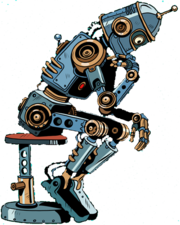L'Etabli : l'atomisation du collectif
L'Etabli de LInhart : l'atomisation du collectif comme arme de domination
L'après-midi, Junot continue. Convocation. Savon. « Pouvez disposer ».
Sa méthode est simple et efficace. Il fait que chaque gréviste se sente individuellement repéré, visé. L'arracher à la relative protection de l'action collective, au cours de laquelle il peut se croire fondu dans la masse, presque anonyme. Qu'il entende prononcer son nom. Qu'il l'aperçoive entouré de rouge sur la liste que tient Junot. Qu'il sente, ne serait-ce que quelques instants, toute la machine Citroën peser sur lui seul, entre les quatre murs de ce bureau nu, métallique, résonnant du vacarme des chaînes voisines. (108)
Mon poste. Dupré m'y attend. Narquois, me semble-t-il. Marchant tête basse, j'ai presque buté contre lui. Qu'est-ce qu''il fout là, à côté des balancelles ?
« Tu es muté à l'annexe de la rue Nationale. Voici ton bon de sortie. Tu dois y être à sept heures trente. »
Qu'est-ce que c'est que ça, l'annexe de la rue Nationale ? Jamais entendu parler.
« Mais...
_ Il n'y a pas de mais : tu as juste le temps d'y aller. Il faut que tu prennes ton vestiaire, tu ne reviendras pas ici. » (…)
Le dépôt des pièces détachées Panhard, administrativement rattaché à l'usine Citroën de la porte de Choisy, croupit dans un vieil entrepôt coincé dans un renfoncement entre des immeubles d'habitation. Cul-de-sac complètement isolé, à cinq minutes de marche de l'usine. Travaillent ici onze personnes, dont un chef d'équipe et un vieux gardien à moitié sourd.
La fourmi qui s'active dans la fourmilière ignore que dans quelques instants une main de géant la détachera avec précision de la masse de ses compagnes pour la déposer à l'écart de tout, dans un bocal. Il ne lui restera plus qu'à tourner en rond le long des parois glacées, encore toute frémissante de la foule récente, hébétée par la surprise de cette solitude.
Pendant que je me hâtais vers les balancelles ce matin, le paquet de tracts serré contre mon corps, la tête pleine de choses de la grève, tendu vers la journée comme on peut l'être vers une bataille, mon cas avait déjà été réglé là-haut dans les bureaux et je ne le savais pas.
Maintenant, il est sept heures et demie du matin et je suis dans l'entrepôt, mon nouveau lieu de travail. Je me répète, stupéfait par la rapidité de ce changement : l »usine, atelier 85, la grande chaîne, les 2CV, la grève, tout cela est fini pour moi, je ne pourrai plus le suivre que du dehors. Mais je n'arrive pas à le penser.
Je suis dans le bocal. (115)
C'est une pratique courante, dans les entreprises, de reléguer les gêneurs, les agités ou les militants syndicalistes trop encombrants dans des endroits isolés, des annexes perdues, des magasins, des cours, des dépôts. Un licenciement risque toujours de provoquer un conflit, de mobiliser des gens autour de la victime. Pourquoi courir ce risque si l'on ,peut obtenir le même résultat sans appel possible ? Le patronat est le seul maître de l'organisation du travail, n'est-ce pas ? Si la direction décide que vous êtes indispensable à la surveillance d'un cagibi, à un bon kilomètre de l'atelier où vous étiez implanté, vous n'avez qu'à obtempérer ou prendre votre compte.
Cela, je le savais. Mais je n'imaginais pas le choc brutal que cela représente. Vous vous sentez arraché, comme un membre vivant, coupé tout palpitant encore de l'organisme. Les premiers jours, l'univers familier de la grande chaîne et de ses dépendances me manqua physiquement. Tout me manquait. Les allers-retours vifs de Simon poussant ses chariots et colportant ses tracts. Les petits gestes d'amitié des Yougoslaves du carrousel. Les femmes de la sellerie. La démarche lente et hautaine des Maliens. Les emportements de Christian, les visites furtives de Sadok, les petits meetings de la troisième marche... Tout.
J'étais, dix heures par jour, enfermé dans un cul-de-sac absurde, réduit à compter les heures et à supputer anxieusement l'état de notre grève. (121)
L'isolement, l'absence d'objet précis sur lequel concentrer ma colère (je n'avais aucune raison d'en vouloir au chef d'équipe tout vermoulu de l'entrepôt, ou d'agresser le gardien sourd qui somnolait près de l'horloge-pointeuse), le ressassement répété mais qui, ici, devenait abstrait, de la répression à Choisy, finirent par épuiser ma rage du début. Je tombai dans une indifférence frileuse. J'avais progressivement adopté la démarche traînante de mes collègues et il me semblait parfois, quand je glissais dans le silence de l'entrepôt à la recherche de quelque levier de vitesse ou d'un pare-brise, sentir à mes pieds d'invisibles pantoufles.
Des nouvelles me parvenaient, au hasard des rencontres et des va-et-vient épisodiques entre la rue Nationale et l'avenue de Choisy. (…)
L'ordre rétabli refoulait chacun dans sa solitude. Quand je croisais Sadok le soir et que nous échangions quelques mots, je lui trouvais l'élocution pâteuse et son haleine sentait très fort l'alcool.
Le seul avec qui je maintins un contact régulier fut Primo. (…) Nous prîmes l'habitude de nous retrouver tous les vendredis. (…) Pour ma part, l'effort d'exposé politique une fois fait, et après que Primo m'avait donné son opinion et communiqué les informations qu'il avait, je gardais presque le silence, regagnant bien vite ma léthargie. Primo me sentait absent, il essayait de me remonter le moral. Je l'écoutais vaguement, comme à travers un brouillard.
Hiver interminable. (130)
Brusquement, au début du mois de mars, alors que rien n'annonçait l'orage, la direction déclencha une persécution systématique des ouvriers les plus actifs du comité de base. Cette répression sélective visa avec une telle précision les éléments durs de notre groupe que je me demandai dans quelle mesure le flicage Citroën avait permis à la boîte de connaître notre fonctionnement interne.
Tombèrent successivement : Christian ; Georges ; Stepan, Pavel ; Primo.
La méthode d'attaque fut la même dans chaque cas. Pas de licenciement, mais un laminage intensif : rendre la vie impossible à celui qui est visé. Toute la machine de surveillance, de harcèlement et de chantage qui s'était, dès le 18 février, abattue sur l'ensemble des ouvriers grévistes de l'usine se concentrait maintenant, méthodiquement, sur les « fortes têtes » repérées. La direction avait choisi une petite dizaine de personnes à éliminer. On saurait les obliger à « prendre leur compte » – à disparaître. (124)
Les trois Yougoslaves du carrousel des portières avaient organisé leur travail depuis longtemps, indépendamment de la disposition officielle. Affectés au montage des serrures, ils avaient transformé et regroupé les opérations de façon à pouvoir se libérer par rotation de la servitude de la chaîne. Leur habileté manuelle et leur rapidité leur avaient ainsi permis de conquérir une zone de fonctionnement autonome là où seules les décisions du bureau des méthodes étaient censées faire la loi. La maîtrise ne trouvant qu'avantages à cet arrangement – il n'y avait jamais de retard ni de pièces défectueuses –, laissait faire.
Quand la décision fut prise de frapper, le contre-maître Huguet n'eut pas de mal à trouver la méthode de représailles la plus efficace contre les trois hommes : il les sépara. (…)
Dispersés, privés brutalement d'un rythme de vie au travail qu'ils avaient patiemment construit pendant des années, affectés à des postes spécialement pénibles, les trois Yougoslaves décidèrent d'un commun accord que cela suffisait. (125)
Ajouter un commentaire