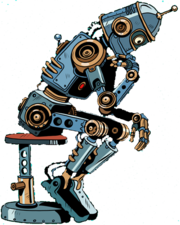L'Etabli : conversation avec Ali
L'Etabli de Linhart : la conversation avec Ali
La rencontre d'Ali joua un rôle décisif dans la transformation de mon état d'esprit. Un choc, mais si complexe que, même aujourd'hui, je ne pourrais le définir avec exactitude, alors que près de dix ans ont passé. Une bouffée d'air du grand large, la vision soudaine de masses tellement plus lointaines et plus obscures, et aussi la découverte de quelque chose de fraternel et de tragique à la fois. Mais les mots, tout à coup, me semblent faibles, et impropres.
Je n'ai connu Ali qu'un seul jour.
Une journée complète de travail, de sept heures du matin à cinq heures du soir. Et, quoique je ne l'aie jamais revu par la suite, il m'arrive souvent de penser à lui.
Ce matin-là, mon travail d'homme-chaîne s'agrémentait d'une variante.
Il y avait eu un incident à l'atelier d'emboutissage. Plusieurs presses marchaient irrégulièrement, les gens de l'outillage et les électriciens étaient sur place, tout un branle-bas assez inefficace pour le moment : les caisses ne sortaient que par intermittences. La régularité de mes allers-retours et l'approvisionnement continu de l'atelier de soudure se trouvaient ainsi compromis. Mais ce genre d'interruption était prévue et un dispositif complémentaire fut mis en marche.
Dès mon arrivée, à sept heures, Danglois m'emmène dans un vaste bâtiment, isolé à l'extrémité de la cour, où sont empilées en rangées plusieurs centaines de « caisses » de 2 CV. C'est une réserve. Un homme est là, debout au milieu d'une rangée. Danglois me le désigne d'un geste négligent du pouce : « Il te passera des caisses chaque fois qu'il y aura un trou à la sortie de l'emboutissage ; t'auras qu'à passer par ici pour combler. Vu ? » J'opine vaguement de la tête. L'homme, lui, n'a pas bougé. Il paraît même ne pas avoir entendu. (…)
Chaque fois que je repasse par l'entrepôt, je lui jette un regard rapide, parfois un sourire, mais sans jamais avoir le temps de m'arrêter ni de lui parler. Lui, de son côté, ne dit pas un mot.
Il est grand, très maigre, brun de peau. Il me semble le connaître de vue, pour avoir remarqué, en le croisant dans les ateliers ou les vestiaires, le tatouage bleu, en forme de point, qu'il porte au bas du front, entre les sourcils, et qui souligne son air farouche. Dès que j'entre dans le bâtiment, il me tend une caisse, qu'il porte de ses deux bras largement écartés, en un mouvement régulier et précis, toujours identique. Puis, il reprend aussitôt sa pose : immobile, droit au milieu de l'entrepôt, les bras croisés, le regard lointain, comme s'il montait la garde au bord de quelque campement du désert.
J'ai plusieurs fois un mouvement pour lui parler, mais je suis trop bousculé à courir aux trois coins de la cour avec mes carrosseries brinquebalantes et mes chariots de fonte. Et comme lui-même paraît absent, la manœuvre se répète en silence.
Huit heures et quart : pause de dix minutes pour le casse-croûte. Je reviens m'abriter dans l'entrepôt de stockage, glacial mais protégé de la pluie fine qui continue de frapper la cour en petites bourrasques. Je m'adosse à une carrosserie et sors mon sandwich. L'homme au tatouage ne bouge pas. Toujours debout, indifférent à la pause : elle ne paraît pas le concerner. Je m'approche et lui propose de partager, puisqu'il paraît ne rien avoir apporté à manger. Il jette un coup d’œil sur le pain d'où dépasse une tranche de jambon, et secoue la tête en signe de refus :
« Je ne mange pas de cochon. »
Puis, d'une voix grave, comme s'il ne s'adressait pas directement à moi mais poursuivait sa rêverie :
« Je suis fils de marabout.
Mon père est un marabout très important, un grand religieux.
J'ai beaucoup étudié.
Beaucoup étudié l'arabe.
La grammaire arabe.
C'est très important. »
Un silence. Puis il me fixe soudain du regard (surprise de ces deux yeux étincelants, d'un noir intense) et se lance dans un long discours, dont j'ai du mal à saisir complètement le sens, parce que son français est heurté, d'un accent rugueux, et qu'il me paraît souvent employer un mot pour un autre – et parfois même des mots inconnus. Je comprends quand même qu'il s'appelle Ali, qu'il est Marocain, d'une famille très religieuse, qu'il a fait des études coraniques, que son père est mort, que les siens vivent dans la misère depuis longtemps. Suit le récit d'un épisode personnel embrouillé, où il est à plusieurs reprises question d'un couteau, et dont le sens général m'échappe. Il me semble qu'il entremêle son récit de citations du Coran, mais je n'en aperçois pas plus la signification. Puis, sans transition, il prononce très distinctement – comme en épelant, pour que je comprenne bien – quelques phrases brèves. Et là, je comprends à nouveau, et ce qu'il me dit me fait une forte impression :
« La langue arabe est une très grande langue.
Ce sont les Arabes qui ont inventé la grammaire.
Ils ont aussi inventé les mathématiques, et les chiffres pour le monde entier.
Ils ont inventé beaucoup de choses. »
Il a élevé la voix, et sa fierté résonne étrangement dans l'entrepôt métallique, qui renvoie l'écho.
Emu, je commence une réponse un peu solennelle, cherchant mes mots pour dire en phrases simples que j'ai un grand respect pour la culture arabe. Et, dans le temps que j'entreprends cette réponse, il me semble que je nous vois de loin, seuls, debout face à face, dans ce bâtiment vaste et vide, où il n'y a que des piles de caisses, ferrailles grises, armatures stupides de voitures à venir. Moi avec ma veste de bleu de travail élimée, déchirée par les tôles aiguës qui accrochent. Lui flottant dans une combinaison de manœuvre trop large pour sa maigreur, trop courte pour sa haute taille. Et ce dialogue solennel, irréel, de plénipotentiaires de cultures lointaines, de langues lointaines, de façon d'être lointaines. Et rien de cela ne me semble ridicule ni déplacé, mais au contraire grave et important. (145)
Je m'arrête.
« Écoute, Ali, je sais ce que je dis, je suis juif moi-même. »
Et lui, sans se démonter, avec un hochement de tête indulgent et presque une ébauche de sourire :
« Mais tu peux pas être juif. Toi, tu es bien. Juif, ça veut dire quand c'est pas bien. »
Ça aurait pu durer des heures. Nouvelle impasse. Les opérations de déchargement des caisses nous interrompent encore.
L'après-midi s'écoula ainsi, chaotique. Gouffre de deux langues, de deux univers. J'essayais d'imaginer dans quel monde vivait Ali, comment il percevait les choses, et une impression d'infini me saisissait. Il aurait fallu parler des années, des dizaines d'années... Nous n'aurions jamais dû nous rencontrer et le hasard nous avait mis face à face. Le hasard ? Pas tout à fait. La grève et ses suites, plus ou moins directes. Et j'avais en même temps le sentiment d'un Ali très proche. Le gréviste solitaire et buté, l'enfant au chien noir, le souffre-douleur de Danglois. Un frère obscur, un instant surgi de la nuit qui allait le happer de nouveau.
Effectivement, on le baladait de poste en poste, de brimade en brimade, et dès le lendemain il avait disparu. […] Finalement, j'appris qu'on l'avait stabilisé à l'usine de Javel.
Au nettoyage des chiottes. (151)
[Remarque : L'Etabli est dédié à Ali : « à Ali, fils de Marabout, et manœuvre chez Citroën »
Ajouter un commentaire