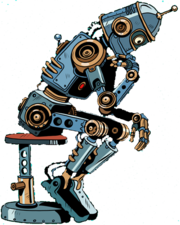Espace TL
Vous trouverez ici des synthèses de cours, les textes étudiés, des supports pour DM, des références à consulter... Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser l'espace "posez vos questions" sur la page d'accueil !
Catégories
-
A partir du lundi 16 mars, vous trouverez dans cet espace les différents éléments (cours, exercices, supports de révision, etc.) qui nous permettront de poursuivre le travail à distance. Ces éléments seront regroupés par séquences, mises à jour périodiquement : pour chaque séquence, vous trouverez :
1. Une présentation du contenu de la séquence (cours, type de support utilisé : analyse de textes, etc.)
2. Une section de cours
3. Un ensemble d'exercices en ligne permettant de tester l'acquisition du cours
4. (périodiquement) Un travail à effectuer. En cas de prolongation de la fermeture des lycées, les travaux seront à renvoyer à l'adresse : pgarandel@gmail.com
La rubrique "posez vos questions" du site est évidemment à solliciter sans réserves.
Les quiz d'entraînement (passés et à venir) sont également à solliciter : ils constituent un très bon support de révision des contenus déjà parcourus.
Bon courage.
PG
-

Vous trouverez ici le cahier de textes des TL2. Pour des raisons de commodité, il est présenté sous une forme blog : la dernière date renseignée se trouve donc en haut du document. J'ajoute parfois des liens internes, que vous pouvez consulter pour obtenir des précisions sur le contenu d'une séquence. Si quelque chose vous laisse perplexe (point de cours, élément de méthodologie, etc.) n'hésitez pas à mobiliser l'espace posez vos questions...
29.01. (suite) Nous montrons que cette solidarité des espaces culturels vaut notamment pour l’œuvre d'art. En prenant appui sur les œuvres au programme de littérature, et sur des illustrations musicales (guitare, clavier) nous montrons que toute œuvre d'art doit être resituée dans le contexte culturel auquel elle appartient (contexte religieux, politique, etc.) : « comprendre » une œuvre d'art, c'est d'abord opérer cette réintégration de l’œuvre dans le contexte culturel qui lui donne sens.
Nous montrons par ailleurs que cette solidarité est particulière en ce qui concerne l'art, dans la mesure où on peut concevoir le domaine artistique comme un espace au sein duquel s'exprime, se manifeste ce qui fait l'identité culturelle d'une communauté.
En prenant appui sur le cas de « 'invention » ou de la « découverte » (mots dont nous montrons qu'ils sont impropres) de la perspective dans l'art pictural de la Renaissance, nous montrons en quoi cette émergence exprime, manifeste les principes fondamentaux de l'Humanisme : toute représentation du réel doit s'ancrer dans le monde tel qu'il apparaît à l'homme (le point de vue humain est le point de vue vrai), et cette représentation doit prendre appui sur les lois géométriques qui fondent aussi bien le regard humain que la nature elle-même, telle qu'elle a été conçue par Dieu. Si la représentation « en perspective » est à la fois une représentation qui adopte le point de vue de l'Homme, et que ce point de vue est saisi comme un point de vue dans lequel la nature géométrique du réel se manifeste (et peut être ressaisie par la raison), la perspective constitue bel et bien un mode d'expression et de manifestation de la culture humaniste.
Rappel : l'explication de texte (DM) est à rendre pour mardi.
28.01. Nous débutons la séance par une mise au point concernant la procédure Parcoursup.
Nous passons ensuite à notre dernière problématique concernant l'art : la question du rapport entre l'art et la culture. Nous commençons par une analyse de la notion de culture, dont nous distinguons trois sens.
a. La culture comme ensemble des éléments proprement humains (le langage, la politique, la religion, la science, l'art...)
b. la culture comme vision du monde et manière de vivre propre à une communauté humaine (à laquelle se rattachent les langues, des croyances religieuses, des institutions politiques, des pratiques techniques et artistiques... déterminées.)
c. la culture de l'homme « cultivé » (un ensemble de connaissances dont la valeur est fondée sur le prestige)
Nous montrons en quoi cette analyse nous conduit à un triple questionnement :
a. En quoi l'art participe-t-il de ce qui fait l'humanité de l'homme ?
b. En quoi l'art est-il solidaire de la culture à laquelle il appartient ?
c. Faut-il être cultivé pour apprécier la valeur d'une œuvre d'art ?
Nous commencerons par la question la plus simple : la seconde. Pour le faire, nous commençons par montrer en quoi une culture constitue toujours un tout, une unité dont tous les éléments sont nécessairement solidaires : les croyances religieuses sont liées aux valeurs morales, qui sont liées aux conceptions de la justice, qui sont liées aux institutions politiques et au droit, qui sont liés aux pratiques commerciales, qui sont liées aux techniques de production, etc. Il est donc tout à fait impossible d'isoler un espace de la culture des autres espaces culturels.
24.01. La seconde voie de dépassement que nous envisageons est celle qui consiste à affirmer que (1) la beauté est bien la (seule) chose que doit viser l'artiste... mais que c'est précisément dans la mesure où l’œuvre est belle qu'elle peut avoir une valeur morale ou politique.
Nous prenons appui sur les idées de SCHILLER pour montrer en quoi l’œuvre d'art, en tant qu'oeuvre belle, peut jouer un rôle d'éducation morale. En nous réapprenant à « faire jouer » ensemble, et de façon harmonieuse, notre sensibilité et notre esprit (notamment par le travail d'interprétation), l’œuvre nous habitue à surmonter le conflit qui les oppose. Nous illustrons cette thèse de Schiller avec des figures extraites de l’œuvre romanesque de Victor Hugo.
Nous terminons l'analyse des rapports entre art, morale et politique en montrant comment, dans le poème d'ARAGON intitulé Ce que dit Elsa, nous retrouvons la thèse d'une valeur politique de l’œuvre en tant qu'oeuvre belle. Ceux auxquels le poète doit s'adresser, ce ne sont pas les membres d'une élite cultivée, mais bien ceux qui souffrent et qui, pour poursuivre leur lutte, ont besoin... non de tracts politiques (que d'autres que l'artiste peuvent leur fournir) mais bien de poèmes qu'ils puissent « tout bas répéter en songeant ». L'artiste a donc bien un rôle politique à jouer : mais il ne le jouera que dans la mesure où il produit des œuvres belles, car la beauté est aussi ce à quoi aspirent ceux que « tout invite au trépas ». ce qu'Elsa demande donc à Aragon, ce n'est pas d'écrire des poèmes politiques, mais de beaux poèmes, dont la beauté soit accessibles aux opprimés. Ce qu'elle lui demande, c'est une chose très difficile : c'est de produire un art populaire, accessible au plus grand nombre sans sacrifier sa valeur esthétique.
23.01. (suite) 3) L'art doit-il être engagé ?
Nous posons à présent la question de l'engagement politique de l’œuvre : en repartant de Gautier, nous montrons en quoi l'engagement politique de l’œuvre constitue une menace pour sa valeur esthétique. Mais nous montrons également que l'idée d'un « désengagement » de l'artiste semble contradictoire. En effet :
a. si l’œuvre doit constituer l'expression de l'identité de l'artiste (Bergson), on voit mal comment l’œuvre pourrait éviter de porter et d'exprimer les valeurs de l'artiste (sauf à faire de l'artiste un être sans valeur... et donc sans personnalité!)
b. en prenant appui sur Sartre, nous montrons que, dans le cas de la littérature, toute neutralité est illusoire : le seul choix des thèmes et des mots suffit à engager l'artiste, qu'il le veuille ou non. Toute prise de parole est nécessairement une prise de position face aux problèmes de mon époque. Nous indiquons que ce problème a été saisi et vécu par des auteurs qui, au départ, ne souhaitaient pas « mélanger » l'engagement politique et le travail artistique, comme Thomas MANN.
Nous cherchons alors des voies de dépassement de l'opposition entre une neutralité toujours illusoire et un engagement toujours esthétiquement compromettant. La première « solution » envisagée est celle du Romantisme, qui cherche à mettre l’œuvre (ou le personnage romanesque) au service d'une cause... posée dès l'abord comme désespérée. En prenant appui sur la formule de Cyrano : « c'est tellement plus beau lorsque c'est inutile », nous montrons que ce qui fait la « beauté du geste » romantique, ce n'est pas qu'il est gratuit, mais qu'il tend vers un but... inaccessible, impossible à atteindre (nous analysons ce qui fait la beauté du sacrifice de Lorenzaccio).
22.01. D) L'art doit-il servir ?
1) La doctrine de « l'art pour l'art »
Nous analysons les deux sens possibles de la question, qui interroge à la fois l'utilisation possible d'une oeuvre d'art, et sa mobilisation au service d'une cause.
Nous rappelons l'opposition entre beauté et utilité, en prenant appui sur les "ready made" de Duchamp, et sur les arguments qui justifient la doctrine de "l'art pour l'art" : pour Théophile Gautier, tout ce qui est utile est nécessairement laid (du fait de la laideur de nos besoins) et inversement ce qui est beau est nécessairement inutile ; on ne se "sert" pas d'un vase chinois (que l'on expose), mais on n'expose évidemment pas un "vase de nuit" [pot de chambre] (dont on se sert). Nous revenons sur l'utilité paradoxale de l'oeuvre d'art chez Bergson : c'est justement en ce qu'il nous oriente vers ce qui n'a pas d'utilité que l'art nous cultive (en ce sens, l'utilité de l'oeuvre d'art consiste d'abord... à ne servir à rien).
Nous indiquons que, pour Gautier, cette « inutilité » de l’œuvre d'art ne se limite pas à son utilité « technique » : elle vise également son utilité morale, politique, ou religieuse. Si l’œuvre d'art ne doit pas « servir », c'est aussi au sens où elle ne doit pas se mettre au service d'autre chose... que la beauté. Si l'artiste veut servir deux maîtres... il échouera sur les deux plans : une oeuvre qui se veut « moralisante » ne sera ni efficace d'un point de vue éthique, ni belle esthétiquement.
L'oeuvre d'art ne doit donc viser... que la beauté. Mais qu'est-ce au juste que la beauté ? Et la beauté n'est-elle pas, d'elle-même, liée à la morale ?
2) La beauté peut-elle être immorale ?
Nous commençons par analyser de façon plus précise la notion de « beauté ». En prenant appui sur Kant, nous montrons que la valeur esthétique d'une œuvre d'art, la plaisir esthétique qu'elle provoque, doit être saisi dans son opposition avec les autres formes du plaisir humain. Nous distinguons ainsi le plaisir esthétique de l'agréable, mais aussi du plaisir provoqué à la perfection technique, et du plaisir provoqué par la valeur morale. Ceci nous conduit à la caractérisation kantienne du plaisir esthétique comme plaisir « désintéressé ».
Cette analyse de la beauté nous permet de poser a question de l'articulation entre la valeur esthétique de l’œuvre et sa valeur morale. Peuvent-elles s'opposer ? Une œuvre immorale peut-elle être belle ?
Nous retraçons d'abord l'histoire de cette question au sein de l'art occidental. Sous cette forme, la question ne se pose pas réellement dans l'Antiquité (grecque) dans la mesure où l'on postule un accord spontané, naturel, entre les grandes valeurs que sont le Vrai, le Bien et le Beau. De même que la justice repose sur le "bon rapport", le Beau repose sur la bonne proportion, sur l'harmonie. Ce qui contredit l'ordre naturel, le "cosmos", ne peut être que dif-forme, voire monstrueux. Par opposition, la beauté du corps se mesure à sa conformité au "canon", au modèle dans lequel se trouvent respectées les justes proportions. Il en va de même pour le domaine moral : le comportement vertueux, c'est celui qui est mesuré, celui qui fait preuve de tempérance, celui qui s'écarte des extrêmes que constitueraient des vices. En ce sens, le contraire absolu de la vertu antique, c'est la démesure, à laquelle nous conduit l'hybris. De sorte que, pour un penseur antique comme Platon, il y a nécessairement accord entre le Beau et le Bien.
Nous montrons ensuite comment cette « harmonie » entre le beau et le bien s'est trouvée déstabilisée, voire détruite, notamment dans l'art du 19e siècle. En prenant appui sur les principes du romantisme, nous montrons comment la beauté comme « mesure » s'est trouvée détruite par l'articulation entre la beauté et la « nature » considérée, non plus comme un ordre logique et cohérent, rationnel, mais au contraire comme une force porteuse d'infini, de passion, etc. Cette désarticulation a servi de support au divorce entre esthétique et morale, qui trouve une illustration dans les fleurs du Mal de Baudelaire.
21.01. C) L'art et la technique.
1) L'artiste comme artisan. En prenant appui sur un texte d'Alain, nous montrons que le fondement de la création artistique est le travail de l'artiste, qui doit mettre en forme un matériau conformément à des contraintes qui lui sont imposées. Qu'il s'agisse des contraintes internes du matériau (bloc de marbre), de la commande faite à l'artiste, des règles de l'art (versification, etc.) nous montrons que les contraintes ne sont pas des obstacles, mais des conditions de la liberté en tant que création : c'est parce que l'imagination de l'artiste entre en dialogue avec ces contraintes qu'elle peut se montrer créative. Nous illustrons ce propos d'Alain par des oeuvres tirées de la sculpture (Rodin) et de la littérature.
2) Différenciation de l'artiste et de l'artisan.
En poursuivant l'analyse du texte d'Alain, nous montrons que l'affirmation de Marx relative au travail humain (l'homme conçoit d'abord dans son esprit ce qu'il réalise ensuite matériellement) n'est pas valide pour l'artiste. Dans la création artistique (qui est donc bien "création"), l'invention de l'oeuvre est simultanée à sa production : l'imagination est indissociable de la production concrète, qui sert de support perpétuel à la réélaboration de l'oeuvre. Nous illustrons cette affirmation avec des extraits du film de Clouzot : Le mystère Picasso, qui montrent que l'invention est toujours simultanée à la production (l'artiste invente et découvre l'oeuvre en la produisant, d'où les phénomènes de modification perpétuelle que connaît l'oeuvre au cours de sa production). Nous prenons également appui sur des photographies des brouillons de Proust (même constat).
Pour visualiser des extraits du Mystère Picasso de Clouzot
La conclusion qui s'impose est alors que chaque oeuvre d'art est nécessairement unique, chaque production impliquant une nouvelle invention. Nous illustrons cette affirmation avec le rôle de l'improvisation dans le jazz, et dans le domaine pictural : un peintre peut peindre 100 fois le même paysage, mais il ne peut pas peindre deux fois le même tableau. Ce que montrent les représentations de la Montagne Saint Victoire par Cézanne, ou nes Nymphéas de Monet (qui peint son jardin de Giverny, dont il a lui-même conçu les plans : articulation des démarches artisanale (pré-conception de l'objet) et artistique (création unique). Cela permet de comprendre pourquoi il ne peut y avoir de "recette" en art, et le problème que pose la notion d'école artistique : lorsque le geste créateur se transforme en protocole à suivre, que devient la création ?
3) Articulation de l'artistique et de l'artisanal : le cas de l'architecture.
Nous terminons la mise en parallèle de laproduction artisanale et de la création artistique en montrant comment les deux démarches trouvent des voies d'articulation nouvelles du fait des transformations techniques du XX° siècle, dans le domaine de l'architecture. Les principes suivis par Le Corbusier montrent la nécessité de concilier une approche purement rationnelle-fonctionnelle de la conception architecturale (suppression du couloir, suppression de la rue, etc.) avec une approche esthético-éthique (pureté des formes, luminosité, insonorisation), capable d'appréhender le fait d'habiter comme un phénomène humain global. De même, le Bauhaus indique la manière dont le progrès technique permet de concilier les exigences de la recherche esthétique et de la production en série (émergence du designer).
Nous insistons sur le danger que représente une dissociation radicale du travail productif et de la création artistique dans le travail humain : un travail qui serait pure reproduction mécanique d'un modèle conçu dès le départ perd une dimension essentielle de son humanité.
17.01. 6) Réalisme, naturalisme et critique du réel
Nous montrons enfin que la re-présentation du réel peut avoir une fonction critique, lorsque le réel est montré dans sa réalité pour être dénoncé, ou pour donner les moyens de le transformer : ce que nous illustrons à travers le cas du "naturalisme" de Zola. La littérature devient alors un instrument qui accompagne la démarche scientifique, qui met en lumière les lois qui régissent le réel pour mieux nous donner les moyens d'agir sur le réel. Mais là encore, l'oeuvre d'art ne le fait pas en nous donnant une "théorie" du réel, mais en le faisant apparaître sous une forme sensible. L'oeuvre nous donne ainsi une "perception intelligente" de la réalité.
7) L'oeuvre d'art : une modification de notre regard sur le réel ?
Nous terminons notre cheminement sur le rapport entre l'art et la nature en prenant appui sur un texte de Bergson : si l'artiste peut nous montrer ce que nous ne voyons pas, n'est-ce pas parce qu'il modifie le regard que nous portons sur la réalité ? En prenant appui sur le prétendu "idéalisme" de l'artiste, nous rappelons que notre vision du monde est appauvrie par la recherche d'une satisfaction des exigences de la survie et de la réussite matérielle. L'artiste "voit" donc ce que nous ne percevons plus du fait de notre rapport utilitaire à la réalité.
La première question est alors de savoir comment il parvient à nous le montrer : on indique que c'est par la posture que l'oeuvre exige de nous (posture contemplative, non utilitaire) que l'art peut nous ré-apprendre à contempler le monde plutôt que de le réduire en le mettant à notre service. La seconde question porte sur l'intérêt de cette démarche : quelle est l'utilité de nous faire voir ce qui ne sert à rien ? Cette question nous permet une première fois d'aborder l'épineuse question de l'utilité de l'oeuvre d'art.
Nous montrons que l'oeuvre d'art n'a pas "d'utilité" (on ne peut pas "s'en servir"), et que son sens (contrairement à celui des objets techniques) ne peut donc pas être réduit à sa fonction.
Le texte de Bergson nous permet de mettre en lumière la différenciation nécessaire de la valeur et de l'utilité. En prenant appui sur le rapport social, nous montrons que c'est justement lorsqu'il cesse d'être un rapport utilitaire d'instrumentalisation que ce rapport devient humain (nous discutons au passage la caractérisation kantienne du respect). La valeur humaine du rapport social commence là où s'arrête sa simple utilité. De la même façon, l'oeuvre d'art peut avoir une valeur indépendante de toute utilité, dans la mesure même où son seul "effet" est de cultiver en nous les facultés qui font de nous un être humain. Nous illustrons cette affirmation (que nous retrouverons plus tard) avec l'exemple de la lecture. L'utilité de l'oeuvre d'art serait donc, en nous détournant de toute recherche d'utilité, à nous réouvrir les portes de "l'humain" ; en ce sens, l'oeuvre ne "sert" à rien d'autre qu'à nous rendre... plus humains.
Ainsi l'artiste, en produisant des œuvres qui exigent de nous une posture contemplative (puisque nous ne pouvons que les « manquer » en tant qu'oeuvres d'art si nous les envisageons dans une perspective utilitaire (financière, décorative, etc.), nous réintroduit à l'ordre de la contemplation, du regard « désintéressé » : proprement humain.
Nous soulignons pour finir que cette rupture de la perspective utilitaire vaut aussi bien pour le réel extérieur que pour la réalité intérieure. Nous montrons en quoi le contexte socioculturel contemporain tend à produire des "images de soi" qui sont focalisées sur une recherche d'utilité, d'efficacité, de performance (nous prenons appui sur les "récits de soi" dans le CV ou la lettre de motivation, et sur la valeur pragmatique de l'image de soi que l'on cherche à susciter dans le coaching). Là encore, le bris de la perspective utilitaire nous reconduit aux dimensions de notre être dont la valeur est irréductible à toute utilité.
16.01. 4) Choses de la nature... ou nature des choses ?
Nous montrons que la représentation du réel par l'oeuvre peut avoir pour sens, non de nous montrer les "choses de la nature", mais bien la "nature des choses", comme le veut Diderot. L'oeuvre d'art devient alors le moyen de faire apparaître "l'idée" des choses, celle dont les choses sensibles ne sont que des approximations mélangées; de même que le mathématicien fait apparaître l'idée du cercle par ses raisonnements, l'artiste nous donne un accès sensible, sensoriel à la chose restituée sous sa forme pure. Ce que l'artiste doit montrer dans son œuvre, ce n'est ni une « autre » réalité, ni la réalité telle que nous a percevons habituellement, mais le réel tel que nous ne le percevons pas : le réel sous sa forme pure, débarrassée de toute approximation de tout « mélange ».
5) L'art et le réel : le surréalisme
Nous prolongeons notre idée en prenant appui sur le statut de l'inconscient dans le surréalisme. L'oeuvre d'art a pour fonction de laisser s'exprimer ce qui ne peut jamais être saisi dans les rêts de la perception et de la conscience communes. Ce qui ne veut pas dire qu'elle perd sa prétention à la vérité ; dans l'optique du surréalisme, en faisant apparaître ce qui, dans le réel, ne peut pas être capturé par le langage commun, par l'entendement, on en dévoile la véritable substance. Car le réel est infiniment plus riche que ce que peut en saisir le langage ordinaire (qui ne saisit que des abstractions, comme nous l'avons vu précédemment), et la logique rationnelle. Le réel se moque de nos catégories : il est impossible, et c'est précisément en réussissant à le montrer dans cette impossibilité même que l'art le restitue dans sa vérité. En ce sens, le "réalisme" en art ne fait que reproduire nos préjugés sur le réel: seul l'oeuvre sur-réaliste est réellement réaliste.
Nous prolongeons cette analyse à travers l'art religieux, dont le sens est toujours de montrer, de manifester à travers ce qui se perçoit ce qui est le réel par excellence, mais qui ne peut jamais être un objet de perception : c'est-à-dire Dieu lui-même. C'est ce qui explique que la poésie sacrée ait été l'un des premiers epaces d'apparition de formes poétiques qui joueront un rôle fondamental dans la poésie romantique, mais ausi surréaliste : les oxymores.
15.01. Reprise du cours sur l'art. 2) L'oeuvre comme re-production du réel.
En repartant du paradoxe de Pascal, on commence par prendre appui sur les oeuvres dans lesquelles c'est bien une "re-production" de la nature qui nous est proposée (raisons de Zeuxis, hyperréalisme contemporain, etc.) Nous montrons que, même dans ce cas, la duplication du réel n'est pas la fin de l'oeuvre, mais un moyen par lequel autre chose se trouve manifesté.
Ainsi, la reproduction exacte du réel peut manifester la puissance technique de l'artiste (et à travers lui, de l'humain), rendue d'autant plus visible qu'elle est détachée de toute utilité pratique.Ainsi, même dans une "nature morte" (qui exclut l'homme), c'est bien l'homme, l'humain qui se trouve représenté, manifesté, "mis en oeuvre".
3) Représentation et suggestion
Nous poursuivons en montrant que la représentation la plus suggestive n'est pas nécessairement la plus "fidèle" (la plus exacte). Si la description proustienne doit se focaliser sur la "métaphore" (sur l'élément susceptible de nous trans-porter dans la situation ainsi re-vécue), au lieu de de dissoudre dans une foule de détails, le cinéma montre en revanche qu'il est possible d'ajouter des éléments étrangers à la situation représentée pour mieux la mettre en scène : c'est le rôle de la musique.
Nous soulignons que nous retrouvons au sein de l'espace musical (au cinéma) la question de la mimésis : la musique doit-elle "imiter" l'atmosphère d'une séquence ? En prendre le contre-pied ? Nous prenons appui sur trois exemples tirés de l'oeuvre de S. Kubrick (2001, Orange mécanique, Shining) pour explorer les différentes possibilités.
Cette analyse du rôle de la musique au cinéma nous amène à une nouvelle idée : l'oeuvre pourrait rendre sensible ce qui, précisément, échappe aux sens. Nous prenons appui sur le cas du portrait, qui doit faire trans-paraître l'identité, la personnalité (non perceptible par les sens) de celui qui se trouve représenté ; exemple : la statue de Balzac par Rodin. L'art peut-il faire transparaître dans ce qui se perçoit ce qui est par nature imperceptible ?
14.01. Nous terminons la mise en perspective du texte de Nietzsche. Nous posons la question qui semble s’imposer à la lecture du texte : si la mauvaise conscience est une « maladie grave », il faudrait chercher à en guérir. Mais si la cause de cette maladie est le refoulement de nos tendances animales, faut-il alors revenir à une expression-libération de toutes nos instincts animaux, agressifs ou autres ? Cela semble difficile à soutenir… sans mettre sérieusement en cause la possibilité d’une vie sociale, voire la soumission des plus faibles aux plus forts.
Une première voie de résolution nous est donnée par Freud qui, lui aussi, a relié les névroses contemporaines à la répression des pulsions. Mais pour Freud, la guérison n’est pas à rechercher dans un retour à l’animalité, mais bien dans un double processus de prise de conscience des pulsions, et de sublimation. La sublimation consiste en effet à trouver des modes de libération à des pulsions dont la satisfaction immédiate serait incompatible avec les exigences socio-morales, modes de libération qui soient eux-mêmes compatibles avec ces exigences. Nous avons déjà envisagé ce que pouvaient être ces sublimations chez Freud, et en quoi l’art pouvait en faire partie (cf. cours sur l’inconscient). La sublimation serait donc une voie permettant le dépassement du conflit entre nos pulsions (agressives, sexuelles, etc.) et les exigences de la vie en société. Nous soulignons au passage qu’il faut se garder de faire de la sublimation une sorte de solution « magique » ; Freud lui-même souligne que l’homme ne peut pas vivre uniquement de sublimation, et que toute société doit veiller à maintenir des espaces d’expression plus ou moins directe des pulsions ; le danger étant que, dans une société devenue répressive, les névroses s’accroissent… avant de se déchaîner sous la forme la plus brutale lorsque le contexte social s’y prêtera (le phénomène nazi confirmera cette hypothèse).
Nous envisageons ensuite la manière dont Nietzsche lui-même répond à notre objection. Lui non plus n’est pas le partisan d’un retour à une vie animale. Aux yeux de Nietzsche, si l’émergence de la conscience est bel et bien ce qui a donné naissance à l’homme « malade de lui-même »… elle est aussi ce qui a fait de l’homme un animal intéressant. Pour Nietzsche, ce sont avant tout les conflits, les rapports de forces intérieurs à l’homme qui le poussent à se surmonter lui-même. Le problème n’est donc pas le conflit entre exigences morales et pulsions instinctives, ni même entre instincts (puisque la conscience morale est elle-même, nous venons de le voir, l’expression d’instincts).
Le problème, pour Nietzsche, c’est le fait que la conscience morale, au lieu de se mettre au service d’un plein épanouissement de la vie, s’est retournée contre cet épanouissement. En d’autres termes, le problème, pour Nietzsche, est que cette conscience morale a pris la forme d’une conscience morale… chrétienne.
Pour Nietzsche, l’essence du christianisme, c’est la condamnation de la chair ; la chair désigne ici à la fois le corps (et, plus généralement, la « matière », opposée à l’Esprit) et l’attachement au Moi. Nous rappelons au passage que ce terme de « Moi » apparaît pour la première fois, comme substantif, chez Blaise Pascal (grande figure du christianisme), dans une phrase qui affirme que le Moi… est haïssable. L’attachement au Moi, c’est l’attachement à l’individualité, le souci de soi comme développement de la personnalité, le déploiement maximal des forces et des tendances qui sont proprement les nôtres. Bref, l’attachement au Moi, c’est tout ce qui oriente l’homme vers le fait de devenir soi… plutôt que de revenir à Dieu, à ce qui abolit toute distinction entre les hommes en tant que créatures de Dieu. Aux yeux de Nietzsche, le christianisme condamne le corps (qu’il faut châtier, humilier, affaiblir pour le soumettre à l’Esprit), la matière (qui est tout entière entachée par le Péché Originel), le déploiement de la personnalité individuelle : le christianisme s’oppose donc, globalement, à la vie.
Plutôt que de détruire la conscience morale, il s’agit donc de la retourner : au lieu d’en faire une instance qui condamne la vie, il faut en faire une instance qui condamne ce qui s’oppose au plein épanouissement de la vie. Il ne faut pas abolir les valeurs, mais renverser le système de valeurs issu du christianisme.
Et nous pouvons alors aborder la seconde objection que nous avions formulée : cet épanouissement des forces vitales ne risque-t-il pas de privilégier les plus « forts » sur les plus « faibles » ? Nous concluons cette séquence par deux éléments de réponse :
(1) il y a bel et bien, chez Nietzsche, l’idée d’une hiérarchie naturelle des êtres humains : tous n’ont pas les mêmes ressources, les mêmes germes à exploiter, les mêmes dispositions à faire valoir. Il n’y a pas d’égalité des hommes. L’égalité ne peut s’obtenir qu’en nivelant l’humanité par le bas, c’est-à-dire (pour Nietzsche) en faisant en sorte que les forts retournent leurs forces contre eux-mêmes, au grand bénéfice (semble-t-il) des plus faibles. Et Nietzsche s’oppose résolument à ce nivellement.
Mais
(2) pour Nietzsche, il est absurde de corréler le libre épanouissement des plus forts à l’oppression des faibles. Opprimer les plus faibles que soi n’est jamais une expression authentique de la force pour Nietzsche (c’est ce que Gide comprendra très bien dans sa lecture de Nietzsche). Celui qui ne jouit que de l’oppression des plus faibles, c’est précisément le faible, qui compense sa propre soumission à sa hiérarchie (et aux normes sociales) par une domination illusoire sur les plus démunis. Celui qui « se venge » sur les plus faibles que lui, c’est le « petit chef », aigri d’avoir renoncé à sa liberté, à son propre épanouissement, par lâcheté (nous l’avons vu : la lâcheté renvoie ici à la fois à la peur et au conformisme). Pour le dire en termes nietzschéens, celui qui ne trouve d’autre manifestation de sa prétendue « force » que l’oppression des plus faibles, c’est l’homme du « ressentiment ». La force véritable s’exprime beaucoup plus, chez Nietzsche, dans le don de soi, que dans l’oppression des faibles : là encore, la lecture gidienne de Nietzsche est tout à fait correcte.
10.01. Pas de cours, visite au salon de l'étudiant (Lyon)
08.01. Nous consacrons cette séquence à la reprise et à la correction des DM (développement d'explication de texte, portant au choix sur un texte de Bergson ou de Nietzsche, sur la base du corrigé de l'introduction). Nous rappelons les consignes méthodologiques, et les appliquons ensemble à une séquence du texte de Bergson. Comment comprendre l'affirmation de l'auteur selon laquelle la création soit la (seule) cause de la joie pour l'homme ? Nous repartons de la caractérisation de la joie donnée par l'auteur auparavant (la joie est le signe que "la vie a réussi", qu'elle a trouvé son accomplissement, qu'elle a accompli ce qui lui donne sens), pour montrer que la création est bel et bien ce qui caractérise la vie come telle, ce en quoi elle trouve son achèvement. Créer, c'est donner naissance à quelque chose, faire naître quelque chose, générer quelque chose de nouveau : c'est cela qui permet de comprendre en quoi la création est bien l'aboutissement de la vie, en tant que puissance, non pas seulement de "re-production' (biologique ou autre), mais bien de fécondité : génération d'êtres qui n'existaient pas, d'êtres inédits, nouveaux. Créer, c'est faire apparaître dans le monde ce qui ne s'y trouvait pas, et que seul le créateur pouvait y faire naître : c'est en ce sens que la création accomplit "la vie" en nous, et donne un sens à notre vie : notre vie prend sens dans la mesure où nous donnons naissance à qquelque chose que nous seuls pouvions faire naître.
Nous illustrons cette affirmation par deux types d'exemples : l'enfantement biologique (par laquelle l'homme donne naissance à un être qui n'existait pas, et que lui seul pouvait faire naître), la création artistique. En prenant appui sur les idées de Victor Hugo (au programme de littérature), nous montrons que l'artiste doit nécessairement être créateur : faire émerger des formes et des contenus nouveaux, transgresser les vieux codes pour inventer de nouvelles règles, s'affranchir des convetions établies, "mortes", pour produire un art vivant.
Nous rattachons alors cette séquence à la thèse globale du texte.
Nous prenons ensuite appui sur le texte de Nietzsche pour nous entraîner à la "mise en perspecive" conclusive. Après avoir rappelé la thèse et les principales étapes du texte, nous confrontons les idées de Nietzsche et celles de Rousseau en montrant comment elles s'opposent, point part point. Si tous deux s'accordent sur le fait que la conscience morale soit une spécificité humaine, en revanche :
_ alors que la conscience morale est pour Rousseau le fondement de la nature de l'homme, elle est chez Nietzsche une production culturelle, puisqu'elle résulte de la socialisation de l'homme.
_ alors que la conscience morale s'oppose aux instincts agressifs chez Rousseau, elle en est l'expression chez Nietzsche
_ alors que la conscience morale est le fondement de la liberté chez Rousseau, elle est le produit de l'enfermement de l'homme dans la société chez Nietzsche
_ alors que la conscience morale est le fondement d'une humanité saine chez Rouseau, la mauvaise conscience est une maladie pour Nietzsche
Ces différents points d'opposition aboutissent ainsi à un renversement global du sens et de l'origine de la conscience morale : pour Rousseau, c'est parce que nous disposons d'une conscience morale, que nous pouvons être amenés à résister à nos impulsions animales-agressives ; pour Nietzsche, c'est l'inverse : c'est parce que nous réprimons nos instincts animaux agressifs que la (mauvaise) conscience apparaît. Si bien que si, chez Rousseau, c'est parce que l'homme ne réprime pas ses tendances agresives qu'il est amené à avoir mauvaise conscience, au contraire, chez Nietzsche, c'est justement celui qui les réprime et les refoule qui souffrira de culpabilité (puisqu'il libère en lui-meme et contre lui-même les instincts qu'il ne peut plus extérioriser.) Par où Nietzsche rejoint (encore) une idée que l'on retrouvera chez Freud : une société dans laquelle les individus sont de plus en plus inhibés dans l'extériorisation de leurs tendances pulsionnelles ne conduit pas à un affaiblissement de la culpabilité... mais à son renforcement.
07.01. II) L'art et l'oeuvre d'art.
Nous ouvrons à présent notre seconde séquence, consacrée à l'oeuvre d'art. Nous commençons par indiquer que les sujets sur l'art, s'ils semblent souvent les plus intéressants à traiter pour les élèves de TL le jour du bac, ne sont pas toujours les plus faciles. Nous insistons sur l'importance à accorder aux illustrations dans un devoir de type bac (dissertation ou explication), et sur le danger qu'il y aurait à réduire l'art à la peinture. Il faut essayer de mettre en oeuvre les problèmes posés sur des oeuvres diversifiées (envisager le domaine de la musique, de la danse, de l'architecture, du cinéma...) et, si possibles, personnelles (éviter le recours aux oeuvres rebattues comme "la Joconde" ou "Candide-de-Voltaire"...)
A) Définitions
Nous partons de l'analyse de la notion d'art, que l'on ne peut pas réduire d'emblée à celui des oeuvres d'art. En distinguant les domaines de l'artificiel, de l'artisanal et de l'artistique, et en précisant le sens de ces qualificatifs, nous mettons en lumière ce qui conduit de l'oeuvre comme production humaine (non naturelle) à l'oeuvre d'art. Nous soulignons le problème que pose, dès le départ, la définition de l'oeuvre d'art : qu'est-ce qui "fait" l'oeuvre d'art ? Qu'est-ce qui permet de reconnaître une oeuvre d'art, de la différencier de ce qui n'est pas "objet d'art" ? Qu'est-ce qui, fait, par exemple, qu'une peinture monochrome (comme un rectangle uniformément bleu) peut, ou ne peut pas, être considéré comme une "oeuvre d'art" ?
Ceci nous conduit à remarquer que la définition même de l'oeuvre d'art est l'un des problèmes-clé de cette notion ; toute définition de l'oeuvre d'art est déjà une prise de position, qui conduit à admettre une certaine vision de l'art, et à en rejeter d'autres. Pour débuter notre étude, nous serons donc obligés de prendre appui sur une définition qui est déjà une certaine conception de l'art, en caractérisant l'oeuvre d'art comme une oeuvre dont la finalité est (au moins en partie) esthétique, liée à une recherche de la beauté. Beaucoup d'artistes au XX° siècle seraient en désaccord avec cette définition, qui ne s'accorde pas, par exemple, à Fontaine de Marcel Duchamp, et qui contredit frontalement la vision de l'art défendue par Jean Dubuffet, promoteur de "l'art brut". Nous devrons donc remettre en cause cette définition initiale, que nous adoptons néanmoins comme point de départ, dans la mesure où elle est plus ou moins admise par tous les artistes et théoriciens de l'art avant le XX° siècle (et donc par la quasi-totalité des auteurs du programme).
Nous étudierons la notion d'oeuvre d'art en la confrontant à plusieurs concepts qui la problématisent : nous commencerons par la question du rapport entre l'art et la nature, avant de passer aux rapports entre art et technique, puis aux rapports entre art et culture.
B) L'art et la nature : l'art doit-il imiter la nature ?
Cette question (très) classique nous servira de point d'appui pour l'analyse du but de l'oeuvre d'art, dans son rapport à la réalité. L'art doit-il "reproduire" la réalité ? Représenter le réel, est-ce le re-produire ? Quel est le réel que l'art doit rendre visible, perceptible ? Quellle est la partie du réel que seule l'oeuvre permet de montrer, et de quels moyens l'artiste dispise-t-il pour le faire ?
1) Le paradoxe de Pascal
Nous partons du paradoxe énoncé par Blaise Pascal, conntemplant les oeuvres de ce registre crucial de l'art du XVII° siècle que sont les natures mortes (coupes de fruits, etc.) : il semberait que l'artiste s'évertue à nous faire admirer la copie de choses... dont nous n'admirons pas les originaux ! Pourquoi reproduire à l'identique l'écuelle qui se trouve sur ma table, alors même que je ne m'arrête jamais devant cette écuelle pour la contempler avec admiration ? Ceci nous conduit à poser deux questions : le bit de l'artiste est-il de donner une "copie" de la réalité, est si c'est le cas, quel est son but ? Car si la copie exacte d'un événement mémorable (le sacre de Napoléon, etc.) peut éventuellement s'expliquer à des époques où n'existent ni la photographie ni le cinéma, on comprend mal ce que mpeut être l'intention d'un artiste qui cherche à donner une reproduction exacte... d'une chose apparemment sans intérêt. Or, et c'est en quoi le paradoxe de Pascal est éclairant, il semble que bien souvent, quand l'oeuvre d'art cherche à donner une copie exacte de la réalité telle que nous la percevons... elle s'oriente justement vers des objets qui n'ont pas en eux-mêmes une valeur particulière. Des raisins de Zeuxis aux oeuvres de l'hyperréalisme contemporain, les oeuvres dont le but semble bien être de donner une reproduction exacte de la réalité semblent avant tiut s'attacher à des choses anodines, habituelles, ordinaires : rien de particulièrement "fascinant", a priori, dans une grappe de raisin ou l'un des faux touristes affectionnés par le sculpteur hyperréaliste américain contemporain Duane Hanson (cf. ci-dessous : sculpture en résine)...

20.12. Nous terminons ce chapitre en examinant une autre voie possible pour "activer" (dans tous les sens du terme) la prise de décision. Cette voie est celle d'un penseur dont la démarche est opposée, par plusieurs aspects, à celle de Hans Jonas : Ernst BLOCH. Ernst Bloch est un penseur allemand du XX° siècle, dont la trajectoire est à elle seule tout un roman : anti-militariste et anti-nationaliste dans l'Allemagne de la fin du XIX° siècle, pacifiste durant la première guerre mondiale, opposant au nazisme dans les années 20-30 (ce qui le force à émigrer), défense du marxisme dans les Etats-Unis des années 40, critique du stalinisme dans la RDA des années 50...
De façon générale, Bloch est très réservé concernant les vertus éthiques de la peur. Pour Bloch, la peur est davantage un affect qui nous pousse à l'aveuglement volontaire et au repli sur l'intérêt personnel qu'un sentiment qui nous inciterait à l'altruisme... Ce qui, en revanche, nous incite à envisager l'avenir, et à oser ce qui peut sembler impossible pour réaliser l'avenir auquel nous aspirons, c'est l'espérance. Pour Bloch, il ne suffit pas de craindre l'avenir pour se rendre maître de l'histoire : l'homme ne trouvera la force de prendre en main son avenir, il n'accepetera de remettre en cause ses intérêts immédiats que s'il a un rêve à réaliser : c'est ce qui explique le rôle-clé que joue chez lui la notion d'utopie. Il ne suffit pas que l'homme sache ce qu'il voudrait éviter, ce dont il devrait détourner le progrès technique : il faut qu'il ait un projet à réaliser, un idéal de société vers lequel tendre, pour qu'il trouve en lui les ressources et la force lui permettant d'orienter la marche du progrès technique. Il ne suffit pas de voir ce vers quoi le progrès technique ne doit pas aller : il faut encore savoir vers où on veut l'emmener, au service de quel idéal on veut le mettre. L'homme ne détournera la technique de son orientation catastrophique que s'il la met au service d'un nouveau rêve.
Nous illustrons cette position d'Ernst Bloch avec le mouvement dit de la "simplicité volontaire", en partie fondé sur les idées d'André GORZ, philosophe et journaliste français du XX° siècle. Ce qui définit la posture des adeptes de la simplicité volontaire, c'est le fait d'adopter un mode de vie responsable, qui ne remette pas en cause la possibilité pour les générations futures de satisfaire leurs besoins. Ce mode de vie se caractérise par le refus du mode de vie consumériste, coupable selon eux d'une destruction des ressources naturelles, d'une dégradation de l'environnement et d'une exploitation de l'homme par l'homme. Dans cette optique, les individus doivent (ré)apprendre à se satisfaire de ce dont ils ont réellement besoin, ce qui rejoint la posture épicurienne. Mais justement : ce mode de vie d'inspiration épicurienne n'est pas seulement adoptées pour des raisons morales, mais bien en vue du bonheur. Dans la perspective de la simplicité volontaire, l'homme, pour être heureux, doit satisfaire ses besoins fondamentaux ; mais il doit également consacrer son temps et ses ressources aux activités qui lui permettent de développer pleinement son humanité, et vivre en accord avec sa raison et sa conscience. Or ce n'est pas dans et par la consommation que l'homme développe son humanité, mais bien dans les activités spécifiques à l'homme que sont les activités culturelles : l'art, le dialogue, le jeu, la politique, etc.
En refusant le mode de vie consumériste, en réduisant sa consommation à ses véritables besoins, l'homme renoue avec les exigences de sa conscience (qui exige qu'il rejette la destruction de la nature et l'exploitation) et élabore un mode de vie dans lequel le couple travail / consommation est réduit au minimum, permettant à l'homme de se rendre de nouveau disponible pour les activités culturelles en lesquelles il peut se consacrer à son épanouissement humain, spirituel. C'est bien d'un projet de société qu'il s'agit, explicitement "utopique" : non pas au sens où ce mode de vie serait "impossible" à concrétiser, mais bien au sens où il n'est pas encore celui qui fonde la manière de vivre des hommes ; ce qui est "impossible", c'est au contraire le fait de maintenir un mode de vie consumériste qui détruit les ressources et hypothèque la survie et la dignité des générations futures... Et c'est parce que les tenants de la "simplicité volontaire" ont un rêve à réaliser, une aspiration à concrétiser, un idéal de vie à défendre, qu'ils trouvent la force de s'opposer à un modèle que tout un environnement marchand leur dicte comme le seul possible.
Nous terminons cette séquence consacrée à la technique par la projection d'extraits du documentaire d'Al Gore, "Une vérité qui dérange".
19.12. Nous nous penchons à présent sur l’approche kantienne de l’histoire (que nous retrouverons plus tard dans l’année). Nous montrons en quoi cette approche permet de surmonter l’opposition entre une vision « optimiste » de l’homme et une vision « pessimiste » de l’histoire. En prenant appui sur l’analyse kantienne du droit international, nous montrons que, dans l’optique de Kant, l’homme commence par savoir ce qu’il serait rationnel de faire… mais ne le fait pas ; ou plutôt il ne le fait que lorsqu’il s’est confronté pleinement aux conséquences désastreuses qui viennent du fait qu’il ne suit pas les prescriptions de sa raison. Nous insistons sur le caractère réellement visionnaire du propos de Kant qui, à la fois,
a) pose les fondements du « droit international » (donc d’un droit supra-étatique, ce qui est une première innovation radicale)
b) en anticipe les modalités concrètes (sous la forme d’une « Société des Nations », et non d’un Etat mondial)
c) prévoit de façon désespérément exacte la manière dont se constituera ce droit international : une fois que l’homme aura fait l’épreuve douloureuse des catastrophes qui résultent de l’absence de droit international. Nous illustrons ce dernier point avec l’émergence de la SDN et de l’ONU en corrélation avec les deux guerres mondiales.
Nous nous demandons ensuite en quoi cette approche peut éclairer le « supplément d’âme » que nous recherchons pour faire face aux défis du progrès technique. Nous indiquons que, si l’on suit le raisonnement de Kant, on peut supposer que :
a) l’homme posera les normes (juridiques, morales) nécessaires à la régulation de la puissance technique
b) que la raison humaine lui indique dès maintenant ce qu’il devrait faire pour faire face aux menaces émanant du progrès technique
c) que l’homme ne prendra ces résolutions rationnelles que lorsqu’il se sera confronté aux conséquences désastreuses qui résultent du fait de ne pas le faire…
La question est alors de savoir si l'on peut trouver des voies permettant "d'accélérer" la prise de conscience (et de décision), pour éviter de limiter la confrontation effective aux catastrophes résultant de l'inaction. La première poste que nous envisageons est celle de Hans Jonas, dans son (fameux) livre Le principe responsabilié. Pour Jonas, le principal affect susceptible d'articuler le savoir et l'action, la conscience et la décision est la peur. C'est lorsque l'individu prend peur face à l'imminence des conséquences qui résulteraient pour lui du fait de ne pas agir qu'il peut être poussé à l'action. Nous précisons que cette "peur" n'est pas seulement celle que ressent l'individu pour sa propre sécurité, mais bien celle qu'il peut ressentir pour la survie et la dignité des générations qui lui succéderont : l'homme ne doit pas seulement avoir peur de... (la dégradation de son environnement, la préservation des ressources dont il a besoin, etc.) ; il doit également avoir peur pour... les enfants à venir. Il s'agit donc bien d'un sentiment éthique (qui inclut la prise en compte de l'intérêt d'autrui), comme la pitié.
Pour Hans Jonas, c'est donc la peur qui est le véritable aboutissement de la "conscience" : avoir conscience des catastrophes à venir, avoir conscience de notre responsabilité à l'égard des générations futures, avoir conscience de l'urgence dans laquelle nous nous trouvons, c'est "prendre peur" ; et c'est cette peur qui sera motrice, qui nous poissera à mprendre des décisions qui peuvent impliquer une remise en cause de notre intérêt immédiat (de notre confort actuel, y compris psychologique).
18.12. Nous terminons l’analyse du texte de Bergson en interrogeant les « solutions » envisageables. La formule de Bergson reste en effet très allusive. En quoi pourrait consister un « supplément d’âme » permettant de remettre la technique au service de son but naturel ?
Nous commençons par analyser en quoi ne peut pas consister ce « supplément d’âme », en revenant sur l’idéologie du progrès telle qu’on la trouve dans la pensée des Lumières. Nous montrons en quoi le progrès, conçu comme un progrès de l’humanité en tant que progrès de la rationalité de l’homme, implique la solidarité des dimensions « du » progrès : le progrès scientifique, le progrès technique, le progrès social, le progrès technique, le progrès de la liberté et même le progrès de la moralité de l’homme apparaissent tous comme des facettes d’un seul et même progrès : le progrès de la raison dans l’histoire.
Nous montrons en quoi les deux grandes ruptures du XX° siècle viennent briser cette confiance dans l’histoire. Les deux guerres mondiales ont montré, d’une part, que l’histoire pouvait difficilement être conçue comme un progrès irréversible (le dernier siècle en date étant le plus meurtrier de l’histoire), mais surtout que le progrès scientifico-technique pouvait être mis au service de la barbarie morale et politique. En en ce sens, c’est bien la rationalité (technique) d’un dispositif comme la solution finale qui est destructrice pour l’idéologie du progrès, plus encore que l’irrationalité des croyances sur lesquelles repose le nazisme.
F) Technique et Ethique
Nous montrons ensuite, en prenant appui sur les analyses de Hans Jonas, pourquoi le « supplément d’âme » appelé par Bergson ne peut pas prendre appui sur les morales du passé. Même en supposant un sursaut moral face au péril que le progrès technique représente, nous montrons que les morales traditionnelles ne peuvent constituer un socle adéquat. Dans la mesure où les problèmes éthiques posés par les comportements liés à la technique impliquent à la fois leur caractère collectif (mon action n’a pas de conséquences désastreuses si je suis le seul à la commettre : si je suis le seul à prendre l’avion, cela ne porte aucun préjudice à autrui) et leurs conséquences à long terme (le fait que je mange aujourd’hui de la viande à tous les repas ne porte pas directement préjudice à quelqu’un), il faut mettre en œuvre une nouvelle éthique.
Nous montrons ainsi comment l’on doit passer d’une éthique du type « ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’il te fasse » (qui n’interdit à personne de conduire au diesel…) à une éthique fondée sur le commandement : « agis toujours d’une façon telle que, si elle était adoptée par un grand nombre d’individus, elle serait compatible avec la survie et la dignité des générations futures ».
Nous indiquons en quoi le problème posé par la technique remet également en cause le mode de gestion politique des questions d'intérêt général qu'est le mode de gestion démocratique. En effet, si l'on peut s'attendre à ce que l'assemblée des citoyens sache discerner en quoi consiste l'intérêt du peuple (puisque cet intérêt est justement celui... de cette assemblée, qui constitue le peuple), la question est beaucoup plus délicate lorsque les problèmes qu'il s'agit de résoudre engage l'intérêt de citoyens qui ne font pas encore partie du "peuple", qui ne sont pas encore citoyens, puisqu'ils appartiennent aux générations à venir. Comment garantir le fait que les citoyens d'aujourd'hui prendront les décisions qui sont conformes à l'intérêt des hommes de demain ? Dans la mesure où les décisons prises par les citoyens actuels engagent la vie et la dignité des citoyens de demain, on peut (on doit) considérer que "l'intérêt général" qu'il s'agit d'envisager inclut bien l'intérêt de ces générations à venir ; mais ces générations, par définition, ne votent pas. Elles sont étrangères au suffrage universel, elles ne font pas partie du "peuple" qui vote aujourd'hui.
Nous soulignons le fait que la démocratie repose sur le fait que tous les citoyens participent au vote : c'est ustement parce que tous les citoyens concernés participent à a prise de décision que l'on peut conisidérer le vote démocratique comme un bon indicateur de ce en quoi consiste "l'intérêt général". D'un point de vue démocratique, il n'y a pas de traison de considérer qu'un peuple dont seraient exclues les femmes (par exemple), une Cité dans laquelle les femmes seraient exclues du vote, prendrait des décisions respectueuses de l'intérêt des femmes. La participation générale de tous les citoyens au vote est ce qui permet au vote de s'orienter vers l'intérêt général. Mais justement : les générations à venir sont exclues du vote. Alors comment garantir le fait que leur intérêt sera pris en compte par le vote majoritaire ?
13.12. Nous poursuivons l’analyse du texte de Bergson, pour faire apparaître les raisons pour lesquelles la « révolution technologique » conduit à un déséquilibre entre l’âme et le corps (de l’humanité). Le monde technique, dans la mesure où il est un ensemble matériel par lequel l’homme peut interagir avec la matière, peut être conçu comme une extension du corps de l’humanité. Mais ce corps est désormais devenu surpuissant, si bien qu’il échappe au contrôle de l’âme (qui, elle, ne s’est pas trouvée renforcée par le progrès technique).
Nous opérons alors la distinction entre « puissance » (qui implique une force d’action), et « pouvoir » (le pouvoir implique que l’on peut utiliser une puissance pour imposer sa volonté). La technique apparaît donc comme une puissance, mais non comme un pouvoir, puisqu’elle n’est plus soumise à la volonté de l’homme.
Nous analysons en quel sens on peut dire que l’homme a perdu la maîtrise de sa puissance matérielle : il n’en maîtrise plus l’évolution (il n’y a pas de « pilote » du progrès technique, qui s’autogénère constamment), il ne peut plus en prévoir l’impact sur la nature, cet impact est en partie involontaire (et indésirable), et surtout il ne sait pas (ou ne parvient pas) à empêcher ces effets indésirables (nous illustrons ce point avec le cas du réchauffement climatique).
Nous examinons ensuite en quoi ce déséquilibre est la source de « problèmes sociaux, politiques et internationaux ». Le rapport entre progrès technique et inégalités sociales nous sert de point d’appui pour le premier, les problèmes écologiques illustrent le troisième.
12.12. E) Technique, matière et esprit
En prenant appui sur l'analyse (détaillée) d'un texte de Bergson, nous mettons en lumière ce qui constituait le but naturel de la technique : nous montrons que l'homme a besoin d'une technique pour "se soulever au-dessus de la terre", ce qui signifie aussi bien le fait de parvenir à une position dominante, que le fait de se détacher des préoccupations strictement matérielles (survie, etc.) pour se tourner vers un développement spirituel.
Le texte nous sert de point d'appui pour une nouvelle application des consignes méthodologiques de l'explication.
Nous mettons ensuite en lumière en quoi l'on peut dire que la technique s'est détournée de ce but naturel, et pourquoi. Comment comprendre le fait que la technique se soit détournée de la satisfaction des besoins de tous pour se mettre au service de la satisfaction des désirs (superflus) de quelques uns ? Nous envisageons l'enjeu que représente le coût du progrès technique (recherche, développement) pour expliquer en quoi la logique spontanée du progrès technique l'oriente vers les désirs de ceux qui ont les moyens de le financer, et d'en acheter les produits (sans qu'aucune "mauvaise volonté" humaine ne soit impliquée).
Nous montrons en quoi ce "détournement" de la technique est liée à la révolution qui s'est opérée au XIX° siècle, que l'on pose comme révolution "techno-logique", fondée sur l'articulation de la connaissance scientifique de la nature et de l'action technique sur la nature.
11.12. D) L'ambivalence de la technique
Nous rappelons le piège à éviter concernant un sujet sur la technique ou le travail ; il faut impérativement éviter de s'enfermer dans une dualité avantages / inconvénients de la technique. Pour éviter cet écueil, il est préférable d'aborder d'emblée le rapport entre les deux aspects de la technique, ce que nous effectuons sous la forme d'un tableau qui montre qu'à chaque opportunité offerte par la technique, on peut faire correspondre un risque correspondant.
Si la technique permet la survie de l'espèce humaine, elle est ausi ce qui peut la menacer ; si la technique permet des progrès dans le domaine sanitaire, elle est aussi ce qui peut représenter un danger pour la santé des hommes ; si la technique acroît le nombre des désirs que l'homme peut satisfaire (en accroissant la quantité, la qualité et la diversité des biens et des services), elle est aussi ce qui peut mettre en péril la satisfaction des besoins fondamentaux ; si la technique peut servir de support à la liberté (noius envisageons le rôle de l'imprimerie dans la pensée des Lumières), elle peut ausi servir d'instrument pour le contrôle idéologique des populations (censure / propagande) ; si la technique permet une maîtrise accrue de la nature, elle est aussi ce qui peut produire du dérèglement climatique, etc.
La technique apparaît ainsi comme une puissance ambivalente. La question est alors de savoir si l'on peut séparer les opportunités et les risques : peut-on prendre les "avantages" de la technique sans accepter les "inconvénients" ?
10.12. C) Intelligence et technique
1) En prenant appui sur un texte de Bergson, nous montrons que le propre de l'intelligence humaine est d'être une intelligence technique. La technique est à la fois l'élément-clé du rapport entre l'homme et la nature, mais elle est ausi l'élément-clé du rapport de l'homme à l'homme, du rapport social. Nous analysons la formule de Bergson selon laquelle la vie sociale de l'homme gravite autour de la production et de l'utilisation d'objets techniques, en partant des NTIC et en étudiant le rôle de la division sociale du travail dans l'organisation des sociétés humaines. L'homme apparaît donc davantage comme un homo faber que comme un homosapiens.
2) Inversement, le rappel de la conception marxiste du travail nous indique que le propre du travail humain est de faire intervenir l'intelligence : la production présuppose la production du concept de l'objet dans l'esprit (la disparition du travail intellectuel impliquant la déshumanisation du travail).
Il y a donc un rapport réciproque entre technique et intelligence : si l'intelligence humaine est avant tout une intelligence technique, la technique humaine est avant tout une etchnique intelligente.
06.12. Nouveau chapitre : La culture, l'art et la technique.
Restitution des introductions, correction et distribution d'un corrigé. C'est sur la base de ce corrigé que les développements devront être construits.
I) L'homme et la technique
A) Définition. Nous mettons en lumière la caractérisation générale de la technique, comme ensemble des moyens que l'homme met en oeuvre pour transformer la nature. Ces moyens sont à la fois des savoirs, des savoir-faire et des objets (outils, armes, instruments, etc.)
B) L'homme, un animal technicien
1. Le mythe de Prométhée. En prenant appui sur le mythe tel qu'il nous est raconté par Platon (Protagoras), nous mettons en lumière la vulnérabilité de l'homme à l'état naturel, et le renversement que permet la technique.
En poursuivant la lecture du mythe, nous soulignons l'ambivalence de la technique, qui est à la fois ce qu'il y a de divin dans l'homme (et qui l'élève au-desus des animaux), et le produit d'une faute commise envers les dieux. Nous soulignons également le caractère insuffisant de la technique pour la survie et le développement de la vie humaine : il est nécessaire d'adjoindre à la technique le sens politique qui permet aux hommes de vivre dans des Cités. La technique livrée à elle-même conduit à la mort de l'espèce : seule sa soumission au Bien commun permet de la mettre au service du développement de l'humanité.
Nous terminons cette analyse en indiquant l'opposition entre compétence technique et compétence politique dans le discours de Protagoras : alors que la compétence technique est individuellement différenciée (chacun ayant son domaine de compétence spécifique, dans lequel il est "expert"), la compétence politique est également partagée engtre tous les individus, ce qui fonde la légitimité d'une démocratie. Par conséquent, si dans les questions techniques on doit s'en remettre aux experts compétents, en matière de justice c'est l'ensemble des citoyens qui doit être consulté. Ceci conduit à différencier nettement la politique d'une "technique" : penser la politique comme technique (tributaire d'un savoir, d'une compétence, d'une expertise), c'est remettre en cause la possibilité d'une démocratie.
04.12. 2) Un droit à la satisfaction des besoins ?
Nous repartons de la distinction entre désirs et besoins. (Rappel : un besoin est ce qui est nécessaire à une chose pour rester conforme à sa nature, à son essence, à ce qui la définit).
Nous avons déjà montré que le "droit au bonheur" ne pouvait pas renvoyer au droit de satisfaire tous ses désirs. Mais qu'en est-il des besoins ? Il est possible d'envisager un droit pour chaque individu de satisfaire ses besoins fondamentaux ; par exemple, noius trouvons dans la déclaration des droits de l'Homme l'affirmation d'un droit à l'éducation, d'un droit à l'accès à la culture, qui repose bien sur le fait que l'éducation et la culture sont nécessaires à l'homme pour conserver et développer ce qui fait de lui un être humain, son humanité.
En partant de ce constat, nous recerchons d'autres droits qu'il serait possible de relier à des besoins fondamentaux. Ainsi le "droit de ne pas mourir de faim", ou le "droit de ne pas mourir de froid", qui impliquent alors un devoir de l'Etat de subvenir aux besoins primaires de l'individu (en leur garantissant l'accès à une alimentation de base, à la possibilité de se vêtir; de s'abriter;, etc.) Ce droit devient particulièrement important lorsque l'individu ne peut pas (handicap, maladie, etc.) ou ne peut plus (vieillesse, etc.) travailler. Nous pouvons également envisager un droit d'accéder à des services de soins (par exemple : pour pouvoir accoucher à l'hôpital, pour soigner une appendicite, etc.)
Nous voyons apparaître alors une nouvelle catégorie de droits, distincte des droits strictement politiques : des "droits sociaux". Droit à l'éducation, droit à l'alimentation, droit à la santé, etc.
Et c'est alors l'enjeu politique de cette question du "droit au bonheur" qui apparaît. Car pour donner à chacun (même ceux qui ne peuvent pas, ou plus travailler) les moyens de subvenir à leurs besoins alimentaires, vestimentaires, l'Etat doit mettre en oeuvre un système de "prestations sociales" qui doivent être financées par des prélèvements obligatoires, pour financer des "caisses" : caisses d'allocation chômage, caisse de retraite, etc. De même, pour garantir à chacun l'accès à un système de soins, il faut envisager la mise en oeuvre d'une "sécurité sociale". Et pour garantir à chacun le droit à l'éducation, il faut mettre en oeuvre un "service public" d'éducation (éducation nationale).
Retraite, sécurité sociale, services publics... nous voyons apparaître les points éminemment polémiques dans le champ politique ! Et l'on comprend alors l'enjeu fondamental de la question du "droit au bonheur" : si l'on admet que ce droit ne peut viser que la satisfaction des besoins fondamentaux, on aboutit à la nécessité d'envisager un rôle social de l'Etat, articulé à un système de droits sociaux, qui impliquent la mise en oeuvre d'un système d'alloocations sociales et de services publics. La question politique est alors la suivante : doit-on reconnaître à l'Etat un devoir de permettre à chacun de satisfaire ses besoins fondamentaux (ce qui justifierait donc une conception "sociale" de l'Etat) ou doit-on au contraire concentrer le rôle de l'Etat sur la garantie des droits politiques (liberté(s), propriété privée, sûreté, résistance à l'oppression, etc.), ce qui aboutirait à une conception "libérale" de l'Etat ?
Nous insistons sur le fait que la conception libérale n'implique pas de laisser les pauvres mourir de faim ou de froid, sans éducation, etc. ; la question est de savoir si c'est le rôle de l'Etat de veiller à la satisfaction des besoins fondamentaux des individus, ou si c'est à la société civile (associations, fondations, communautés religieuses...) de le faire.
Ce débat, éminemment actuel, a une longue histoire : on le retrouve déjà, par exemple, dans l'opposition entre Danton et Robespierre. C'est un débat proprement politique : en tant que tel, il est impossible pour un enseignant d'entrer plus avant dans l'exposition de ce qui lui semble être la réponse la plus appropriée. Nous l'illustrons néanmoins avec les deux "volets" du combat mené par Martin Luther King aux Etats-Unis. Si le premier (combat pour les droits civiques) est bien connu, le second l'est moins. Car le second combat mené par Martin Luther King ne portait plus sur l'accès aux droits civiques (dont le point d'aboutissement fut la reconnaissance du droit de vote aux populations noires dans le Sud des Etats-Unis), mais bien sur l'accès aux droits sociaux de l'ensemble de la communauté noire. Ce n'est plus la ségrégation juridique qui était en cause, mais la ségrégation sociale impliquée par la pauvreté, l'accès à l'emploi, au logement, à la santé, à la culture, etc. Par où nous rejoignons une idée que nous avions déjà croisée dans le corrigé du devoir sur liberté et travail : de trop grandes inégalités sociales ne peuvent-elles pas remettre en cause l'égalité politique des citoyens, et notamment la sauvegarde de leur liberté ?
03.12. IV) Bonheur et politique
Nous terminons ce chapitre en abordant la (délicate) question du rapport entre le bonheur et l'Etat. Nous envisageons quelques formulations possibles de cet enjeu-clé : le bonheur est-il une affaire privée, le bonheur est-il un droit, etc.
A) Conception paternaliste, conception républicaine de l'Etat
1) La conception paternaliste
Nous commençons par indiquer en quoi consiste une conception paternaliste de l'Etat (que nous illutrons à l'aide lu règne de Louis XIV) en indiquant en quoi elle aboutit à faire du "bien" des sujets une affaire d'Etat : le bien réunit ici aussi bien la survie (le Souverain doit donner du pain à ses sujets) et la sécurité, mais implique aussi une préoccupation d'ordre moral et religieux. Nous montrons en quoi cette dernière préoccupation entre en conflit avec l'impératif de "tolérance" que pouvait exprimer l'Edit de Nantes. Nous indiquons les liens qui peuvent être effectués entre une conception paternaliste de l'Etat et les principes de "monarchie absolue" sous Louis XIV, ainsi que de "monarchie de droit divin".
2) La conception républicaine de l'Etat
Nous montrons que la conception républicaine de l'Etat s'oppose point par point à l'optique paternaliste : en étudiant la transformation de la notion de "sujet" (les individus ne sont plus les "sujets du Souverain", mais des sujets de droit qui peuvent devenir eux-mêmes membres du Souverain dans une démocratie), nous montrons que la raison d'être de l'Etat dans une optique républicaine est de garantir à chaque citoyen la jouissance de ses droits naturels, dont le premier est la liberté. En prenant appui sur l'analyse d'un texte de Kant, nous montrons en quoi l'Etat doit garantir à chacun la possibilité de chercher le bonnheur tel qu'il le conçoit, et selon les moyens de son choix, tant qu'il ne porte pas atteinte à la même possibilité chez autrui. En ce sens, un Etat qui prétendrait "faire le bonheur" des individus ne serait qu'une dictature radicale. Nous soulignons au passage le glissement qui affecte ce terme au XVIII° siècle : la dictature n'apparaît scandaleuse que dans la mesure même où nous faisons de la liberté individuelle la valeur fondamentale, le premier des "droits de l'Homme", que l'Etat doit garantir sans jamais lui porter atteinte.
Ceci nous ramène à notre question initiale : si le but de l'Etat n'est pas de "faire le bonheur" des citoyens, mais de garantir leurs droits fondamentaux, faut-il inclure un "droit au bonheur" dans ces droits fondamentaux ?
B) Peut-on parler d'un "droit au bonheur" ?
1) Un droit impossible ?
Nous partons de l'analyse de la notion de "droit à" dans un contexte républicain. (a) Le premier sens nous reconduit en fait au "droit de" : par exemple, la droit français reconnaît le "droit au travail" des personnes incarcérées. Ici, est un droit ce qui n'est ni interdit, ni obligatoire (travailler n'est ni un crime ni un délit, ne pas travailler non plus.) (b) le second sens est plus contraignant : il implique le fait que l'individu puisse réclamer à l'Etat la jouissance effective d'un droit ; par exemple, le "droit à l'éducation" implique que je peux réclamer à l'Etat la possibilité effective d'inscrire mon enfant à l'école la plus proche. Nous remarquons au passage que le "droit au travail" a eu, brièvement, ce sens durant la Seconde République ;: c'est justement ce droit qui a conduit à l'ouverture des fameux "ateliers nationaux", dont nous avons déjà parlé avec Victor Hugo.
En examinant ces deux sens possibles de la formule "droit au bonheur", nous montrons qu'elle peut difficilement trouver place dans le cadre républicain. Au premier sens, elle est juste mais elle semble n'avoir aucun enjeu véritable (être heureux n'est ni interdit, ni obligatoire... être malheureux non plus.) Au second sens, elle semble soit absurde (comment l'Etat pourrait-il satisfaire tous mes désirs ?), soit dangereuse (elle impliquerait que l'Etat impose une conception du bonheur à tous les individus).
est-il alors impossible de donner un sens véritable à ce "droit au bonheur" dans jun cadre républicain ?
29.11. Nous débutons la séance par une illustration particulière d'articulation, ou plus encore de "conversion" de l'amour sensuel en amour spirituel : celle que nous fournit le recours de certaines grandes figures (féminines) de la tradition chrétienne qui, dans une tradition ouverte par les Béguines, ont mobilisé le vocable de l'amour profane pour exprimer un amour sacré. Le parcours d'un texte de Sainte Thérèse d'Avila nous sert de point d'appui.
Ces considérations sur l'amour nous servent d'introduction pour notre dernière voie de réconciliation entre désir et devoir.
4. L'amour, par-delà désir et devoir
En prenant appui sur les thèses du philosophe danois Sören KIERKEGAARD, nous montrons que l'acte effectué "par amour" brise l'opposition classique entre les actes effectués "par intérêt" et les actes accomplis "par devoir". Un acte effectué par amour ne peut être dissout ni dans l'une, ni dans l'autre catégorie. Nous soulignons au passage que c'est ce qui rend extrêmement difficile de le soumettre à un jugement moral : peut-on condamner moralement un acte accompli "par amour", même losrqu'il vient heurter les conventions morales ? Nous illustrons ce problème en mentionnant deux films : "La prisonnière" de Henri Georges Clouzot, et "Suzanne". Nous nous orientons ainsi vers la thèse (de Nietzsche) selon laquelle tout ce qui se fait par amour s'accomplit "par-delà Bien et Mal"...
Mais si l'amour détruit la dichotomie "par intérêt", "par devoir", et par conséquent la dualité égoïsme / altruisme (en rendant indissociable "mon" bien et le bien "d'autrui", ce qui vaut ausi bien pour le sentiment amoureux que pour l'amour des parents pour leurs enfants, ou l'amour du prochain), l'amour appartient cependant bien à l'un et l'autre espaces : l'amour en tant que tel appartient bien au registre du désir, et nous montrons que, pour Kierkegaard, il constitue par lui-même le seul et unique "devoir" du chrétien. De sorte que l'acte effectué par amour est tout à la fois accompli par désir et par devoir, qu'il n'est accompli ni par désir ni par devoir.
Nous posons pour terminer la question-clé : si la vie fondée sur l'amour court-circuite l'opposition désir / devoir, peut-on dire pour autant qu'il nous donne à la fois la vertu et le bonheur ? Nous montrons que cette optique ne convient pas pour Kierkegaard. La vie dans l'amour n'est plus réellement de l'ordre de la "vertu", mais plus encore elle ne nous épargne ni la frustration, ni l'angoisse (la crainte et le tremblement), ni la culpabilité (tout chrétien se reconnaît pécheur). Ce n'est donc pas "le bonheur" que la vie par amour peut apporter au disciple du Christ pour Kierkegaard, mais quelque chose d'un autre ordre, qu'il appelle : "la Joie".
Nouveau DM : explication de texte. Deux textes possibles (les deux seront corrigés) : texte de Bergson, texte de Nietzsche. Introduction à rendre pour le mardi 03 décembre. Le développement (à rédiger sur la base du corrigé que nous aurons effectué) sera à rendre pour le mardi 17 décembre.
28.11. 3. La sublimation. En prenant appui sur les acquis du cours sur l'inconscient, nous éclairons en quoi la notion de sublimation offre une voie de dépassement pour l'opposition entre ;les exigences du désir et celles du devoir moral (du Surmoi). Nous commençons par préciser l'origine (alchimique) de la notion de sublimation, et sa définition dans la (méta)psycholoigie freudienne.
En prenant ensuite appui sur le passage de l'affrontement "barbare" à la guerre, de la guerre au tournoi, du tournoi à l'affrontement sportif, de l'affrontement sportif au tournoi d'échecs, nous montrons en quoi un même processus permet de "spiritualiser" la violence et l'agressivité pulsionnelle, lui ouvrant ainsi des espaces d'expression et de libération qui, non seulement évitent la condamnation morale, mais peuvent même devenir des sources de reconnaissance sociale.
Nous nous tournons alors vers les pulsions sexuelles, et nous montrons en quoi le domaine de l'érotisme peut être considéré comme un espace de sublimation de pulsions sexuelles dont la libération immédiate serait entrée en conflit avec les exigences socio-morales. Nous illustrons ce point avec le tableau de Klimt qui orne notre mur du fond, ainsi qu'avec le dilemme auquel est confronté le réalisateur de l'adaptation cinématographique du Parfum de Süskind (l'oeuvre ne pouvant mettre en scène ce dont il s'agit vraiment qu'en se détruisant elle-même en tant qu'oeuvre d'art.) Nous montrons alors en quoi l'oeuvre d'art est un espace privilégié de sublimation.
Nous terminons en induqiant en quoi "l'amour" peut être éclairé par la notion de sublimation. Outre que le sentiment amoureux peut lui-même être considéré comme une forme de sublimation de pulsions sexuelles, nous montrons que l'amour sensuel peut lui-même être sublimé par la "conversion" de l'amour charnel en amour spirituel, ce que nous illustrons avec le personnage d'Elvire dans le Don Juan de Molière. L'amour "sublime" d'Elvie pour Don Juan, dans leur dernière entrevue, n'est-il par une forme accomplie de sublimation d'une sexualité désormais d"tachée de "tout le commerce des sens" ?
27.11. C) Par-delà l'opposition entre désir et devoir ?
1) Nous présentons une première forme de dépassement du conflit. En réalité, ce "dépassement" n'en est pas réellement un, dans la mesure où il consiste essentiellement à sacrifier le désir au devoir : c'est la voie stoïcienne (rappels), en posant la vertu comme but du sage, laquelle nous apporte "par surcroît" la sérénité de l'ataraxie. La seconde voie consisterait (rappels) à adopter la posture épicurienne : le retour aux désirs naturels et nécessaires ne donne certes aucune valeur morale à nos actions, mais elle nous empêche d'entrer en conflit avec les exigences de la vertu : c'est cette fois le bonheur qui constitue le but visé, et la vertu qui en est le corrélat.
Nous prenons à nouveau appui sur l'oeuvre au programme de littérature (La princesse de Montpensier) pour montrer l'opposition entre la conduite de la Princesse de Montpensier et cette autre "héroïne" qu'est la Princesse de Clèves. En comparant les dernières lignes de l'un et l'autre roman, nous montrons que si la première s'expose au malheur en n'ayant pas su articuler les exigences du désir et celles du devoir, la seconde en revanche a su trouver la voix du "repos" en écartant les désirs qui viendraient nuire à l'ataraxie. Alors : la Princesse de Clèves : épicurienne ou stoïcienne ? Nous montrons qu'aucune des deux catégories n'est réellement satisfaisante. La Princesse se soucie bien trop de "son repos" pour pouvoir réellement être considérée comme stoïcienne ; mais elle se soucie bien trop de vertu et de piété pour pouviir être considérée comme épicurienne. Ce que nous décelons en vérité à travers ce personnage, c'est une transformation de la sagesse antique par une tradition chrétienne spécifique : le jansénisme.
2) La solution janséniste. Nous soulignons d'abord le point d'accord entre Pascal et Epicure : le bonheur est bien le but fondamental que les hommes poursuivent. Mais cette qiuête échoue pour Pascal parce que les hommes cherchent leur bonheur dans un espace où aucun objet ne peut satisfaire le vide infini qui se trouve dans leur âme : dans le monde. Nous analysons la notion de divertissement, qui nous reconduit à l'idée que Dieu seul peut venir répondre au vide de l'âme, en insistant sur le fait que le fait qu'il le fasse ne saurait dépendre de la seule décision humaine : c'est la grâce qui peut répondre à l'aspiration infinie de l'âme. Nous illustrons cette rencontre de la grâce avec le mémorial de Pascal.
26.11. III) Le bonheur et la morale
A) Définitions. Nous commençons par définir les notions sur lesquelles nous allons prendre appui : outre le bonheur, le désir et la morale, nous analysons les notions de devoir et de vertu.
B) L'opposition du bonheur et de la morale :
1. Le conflit entre désir et devoir.
En prenant appui sur l'une des oeuvres au programme de littérature (Princesse de Montpensier), ainsi que sur les thèses de bataille, nous montrons qu'il y a un conflit naturel entre les exigences du désir et celles du devoir. Le désir tend naturellement à la transgression des normes morales. Nous prenons appui sur les Fleurs du Mal de baudelaire pour illustrer que l'objet désirable peut (paradoxalement) être l'objet qui suscite l'horreur, l'horreur étant provoquée par l'objet lié à la fois à un risque maximal et par une transgression radicale.
2. Le conflit entre vertu et plaisir
Inversement, nous prenons appui sur la distinction kantienne entre action effectuée conformément au devoir, et l'action effectuée par devoir, pour montrer que la valeur morale d'une action est inversement proportionnelle au plaisir qu'on y prend. Ce que je fais "par plaisir", et plus encore "par intérêt" personnel, ne peut évidemment avoir aucun mérite moral. Nous prolongeons ce point en analysant la notion de surérogation, que nous illutrsons avec le personnage de Sygne dans L'Orage de Claudel. L'action supr^émement méritante dans le domaine moral est précisément celle qui exige un sacrifice si radical de notre intérêt qu'elle ne peut pas même être considérée comme un devoir. Le sublime moral est donc à rechercher du côté de ce qui, accompli par devoir, se situe pourtant au-delà de ce que le devoir exige.
Au terme de cette analyse, le conflit entre bonheur et morale semble radical : pouvons-nous néanmoins trouver des voies de (ré)conciliation ?
22.11.F) L'art et l'inconscient. En prenant appui sur un extrait du film de Hitchcock (La maison du Dr Edwardes), nous montrons en quoi l'art peut se nourrir de l'inconscient. Nous présentons d'abord la thèse d'André Breton pour expliquer les rapports entre le surréalisme et la notion d'inconscient. Puis nous approfondissons l'analyse en analysant la formule de Rimbaud selon laquelle "Je est un Autre". Le "Je" qui n'est pas le Moi (conscient, soumis dans son expression aux contraintes de la grammaire, de la syntaxe) est le sujet de la parole poétique ; nous avons donc deux thèses complémentaires : le véritable sujet de la parole poétique n'est pas le Moi conscient, le Sujet qui est cet Autre en moi ne peut s'exprimer qu'à travers la parole poétique.
La question est alors de savoir si l'expression de "l'Autre en moi" reste compatible avec les exigences sociales : si l'expression poétique implique de rompre avec les conventions linguistiques qui régiseent le langage commun, qu'en est-il du respect des conventions morales ? Ceci nous conduit à notre point suivant.
21.11. (suite de la présentation de la doctrine jungienne). b. Présentation de la notion d'inconscient collectif chez Jung, en tant que strate fondamentale du psychisme humain (de l'âme humaine), qui n'a jamais été refoulée, mais qui n'a jamais accédé à la conscience ; les archétypes comme contenus de l'inconscient collectif. Comment s'expriment les archétypes ? Nous montrons que le propre de l'archétype est de ne jamais pouvoir être entièrement exprimé dans le discours de la conscience : il ne peut se manifester que sous des formes comme le mythe, ou le symbole. Nous analysons la notion de symbole pour montre ce que peut être une expression dans le langage de ce qui par nature, échappe à toute définition. Le sens d'un symbole n'est jamais épuisé par une définition, il ne peut que faire l'objet d'une démarche d'interprétation indéfinie, qui en constitue l'appropriation. Nous illustrons ce point avec le mythe de "l'ingestion" du héros par le monstre marin : le monstre marin est un symbole, qui ne peut jamais être épuisé par une représentation matérielle : Moby Dick n'est pas "une baleine", pas plus que Jonas n'est un simple marin avalé (puis recraché) par un cétacé.
Nous examinons alors en quoi consiste le "processus d'individuation" chez Jung : il s'agit de partir à la recherche, et d'exprimer, non plus seulement le sujet de la conscience (le Moi), mais bien le sujet global du psychisme, de l'âme, qui conjoint les espaces de la conscience et de l'inconscient : c'est ce sujet global que Jung désigne par le "Soi". Le but de la vie humaine est alors de "devenir Soi" : de découvrir et de réaliser pleinement dans et par notre notre vie le Soi.
Nous montrons l'intérêt de l'approche de Jung pour l'étude des rapports entre l'inconscient et l'art, la création artistique étant un lieu privilégié de manifestation des contenus de l'inconscient collectif. Ce qui nous conduit à notre point suivant.
20.11. E) Inconscient et société : en quel sens peut-on parler d'un inconscient collectif ?
1. L'approche de Freud. Dans la foule, les individus deviennent "frères" en ce ce qu'ils s'identifient à un même Père, constituant ainsi un Surmoi identique. Il ne s'agit alors que d'un inconscient "collectif" que dans la mesure où les inconscients individuels deviennent analogues.
2. L'approche jungienne. 1) Inconscient personnel, inconscient collectif. a) conscience et société : la notion de persona (analyse d'un texte de Jung). La persona comme rôle social, personnage de l'individu ; sa non-coïncidence avec la totalité de la personnalité. Que deviennent les partries de la personnalité qui sont incompatibles avec la persona ? Pour Jung, elles sont renvoyées vers l'espace privé, elles restent à l'état immature, et s'expriment sous des formes névrotiques (notamment par la projection : chez Jung, tout ce qui est refoulé est projeté). Se forme alors une forme "d'anti-persona", l'anima.
19.11 D) Les critiques de la psychanalyse
1) Les critiques scientifiques.
a. L'inconscient n'est jamais observable (il échappe donc au domaine des phénomènes, de l'expérience, qui constitue en propre le domaine de l'investigation scientifique.)
b. Les hypothèses psychanalytiques ne sont pas falsifiables (présentatrion de l'argument de Popper). On analyse l'enjeu de ces critiques (pour Freud, la psychanalyse DOIT être une science), et les réponses qu'il propose. Dans la mesure où l'hypothèse de l'inconscient permet à la fois de donner une explication rationnelle à des phénomènes qui restaient inexpliqués, et dans la mesure également où elle permet de construire une technique permettant d'agir efficacement sur ces phénomènes (portée thérapeutique), l'hypothèse de l'inconscient est scientifiquement recevable. A l'objection de Popper, nous opposons l'épreuve de réalité que subissent les hypothèses de l'analyste : une interprétation qui n'a aucune efficacité thérapeutique doit être rejetée (ce que nous illustrons dans la pratique de Freud lui-même).
b) Les critiques philosophiques : la remise en cause de la liberté. Sartre, l'inconscient et la "mauvaise foi". Analyse de la double réponse de Freud : après Copernic et Darwin... Freud ! L'hypothèse de l'incobscient n'est pas rejetée pour des raisons scientifiques, mais parce qu'elle blesse le narcissisme humain. Etude de l'ambivalence du rapport de l'inconscient à la liberté : il existe bien un déterminisme psychique, et le Moi "n'est pas maître dans sa propre maison", mais la psychanalyse nous donne également le moyen de réduire ce déterminisme par la prise de conscience des contenus refoulés : ce qui accroît la connaissance de soi, et (donc) la maîtrise de soi (la force d'un contenu inconscient provenant principalement du fait qu'il est inconscient). Dernière objection : la prise de conscience de nos désirs refoulés nous rend-elle plus heureux ? Là encore, double réponse : la prise de conscience du désir est une condition de sa réalisation (et de sa sublimation), mais rien ne garantit qu'il sera considéré comme "réalisable" par le Moi (et la partie consciente du Surmoi) ; mais le but du psychanalyste est celui d'un médecin : il n'est pas de nous "rendre heureux", le psychanalyste n'est pas un maître de sagesse, c'est un médecin : son rôle est de faire disparaître des symptômes en éliminant leur cause. Par ailleurs, la prise de conscience dui désir est la condition préalable de sa maîtrise, qu'il s'agisse de sa libération (si le désir refoulé s'avère compatible avec les valeurs conscientes du Moi), de sa répression, ou de sa "sublimation". Première présentation de cette notion, que nous retrouverons bientôt.
15.11. Retour à l’inconscient : de la première à la seconde topique. Après avoir présenté le schéma de la première topique freudienne, nous explicitons les termes-clé (notamment Ca, Moi et Surmoi) et le dynamisme de la seconde. Ceci nous permet de mettre en lumière les buts de la psychanalyse, ainsi que le statut de l'inconscient dans la psychanalyse freudienne. C'est sur cette présentation que nous prendrons appui pour présenter les critiques auxquelles a été exposée la notion d'inconscient freudien. Nous distinguons deux types de critiques : les critiques scientifiques, portant sur le caractère scientifique de la psychanalyse, et les critiques philosophiques.
14.11. (Suite du corrigé) Avec Tocqueville (étude du texte-support, donné avec le DM), nous montrons que lorsqu’un peuple accepte que l’État porte atteinte aux libertés pour mieux garantir la sécurité et l’ordre public, il est déjà « esclave au fond du coeur »… et le deviendra bientôt dans les faits, en devant esclave du tyran. Notre troisième partie nous conduit à interroger la façon dont nous pouvons concilier la préservation de la liberté avec la limitation des risques : c’est ce que nous permet Rousseau (la loi que le peuple se prescrit à lui-même ne porte pas atteinte à sa liberté), et c’est ce que nous prolongeons avec l’analyse de la notion de sécurité « sociale ». En mobilisant le corrigé du sujet sur liberté et travail, nous montrons que le fait d’être protégé de la misère constitue une garantie pour la liberté elle-même. Distribution d’un corrigé pour la conclusion.
13.11. Restitution et correction du DM. Nous centrons la correction sur la mobilisation des éléments de cours qui pouvaient (ou devaient) être mobilisés dans la dissertation. La première partie met en lumière le caractère « risqué » de la liberté, avec Sartre (nous sommes condamnés à être libres) Durkheim (la répression de toute transgression des normes sociales) et Nietzsche (il faut vivre dangereusement) ; la seconde vise à montrer que le renoncement à la liberté au nom de la sécurité est absurde : avec Kant et Rousseau, nous montrons que ce sacrifice implique celui de notre dignité.
12.11. Nous « profitons » du fait que la moitié des élèves se trouve en séance cinéma (Espagnol) pour illustrer les étapes du cheminement que nous avons parcouru avec le film de John Huston, Freud, Passion Secrète. Nous prenons appui sur l’analyse de 4 extraits commentés : (a) l’hystérie est une peuso-maladie (b) les séances de Charcot à la Salpêtrière (c) Breuer et la « talking cure » (d) Freud et l’interprétation d’un rêve.
08.11. (suite) f. Nous montrons en quoi la solution du problème vient de l’interprétation des rêves. Le rêve : mythe ou science ? Les enjeux d'une interprétation scientifique du rêve. Principes et méthodes de l'analyse freudienne (décomposition, associations). Travail du rêve et interprétation du rêve, contenu manifeste et contenu latent. Mise en lumière des mécanismes du travail du rêve : déplacement, condensation, élaboration secondaire. Ce que révèle l'interprétation des rêves est que le rêve est l'expression déguisée d'un DESIR refoulé. Ce qui permet de rectifier la première hypothèse de Freud concernant l'étiologie des névroses, et fait apparaître la structure oedipienne.
07.11. (suite)
d. La découverte de Breuer : "tout se passe comme si" le symptôme hystérique venait prendre la place d'un souvenir refoulé (la réouverture de l’accès à la conscience permettant en retour la disparition du symptôme).
e. Les avancées de Freud : le remplacement de l'hypnose par les associations libres ; la prise en compte de l'enfance comme lieu d'origine des refoulements ; l'importance de la sexualité. Question : y a-t-il une sexualité infantile ?
Première hypothèse de Freud concernant l'étiologie des névroses : le symptôme serait l'expression déguisée d'un souvenir refoulé, ce souvenir étant lié à un événement à caractère incestueux vécu durant l'enfance.
Mise en lumière du problème : dans certains cas, cet événement... n'a pas pu avoir lieu. Comment la névrose pourrait-elle provenir du refoulement du souvenir d'un événement... qui ne s'est pas produit ???
06.11. B. Freud et l’inconscient
1. La notion d’inconscient
Nous commençons par mettre en lumière l’enjeu philosophique de la notion d’inconscient, en tant qu’adjectif substantivé. Admettre l'existence de "l'inconscient", n'est-ce pas admettre, en-dehors du « Moi » conscient (avec ses idées, ses désirs, ses souvenirs, ses valeurs...), une forme de "Moi inconscient" (avec ses désirs, ses souvenirs, ses valeurs, etc.) ? N'est-ce pas alors remettre en cause l'unité du sujet humain ? Et n'est-ce pas surtout remettre en jeu... la liberté ?
2. La « découverte » freudienne de l’inconscient
a. Corps et esprit dans le paradigme médical du XIX° siècle : toute maladie de l’esprit doit avoir un substrat corporel, organique.
b. Le problème des névroses : maladie sans cause corporelle ou pseudo-maladie ? Le problème des maladies sans substrat corporel identifiable.
c. Charcot et l'hypnose : l'impossibilité d'une cause corporelle des symptômes hystériques : on peut faire apparaître / disparaître des symptômes par suggestion hypnotique.
05.11. Analyse de la dernière séquence : en quoi peut-on dire avec Nietzsche que l'impératif à suivre est : "deviens qui tu es" ? Et quels sont les "maîtres de vie" qui prétendent nous indiquer le pont que l'on doit suivre pour franchir le fleuve de la vie ? Analyse de la formule de Nietzsche. Comparaison avec le "connais-toi toi-même" de l'oracle. Explication de la critique nietzshéenne de la morale chrétienne en tant que morale coercitive du troupeau, qui exige le sacrifice de notre Moi.
Méthodologie de la conclusion : distinction des deux temps : synthèse du texte, mise en perspective. Présentation des trois principales possibilités de mise en perspective.
Application de la conclusion au texte de Nietzsche. 1) Mise en rapport avec la thèse d'Epicure. Points d'accord : (a) l'équivalence de la liberté et du bonheur (b) le bonheur comme retour à ce que nous sommes véritablement Points de divergence : désirs naturels contre identité personnelle. Mais y a-t-il réellement opposition ? L'analyse de la notion de besoin nous permet de penser l'articulation des deux approches. En effet, l'analyse des besoins d'un objet technique (ma voiture a besoin d'essence, une machine à laver a besoin d'eau et d'électricité) ou d'un être vivant conduisent à la définition suivante du besoin : est un besoin pour une chose, ce qui lui est nécessaire pour rester conforme à ce qu'elle est, à son essence, à ce qui la définit. En effet, ce qui définit un objet technique, c'est sa fonction (une machine à laver est une machine qui lave : elle a donc besoin de "ce qui lui est nécessaire pour laver" ; un être vivant est un être qui vit : il a donc besoin de "ce qui lui est nécessaire pour rester en vie", etc.) Dans cette optique, est un besoin pour l'homme ce qui lui est nécessaire pour rester ce qu'il est. Or, qu'est-ce qu'un homme ?
Un homme est un être vivant : il a donc "besoin" de ce qui lui est nécessaire pour rester en vie. mais l'homme est également un être humain : il a donc besoin de ce qui lui permet de conserver (ou de déployer) son humanité ; avec Rousseau, nous pouvons ainsi affirmer que l'homme a besoin de liberté, d'éducation et, plus généralement, de culture. Mais un homme n'est pas seulement un être humain : il est également cet être humain, un individu particulier, unique, singulier, doté d'une identité, d'une personnalité propre. Et, en ce sens, l'homme a bel et bien besoin de donner suite aux désirs constitutifs de son identité, de découvrir et de réalsier les désirs qui sont véritablement les siens. Il y a bien un "retour à notre nature" chez Nietzsche, mais la nature dont il s'agit n'est plus une caractérisation générale du genre humain.
2) La seconde possibilité consiste à remettre en question l'un des aspects du texte. L'optique de Nietzsche semble nous enfermer dans une identité que nous n'avons pas choisie, qui nous est imposée à la naissance et que nous ne pouvons pas modifier. En ce sens, le "deviens qui tu es" semble surtout nous enfermer dans un "destin". Mais justement : cette identité dont il s'agit ne nous est pas "donnée" : nous avons à la découvrir et à la réaliser, si bien que toute notre vie devient une quête perpétuelle, un dévoilement et une réalisation de nous-mêmes, une lutte contre l'aliénation. Mais cela ne remet-il pas alors perpétuellement le bonheur "à plus tard" ? Il s'agit cette fois de l'erreur symétrique : car pour Nietzsche le bonheur ne se trouve pas "à la fin" du processus, il ne caractérise pas l'état dans lequel noius nous trouverons quand nous aurons (enfin !) trouvé qui nous sommes. Conformément à une idée que nous trouvons aussi chez le philosophe chinois Lao-Tseu, le bonheur n'est pas au terme du chemin, il est le chemin (une très belle chanson de Marillion est fondée sur cette idée : "happiness is the road") La vie "heureuse" pour Nietzsche, c'est la vie qui est quête perpétuelle, dévoilement et réalisation de soi. Si bien d'ailleurs que, comme le soulignait Gide (un lecteur de Nietzsche), celui qui prétendrait pouvoir affirmer "je sais qui je suis, je suis comme je suis"... a beaucoup plus de chances d'être mort, au sens métaphysique, que réellement vivant. Enfin, cette quête, loin de nous conduire à une forclusion sur nous-mêmes, nous incite au contraire à une découverte, une exploration, une expérimentation du monde et des autres... qui seules peuvent dévoiler notre identité. Nous retrouvons ici la topique du "voyage", dont le but n'est pas ici de faire du tourisme (et encore moins du tourisme... de masse !), mais de découvrir qui l'on est, au contact de l'Autre.
3) La troisième mise en perspective possible du texte de Nietzsche consiste à en questionner l'actualité. Nous mettons alors en lumière l'actualité paradoxale de l'injonction nietzschéenne : le "deviens qui tu es" se trouve en effet intégré, soit à une valorisation de la "spontanéité" (il faut "être soi-même"...) qui en détruit le dynamisme (devenir qui l'on est, ce n'est précisément pas, comme le souligne le texte, se limiter à ce que l'on est maintenant), soit à une formule managériale de "développement personnel" qui le vide de son sens. Lorsque l''incitation à la vie dangereuse devient une injonction au service de l'insertion professionnelle et de la productivité, lorsqu'il devient une "technique" de gestion de soi assimilable aux préceptes du coaching, il perd ce qui lui donnait sens. Nous demandons pour finir si cette réccupération de "l'individualisme" n'est pas l'une des plus grandes victoires de la société marchande, qui réussit à instrumentaliser l'appel à la différenciation individuelle... pour la mettre au service d'un processus de consommation de masse. En ce sens, elle rejoindrait cette autre victoire, qui consiste à faire du discours contestataire un produit marchand : les T-Shirt Che Guevara se vendent très bien, même quand ils sont produits en Chine...
18.10. Avant de passer à l'application de la méthodologie au texte de Nietzsche, nous mettons en lumière ce qu'il peut y avoir de paradoxal dans la solution épicurrienne. Ce paradoxe est intéressant car il permet de situer le basculement auquel la pensée de Nietzsche participe. La solution épicurienne impose de revenir à nos désirs naturels ; or un désir naturel est, par définition, universel, commun à tous les hommes. La solution épicurienne nous commande donc de ne désirer que des désirs qui sont universellement partagés par tous les autres humains. . Un désir "personnel", individuel, propre à un individu ne peut pas, par définition, être un désir naturel. Mais n'est-il pas étrange de fonder le bonheur sur le sacrifice de tous les désirs qui nous sont propres, qui nous différencient, qui sont liés à notre personnalité individuelle ?
Nous prenons le temps d'indiquer ce basculement qui conduit le la valorisation de l'universel dans l'homme, à la valorisation de l'individuel, du personnel. ce qui fait la valeur d'un être humain, est-ce ce qu'il y a d'universel en lui ? Dans ce cas, le sage doit tâcher de se détacher de son petit "Moi" individuel (lequel, pour Pascal, qui est le premier à utiliser ce terme en tant que substantif, est haïssable...) pour s'élever à l'universalité de la raison (et donc des sciences, des mathématiques... où nos caractéristiques individuelles s'effacent). Mais inversement, si c'est ce qu'il a d'unique, de singulier, d'irremplaçable qui fait la valeur de l'homme... alors c'est justement au développement et à l'épanouissement de son identité, à la culture de son Moi (ce que Barrès appelait : le culte du moi) que l'individu doit se consacrer.
C'est cette optique que nous allons retrouver dans le texte de Nietzsche.
Application de la méthodologie de l'explication au texte de Nietzsche. Parcours préalable du texte. Construction de l'introduction : Auteur-Oeuvre / Thème / Question / Thèse / Etapes du texte.
Analyse de la première séquence. En quoi la paresse conduit-elle les hommes à devenir semblables à des marchandises fabriquées en série, et en quoi cela les rend-il méprisables ? Analyse des termes-clé, recherche de justification, illustration par des exemples, mise en relation avec la thèse.
Analyse de la seconde séquence : en quoi consiste l'appel de la conscience selon Nietzsche ? En quoi est-il nécessaire d'y repondre pour échapper à l'absurdité d'une vie sans espoir ? Analyse des termes-clé, recherche de justification, illustration par des exemples, mise en relation avec la thèse.
Bonnes vacances !
17.10. Nous terminons notre présentation de la doctrine épicurienne en montrant que, si le désir non naturel peut devenir cause de trouble, c'est dans la mesure principalement où l'on a pris l'habitude de le satisfaire. (Le fait de boire un verre de vin n'est véritablement cause de troubles que si nous prenons l'habitude de boire). La sagesse consiste donc essentiellement à ne pas prendre, ou à perdre l'habitude de satisfaire nos désirs non naturels. N'ayant ainsi que des désirs qui peuvent être satisfaits sans troubles du corps, et qui ne causent donc ni angoisse ni frustration (on est sûr de toujours pouvoir les satisfaire, sans mal), nous goûtons à la plénitude et à la sérénité. Et si l'on se demande comment on perd l'habitude de satisfaire un désir non naturel (comme l'alcool), la réponse est simple : il fauit cesser de le satisfaire. C'est par le sevrage qu'un alcoolique cesse de l'être.
La doctrine épicurienne nous conduit donc à l'affirmation selon laquelle nous devons réapprendre à nous satsfaire de ce dont nous avons réellement besoin.
3) Bonheur et identité : la position de Nietzsche
Avant d'exposer la thèse de Nietzsche (dont nous allons utiliser le texte comme support d'application), nous exposons les consignes méthodologiques de l'explication de texte. Nous exposons les consignes méthodologiques de l'introduction, puis celles du développement.
16.10. 2) La maîtrise des désirs : la voie épicurienne
Nous présentons la doctrine épicurienne. Le bonheur est le but fondamental de la vie humaine, et il se définit par un double état d'aponie (absence de troubles du corps) et d'ataraxie (absence de troubles de l'âme). Le but est donc de déterminer :
(a) ce que sont les désirs qu'il est nécessaire de satisfaire
(b) ce que sont les désirs qui sont cause de troubles
Si la nature est sage, les désirs de la catégorie (b) ne doivent pas être inclus dans la catéhorie (a).
La typologie épicurienne des désirs nous conduit à l'affirmation selon laquelle les désirs (a) sont les désirs naturels et nécessaires, tandis que les désirs (b) sont les désirs non naturels. La nature est donc bien faite : les désirs qui sont cause de troubles sont des désirs qu'il est possible de ne pas satisfaire. La recherche du bonheur implique donc de ne désirer que des désirs naturels (et nécessaires). C'est le sens du "retour à la nature" chez Epicure, qui n'est pas du tout (pas plus que ce ne sera le cas chez Rousseau) un retour aux cavernes et aux peaux de bêtes, mais bien un retour à NOTRE nature.
15.10. C) Les voies de résolution
1) Le sacrifice des désirs à la vertu : la voie stoïcienne
Nous exposons notre première solution. Après avoir présenté le courant stoïcien, nous expliquons en quoi la recherche de l'ataraxie par le sage conduit à un état qui, sans être nécessairement équivalent au bonheur (que n'apporterait de toutes façons pas non plus la coirse aux désirs...), peut néanmoins être identifié à un état de sérénité dans lequel la souffrance est minimale. Nous soulignons le fait que le boinheur n'est pas le but du sage stoïcien ; le but su sage stoicien est bien la sagesse, et donc la vertu qu'implique l'oéaissance à la raison. Et c'est justement dans la mesure où le sage vise la sagesse et la vertu qu'il peut obtenur "par surcroît" la sérénité de l'ataraxie.
La posture stoïcienne conduit donc à refuser aux désirs toute force déterminante : ils ne doivent pas être le moteur de nos actions, et comme il n'y a aucune raison de supposer que les désirs s'accordent avec la vertu, le sage doit viser à affaiblir le plus possible ses désirs pour éviter la souffrance (et éviter de ret...mber sous leur domination). A titre d'illustration, nous indiquons la dimension très stoïcienne du Maître Yoda des épisodes 1, 2 et 3 de la Guerre des Etoiles : le Jedi doit s'abstenir de tout sentiment et, a fortiori, de toute passion amoureuse, laquelle ne pourra que perturber son jugement, le faire souffrir s'il lui oppose la raison, ou briser sa vertu si il liui cède. De ce point de vue, la suite de la saga tend à donner raison à Maître Y...
11.10. Séance de présentation des parcours post-bac (intervention de Mme Grozellier).
10.10. Nouveau chapitre : le désir et le bonheur.
I) Pour être heureux, faut-il chercher à satisfaire tous nos désirs ?
A) Définitions
Nous définissons les notions de plaisir, de désir et de bonheur.
B) Un problème sans solution ?
A partir de la définition du bonheur (qui, en tant qu'état de plénitude, exclut toute frustration), nous soulignons le fait que le bonheur est un état incompatible avec l'existence de désirs insatisfaits. D'où, semble-t-il, une réponse positive à la question.
Nous montrons cependant que la recherche d'une satisfaction de tous nos désirs ne peut aboutir au bonheur du fait de l'existence de l'existence :
. de désirs dont la satisfaction est impossible (désir d'immortalité), de désirs dont les satisfactions s'excluent mutuellement. la quête de satisfaction conduit alors à la frustration perpétuelle.
. de désirs dont la satisfaction ne dépend pas de nous (désir amoureux) : vouloir satisfaire ces désirs, c'est donc se rendre dépendant de ce qui ne dépend pas de nous, ce qui génère l'angoisse.
. de désirs dont la satisfaction entre en conflit avec notre conscience (morale), ce qui nous conduit à la culpabilité.
La recherche d'une satisfaction de tous nos désirs nous conduit donc à la frustration, à l'angoisse et la culpabilité... que l'on voulait précisément éviter, puiqu'elles nous rendent malheureux.
La question posée semble donc poser un problème insoluble : comment atteindre un état dans lequel aucun désir ne reste insatisfait, si la satisfaction de tous nos désirs ne peut nous rendre heureux ?
09.10. C) Liberté et morale
1) Liberté et responsabilité
Retour sur les définitions de morale et de devoir. Nous montrons d'abord ce qui, dans le débat théologique, éclaire les rapports entre liberté et morale.
. Si l'homme n'est pas libre, les devoirs n'ont pas de sens*
. Si l'homme n'est pas libre, ni la louange ni le blâme n'ont de sens. (illustration avec le cas de l'ordinateur)
2) La liberté peut-elle s'opposer à la morale ?
a. La position de Kant.
Nous retraçons l'argument de Kant, selon lequel l'obéissance à la raison (et donc la liberté) ne peut jamais être immorale : un être rationnel ne peut obéir qu'à des règles qui peuvent être admises et appliquées par tout être raisonnable (nous prenons l'exemple d'une règle mathématique) ; or une règle universalisable est toujours morale : les conduites immorales ne sont jamais universalisables : ni le viol, ni le vol, ni le mensonge, ni le fait de resquiller ne sont universalisables. Si bien que l'obéissance à la "loi de la raison" est obéissance à la "loi morale" : agis toujours de telle sorte que la maxime de ton action puisse être établie en loi universelle.
Il ne peut donc y avoir de conflit engtre liberté et morale, puisque toutes deux reposent sur l'obéissance à la raison. Un homme qui est toujours libre est toujours raisonnable, et un homme qui est toujours raisonable ne peut jamais être immoral.
b. La position de Rousseau : liberté et conscience.
Le point d'accord entre Kant et Rousseau est le principe fondamental des Lumières : l'homme doit toujours vivre conformément aux facultés qui font de lui un être humain. Mais pour Rousseau, l'obéissance à la raison ne suffit pas. La raison est la faculté qui permet à l'homme de déterminer les moyens les plus efficaces d'atteindre une fin. Mais elle ne peut pas nous dire quelle(s) fin(s) on doit poursuivre. La raison peut très bien nous enseigner comment exterminer un maximum de gens en un minimum de temps : c'est cette dimension horrible de la raison qu'illustrera au XX° siècle la barbarie nazie, qui a pu mettre à son service la "raison" (la science, la technique).
Pour savoir ce que nous devons faire, il faut donc écouter cette autre faculté naturelle de l'homme qu'est la conscience. L'homme moral, ce n'est pas celui qui est seulement "rationnel", c'est celui dont la raison est guidée par la conscience qui, pour Rousseau, est un sentiment.
On voit ainsi que, pour Rousseau également, un être vraiment libre ne peut pas être immoral : parce que ce qu'il fait est conforme à sa volonté, que sa volonté est éclairée par sa raison, et que sa raison est guidée par sa conscience. Pour Rousseau, être libre, c'est d'abord suivre sa conscience : et comme la conscience (nous y reviendrons) est infaiilible selon Rousseau, un être libre ne peut donc jamais être immoral.
08.10. 2) La position de Luther
Nous examinons maintenant les réponses de Luther, telle qu'elle est énoncée dans le traité "Du Serf Arbitre"
. Si l'homme est libre, Dieu ne peut pas être omniscient et omnipotent (l'homme peut faire des choses que Dieu n'avait pas prévues, et il mpeut aller contre la volonté de Dieu)
. Le but des commandements n'est pas de nous permettre d'être bon, mais de prendre conscience du fait que nous sommes pécheurs
. Le fait que Dieu sauve ceux qu'il veut, et damne tous les autres (alors qu'ils ne sont pas libres) est certes incompréhensible aux yeux de la raison. Mais justement, nous n'avons pas à demander de comptes à Dieu. Dieu n'a pas à se soumettre aux exigences de la raison humaine. Là où la raison échoue, c'est le domaine de la foi. Le christianisme est "scandaleux" aux yeux de la raison dans tous ses principes (incarnation, résurrection, etc.) Pourquoi refuser le scandale dans le seul domaine de la "justice" divine ? Nous ne pouvons pas comprendre en quoi Dieu est juste lorsqu'il sauve et damne des êtres non-libres : nous (ne) pouvons / devons (que) le croire.
Pour Luther, nous "verrons" la justice de Dieu lorsque nous lui ferons face, lorsqu'il se révélera pleinement. Alors nous n'aurons plus besoin de la raison, ni même de la foi : nous toucherons la sagesse divine. Pour l'instant nous devons accepter d'humilier notre raison et de croire en sa Justice.
3) Un dieu impuissant ?
Nous mettons en lumière le problème théologique impliqué par le débat Erasme / Luther. Il semble impossible de concilier les attribus divins fondamentaux : Dieu ne peut pas à la fois être tout-puissant, bon, et compréhensible. Le problème du mal nous oblige à admettre que :
. soit Dieu et sa justice nous sont résolument incompréhensibles (ce qui se rapproche de Luther, à la condition toutefois de bien dissocier le fait d'être incompréhensible pour la raison humaine et le fait d'petre absurde : ce que fait Dieu a un sens, que nous comprendrons lors de la Révélation finale, mais ce sens ne nous est pas encore accessible.)
. soit Dieu n'est pas bon (le monde est mauvais parce qu'il s'agit bien de sa volonté)
. soit Dieu n'est pas tout-puissant (le mal advient non pas parce qu'il le décide, le veut, mais parce qu'il ne peut pas lui faire obstacle).
Nous examinons (texte) la position de Hans Jonas, qui tente d'éclairer le message du judaïsme à la lumière de la Shoah. Comment un Dieu tout-puisant et bon a-t-il pu "laisser être" la Shoah ? Pour Jonas, la seule réponse possible, puisque le judaïsme exclut aussi bien la non-Bonté de Dieu, que son incompréhensibilité radicale, il faut renoncer à la toute-puissance. Si Dieu n'est pas intervenu, ce n'est pas parce qu'il ne le voulait pas, mais parce qu'il ne le pouvait pas. Dieu a donné la liberté aux hommes et ne peut la reprendre : il attend la réponse de l'Homme, que l'homme peut lui accorder... ou lui refuser.
4. Un dieu injuste ?
Nous terminons notre parcours des enjeux théologiques de la liberté avec la lecture d'un texte de Dostïevski, tiré des Frères Karamazov (le passage se situe juste avant le fameux "Poème du grand Inquisiteur"). Le plaidoyer d'Ivan est celui d'un croyant qui, confronté au problème de ce mal radical qu'est la souffrance des enfants, admet que la "justice" de Dieu (qui justifie cette souffrance) apparaîtra (comme le veut Luther) au jour du Jugement. mais il se refuse par avance à accepter, à admettre cette "Justice". Un Dieu qui prétend justifier la soufrance des enfants ne peut être qu'un dieu inacceptable, scandaleux. Et Ivan se prépare à dire "non" à Dieu losrqu'il se révélera : il se prépare à "rendre son billet à Dieu".
04.10. III) Liberté et éthique
A) Définitions
Nous commençons par définir les notions de morale et de devoir.
B) Liberté et religion : l'enjeu de la liberté (le débat Erasme / Luther)
1) La position d'Erasme
Présentation d'Erasme, penseur de l'humanisme. Travail sur un recueil de textes issus du "Traité sur le libre arbitre". Nous montrons pourquoi, selon Erasme, il est nécessaire d'admettre l'existence du libre arbitre :
. la Bible dit explicitement que Dieu donne le choix à l'homme
. si l'homme n'est pas libre, les commandements divins n'ont pas de sens
. si l'homme n'est pas libre, ke Jugement dernier est absurde
. si l'homme n'est pas libre, c'est Dieu qui commet le mal
03.10. Nous concluons notre preésentation du rapport matière-esprit chez Marx en soulignant le caractère historique de cette corrélation. Si le monde matériel façonne une conscience qui à son tour le façonne, ce double mouvement n'aboutit pas à un cercle (ce qui serait le cas si la conscience façonnait le monde de manière à le ramener à son état initial), mais bien à un processus cyclique. De nouvelles transformations de la réalité matérielle aboutissent à de nouveaux changements dans la conscience, qui aboutissent à leur tour à de nouvelles transformations de la réalité matérielle... et c'est sur ce cycle que repose l'Histoire pour Marx. L'Histoire, c'est avant tout l'histoire des contradictions naissant au sein de la réalité matérielle, de leur répercussion au sein de la conscience, et des transformations que celle-ci provoque et acompagne dans la réalité matérielle pour les résoudre.
On peut alors se demander : y a-t-il un terme à ce processus ? Y a-t-il une "fin" de l'histoire ? Nous reviendrons dans le cours de l'année sur cette délicate question (cous sur l'Histoire). On peut cependant d'ores et déjà indiquer une réponse : quelles que soient les transformations de la réalité matérielle qui adviendront dans l'avenir, il est impossible de savoir à l'avance à quelles transformations de la conscience ils aboutiront. Comment penseront les hommes dans la (les) société(s) de demain ? Il est impossible de le savoir : car précisément, la conscience est toujours façonnée par le monde matériel, et il est impossible de la dissocier de ce monde. Ce qu'il est possible de connaître, ce sont les contradictions propres au monde d'aujourd'hui, et les transformations que nous sommes appelés à réaliser aujourd'hui. Quant à savoir ce que seront les problèmes et les solutions de la société qui résultera de cette transformation, c'est impossible. Dans les termes de Marx : on ne peut pas "faire bouilir les marmites de l'histoire".
Correction de la troisième partie du sujet sur Travail et liberté : (1) dans la mesure où le travail est apparu comme une condition de la liberté (partie I), et que le droit doit garantir la liberté, il est nécessaire de reconnaître un droit au travail. (2) dans la mesure où le travail peut menacer la liberté (partie II), et que le droit doit garantir la liberté, le droit doit imposer au travail le respect des conditions auxquelles il respecte la liberté de tous : ce qui fonde le droit du travail. Illustrations. Distribution d'un corrigé de la conclusion, rappels méthodologiques.
Travail à rendre pour le mardi 12 novembre : dissertation.
02.10. 6) Matière et esprit : un rapport... dialectique ?
Le lien entre matérialisme et déterminisme social nous conduit à poser une question : cette articulation de l'esprit, de la matière et de la société ne peut-elle pas servir de support à un dépassement de l'opposition entre l'afffirmation "idéaliste" (selon laquelle l'âme est indépendante du corps et le détermine sans être déterminée par lui) et le matérialisme (qui fait de l'esprit un simple "reflet" du corps) ? C'est ce que nous essayons de montrer en analysant la notion de "matérialisme historique", que nous empruntons à la pensée de Marx.
a) La notion de dialectique. Nous commençons par caractériser le concept de dialectique avec deux approches : le mouvement dialectique (T/A/S), et le rapport dialectique en tant que rapport de causalité réciproque. C'est le deuxième qui nous servira de fil conducteur.
b) Contre l'idéalisme
Nous montrons en quoi l'approche de Marx s'oppose à l'idéalisme. L'âme n'est en rien indépendante du corps et du milieu social, qui la façonne de part en part. Ce que pense un individu, la pensée d'un groupe social reflète non seulement les conditions matérielles de l'existence de cet individu et de ce groupe, mais également les rapports de force inscrits dans ces conditions. Il y a donc bien une "pensée bourgeoise" et une "pensée ouvrière" selon Marx, comme il y a aussi une penséen une idéologie dominante (qui est toujours celle qui correspond aux intérêts qui dominent dans la sphère matérielle). L'âme reste donc bien un "reflet" du monde matériel en ce qu'elle s'y enracine et en exprime les caractères principaux.
c) De la matière à la prise de conscience
Mais justement, ce "reflet" est à la fois, chez Marx, expression et dévoilement. Les productions de l'esprit, ce dont l"individu prend conscience au contact de la réalité matérielle dans laquelle il vit, tout ceci éclaire cette réalité. C'est surtout le cas, pour Marx, lorsque ce sont des contradictions qui sont mises en lumière, et que ces contradictions sont directement vécues par celui qui les discerne (il faut se garder de réintroduire par a fenêtre un "idéalisme" selon lequel un individu pourrait se poser des questions et envisager des solutions qui seraent sans rapport avec ses propres conditions matérielles d'existence). Or ceux qui sont exploités sont confrontés à de manifestes paradoxes.
Le premier paradoxe est de nature économique. Comment concilier les faits suivants:
_ c'est le travail humain qui crée de la valeur (par exemple : c'est parce qu'un travail permet de les exploiter, et parce qu'elles sont utilisées comme sources d'énergie dans la production industrielle, que les ressources d'une mine ont une valeur)
_ de façon générale, ce sont ceux qui travaillent le plus (et dans les conditions les plus dures) qui participent le moins à la répartition de la valeur créée par le travail
Ce qui pose deux questions. Par quel mécanisme la valeur échappe-t-elle à ceux qui la produisent ? Et comment se fait-il que ceux qui la produisent acceptent de s'en voir dépouiller ?
La seconde question nous conduit à la contradiction n° 2, emprntée au domaine politique. Comment concilier les faits suivants :
_ dans une république, la politique est l'affaire de tous, et dans une démocratie la souveraineté appartient au peuple, qui élit ses représentants
_ les démocraties ne sont pas représentatives : les membres des instances parlementaires et du gouvernement appartiennent presque toujours, non aux classes majoritaires (ouvriers, employés...) mais à la minorité.
Comment se fait-il que la majorité désigne des représentants... qui ne la représentent pas ?
Nous repartons du premier paradoxe pour montrer en quoi la prise de conscience est féconde chez Marx. Prendre conscience d'une contradiction (contradiction que je vis et dont je souffre matérielement dans ma vie), c'est commencer à en élucider les causes, et c'est donc aussi envisager les possibilités qui s'offrent pour la surmonter...
d) de la conscience à l'engagement
Nous avons déjà étudié (corrigé du DM) ce qui, selon Marx, constituait la clé de la première contradiction : la propriété privée des moyens de production. C'est parce qu'un petit nombre d'individus possède les moyens de production (terres, fabriques, mines...) qu'elle peut imposer ses conditions à la masse de ceux qui ne possèdent que leur "force de travail" pour survivre. C'est ce qui permet à cette minorité de détourner à son profit la valeur produite par le travail, en ne donnant à ceux qui travaillent que ce qui est nécessaire pour survivre et ainsi... renouveler leur force de travail.
La solution de Marx est celle qui a donné son nom au "communisme" : il s'agit de mettre fin à la propriété privée des moyens de production, en faisant de ceux-ci une propriété commune des travailleurs. Si la terre appartient (collectivement) à ceux qui la travaillent (ensemble), comment un petot nombre pourrait-il détourner à son profit la valeur produite par le travail de la terre ? Si une usine appartient à ceux qui y travaillent, c'est bien aux travailleurs que reviendra la valeur produite par l'usine, etc. Nous n'entrons pas ici plus en détail dans la présentation du "communisme" de Marx, qui n'est pas notre sujet : nous insistons en revanche sur le fait que la prise de conscience, émanée des contradictions vécues au sein du monde matériel, débouche à son tour sur des tentatives visant à transformer la réalité matérielle (en transformant les modalités de la production, du travail, de la distribution, etc.)
On a donc bien un double mouvement : le monde social-matériel façonne la conscience, qui le reflète dans ses principes, son mouvement et ses contradictions ; mais la conscience à son tour, en éclairant les contradictions qui traversent ce monde social-matériel, nous indiquent les raisons qui soutiennent ces contradictions, ainsi que les moyens de les résoudre par une transformation du monde matériel, qui se trouve ainsi façonné par la conscience. Le monde matériel façonne la conscience, qui le façonne en retour : c'est un rapport dialectique.
01.10. 5) Critiques du déterminisme corporel
a) Une théorie dangereuse...
En prenant appui sur l'application des théories lombrosiennes dans le domaine de l'anthropologie criminelle, nous mettons en évidence les dangers inhérents à un déterminisme corporel, dangers que le XX° siècle a cruellement manifestés. Du racisme à l'eugénisme (positif ou négatif), en passant par l'euthanasie des populations "dégénérées", le déterminisme corporel a servi de socle théorique aux pratiques les plus opposées au respect de la dignité de l'homme. Nous insistons sur le fait que les atrocités nazies se sont, concernant ces trois thèmes, bien souvent inscrites dans le prolongement d'analyses et de discours qui circulaient au sein du monde intellectuel européen, bien avant l'arrivée de Hitler au pouvoir.
b)...et fausse
En remontant aux racines du déterminisme matérialiste, nous montrons le vice de forme que contient tout déterminisme corporel ; vice que ne comportait pas le "matérialisme" des Lumières, de d'Holbach et Helvétius. Pour d'Holbach et Helvétius, dire que la pensée était entièrement déterminée par les processus ayant leur siège dans le cerveau ne conduisait pas du tout à faire du cerveau, considéré isolément, le seul déterminant de la pensée. Bien au contraire : si le cerveau est le siège de la pensée, c'est en tant que centre nerveux ; or ce centre n'est centre qu'en tant, précisément, qui est le lieu où convergent toutes les sensations que le corps tire de son sens externe (perception du monde extérieur) et interne (intro-perception), et d'où partent en retour toutes les "commandes" que le cerveau envoie au corps. Le cerveau n'est donc le siège de la pensée qu'en tant qu'il est lié à un corps, lui-même inséré dans un environnement matériel avec lequel il est en interaction constante : faire abstraction du milieu est donc absurde. Or ce milieu doit être saisi dans toutes ses dimensions : le milieu "matériel" n'est pas seulement composé des choses, il est constitué de l'ensemble des êtres avec lesquels l'individu est en interaction. Il intègre donc le milieu familial, social, éducatif, etc. Dire que le cerveau est le siège de la pensée n'aboutit donc pas du tout à isoler ce cerveau du milieu social et de ses influences... bien au contraire. Et l'on comprend que, pour Helvétius (autre grand "matérialiste" du 18e siècle), le facteur déterminant de la pensée soit avant tout.. l'éducation. Une pensée saine, c'est le produit d'un milieu sain, qui a permis au corps et au cerveau (et donc à l'esprit) de se développer et de s'épanouir harmonieusement.
La critique du déterminisme corporel (sous ses formes cérébrale et génétique) nous reconduit donc, non pas à la liberté, mais à la première forme de déterminisme que nous avons étudiée : le déterminisme social. La pensée de l'homme est déterminée par l'influence d'un milieu matériel-social qui la façonne. S'il y a donc bien opposition entre déterminisme corporel (cérébral, génétique, etc.) et déterminisme social, il n'y en a pas entre un déterminisme matérialiste (selon lequel la matière détermine l'esprit) et un déterminisme social.
27.09. 4) Le déterminisme cérébral du XIX° et son prolongement génétique)
Nous partons des analyses de d'Holbach pour envisager le déterminisme cérébral tel qu'il se constitue au cours du XIX° siècle. Les théories de Franz Joseph Gall établissent une triple conjonction :
(1) les zones du cerveau sont liées à des capacités mentales déterminées
(2) la taille-masse des zones correspond au degré de développement de la capacité correspondante
(3) la forme du crâne est déterminée par la mrophologie du cerveau
Ces trois principes conduisent à admettre l'existence d'un isomorphisme entre la nature de l'esprit de l'individu, la forme de son cerveau, et la forme de son crâne : ce qui fonde la possibilité d'une "phrénologie", comme étude des propriétés de l'âme par palpation du crâne.
Nous insistons sur le fait que ces théories, que la science d'aujourd'hui considère avec commisération (à l'exception de la première, fortement revue et corrigée)... sont des théories admises comme des vérités scientifiques par l'écrasante majorité des penseurs du XIX° siècle.
Nous voyons que, dans cette optique, la "liberté" devient illusoire, dans la mesure où ce qu'est (pense, fait) un individu est esentiellement déterminé par une donnée qui s'impose à lui et qu'il ne peut modifier : son corps, et notamment son cerveau.
L'un des points d'aboutissement de ce déterminisme cérébral se trouve dans cette nouvelle science qui s'élabore à la fin du XIX° siècle, "l'anthropologie criminelle", sous la houlette notamment du penseur italien Cesare Lombroso. Pour Lombroso, si un individu est criminel, c'est avant tout parce qu'il a un cerveau de criminel, qui se traduit d'ailleurs par un profil physiognomonique particulier ; Lombroso va jusqu'à dresser toute une typologie des faciès en fonction des types de criminalité (de l'incendiaire à l'infanticide, en passant par le violeur ou l'assassin).
Là encore, ces théories peuvent nous faire aujourd'hui sourire, avec condescendance. Il n'en est que plus intéressant de souligner que personne ne paisante avec les théories de Lombroso à la fin du XIX° et au début du XX° siècle. Même ses plus farouches adversaires le prennent au sérieux... et pas seulement dans le domaine de l'anthropologie. Tous les écrivains de l'époque (et de tous les bords politiques, de Barrès à Gide) le mentionnent, et un écrivain aussi intelligent et lucide que Zola écrira même à Lombroso pour s'assurer que son personnage de la "bête humaine" a bien les caractéristiques faciales qu'il devrait avoir selon les théories lombrosiennes !
Par ailleurs, s'il ne viendrait plus aujourd'hui à personne l'idée selon laquelle un criminel est criminel du fait de ces circonvolutions cérébrales.... on étudie encore (au CNRS...) à l'heure actuelle le cerveau d'Einstein pour découvrir à quelles caractéristiques cérébrales on peut faire correspondre le caractère éminemment génial de ce grand esprit (il avait un fort gyrus angulaire, semble-t-il.) Enfin, si l'on remplace "le cerveau" par "les gènes", la théorie nous semble en général nettement moins farfelue : on parle aujourd'hui sans complexes du "gène de l'homosexualité", du "gène de la schyzophrénie" (toujours introuvable d'ailleurs...) ; alors pourquoi pas du gène de l'agressivité ? C'est bien cette piste qui a été (très sérieusement) explorée par une chercheuse américaine dans les années 90, dont l'hypothèse a connu une diffusion phénéoménale : le cariotype XYY serait lié à des comportements agressifs (qui expliqueraient la sur-représentation de ce cariotype dans les prisons, etc.). On rejoint ainsi l'idée selon laquelle, si un individu est criminel, c'est ici en raison d'une donnée corporelle qu'il ne maîtrise pas et qu'il ne peut modifier : son génome. Le déterminisme corporel a changé de visage... mais pas de nature.
26.09. 3) Le déterminisme des Lumières
En prenant appui sur un texte du baron d'Holbach, nous soulignons l'un des paradoxes de la doctrine des Lumières : alors que la pensée des Lumières va, dans le domaine politique, aboutir à une théorie qui sacralise la liberté (premier des droits de l'homme, fondement de sa dignité, bien inaliénable, etc.), elle s'appuie en partie sur des penseurs qui, dans le domaine métaphysique, réduisent la liberté à néant.
C'est le cas du baron d'Holbach. L'analyse suivie du texte nous conduit en effet à détruire l'illusion "dualiste" (avec ses corrélats : immortalité de l'âme, maîtrise du corps par l'âme, etc.), en fondant l'agir humain sur une boucle qui va du monde au corps, du corps au cerveau, puis du cerveau au corps, et du corps au monde. Cette boucle ne laisse aucune place à une quelconque autonomie de l'âme, et encore moins à une action de l'âme sur le corps.
La liberté est donc une ilusion : ce que nous sommes, ce que nous pensons, ce que nous faisons est tout entier déterminé par le jeu de processus matériels-corporels auxquels l'âme est tout à fait étrangère ; si bien que l'on peut dire que l'âme, en tant que substance autonome et motrice, "n'existe pas".
25.09.C) Liberté, matière-esprit : l'esprit est-il déterminé par la matière ?
1) La matière et l'esprit
Nous commençons par définir ce couple de notions (au programme) : la matière (le monde matériel) regroupe l'ensemble des choses que l'on peut saisir par les sens ; l'esprit (le monde spirituel) regroupe l'ensemble des choses que l'on ne peut saisir que par la pensée (la raison, la conscience, l'imagination...). Nous soulignons la nature spécifique du corps et de l'esprit dans cette dualité.
En effet, le corps est à la fois :
_ ce par quoi nous saisissons la matière
_ la partie matérielle de l'homme
Le corps est donc à la fois ce qui fait qu'il y a de la matière pour l'homme, et ce qui fait de l'homme un être matériel.
La même dualité se retrouve dans l'esprit, qui est à la fois :
_ ce par quoi nous saisissons les choses spirituelles
_ la partie spirituelle de l'homme.
L'esprit est donc à la fois ce qui fat qu'il y a du spirituel pour l'homme, et ce qui fait de l'homme un être spirituel.
Ce constat nous conduit à la question-clé : si l'homme est à la fois corps et âme, matière et esprit, comment s'articulent ces deux entités ? L'un des deux détermine-t-il l'autre ? Nous montrons que la liberté exigerait pour sa part que l'esprit, l'âme de l'homme puisse contrôler, diriger le corps, la matière.
2) Le déterminisme corporel
Nous partons de l'analyse de quelques phénomènes contemporains qui nous familiarisent avec l'idée selon laquelle l'âme de l'homme serait déterminée par des processus physico-chimiques ayant lieu dans son corps : analyse psychiatrique (quelle est la cause neuronale d'un dysfonctionnement mental ?), anti-dépresseurs, stupéfia,nts. Nous illustrons le caractère potentiellement "déterminuste" de ces réalités avec le conditionnement corporel (manipulations prénatales, recours au "soma") des habitants du "Meilleur des mondes" de George Orwell.
Nous envisageons alors les fondements théoriques du déterminisme corporel :
(1) la matère est régie par des forces et des processus matériels (que la science doit découvrir) : chocs mécaniques, forces électro-magnétiques, réactions chimiques, etc.
(2) en l'homme, la matière et l'esprit sont solidaires (ce qu'il se passe "dans la tête" (cerveau) est indissociable de ce qu'il se passe "dans la tête" (l'esprit))
(3) le corps de l'homme (et notamment son cerveau) sont matériels
(4) l'esprit ne peut pas agir sur la matière (la seule chose qui peut causer un événement dans la matière, c'est une cause matérielle : force mécanique, réaction chimique, attraction magnétique, etc.)
Si l'on admet ces principes (qui semblent évidents), alors il faut admettre que ce qu'il se passe dans l'esprit n'est que le pur reflet de processus matériels (physico-chimiques) ayant lieu dans le corps (et notamment dans le cerveau), que l'esprit ignore et sur lesquels il n'a aucune influence.
Ce qui revient à dire que l'esprit de l'homme, loin de déterminer ce qu'il fait, est en fait le produit de forces et de mécanismes qui lui échappent et qu'il ne maîtrise pas : ce qui est la définition même du déterminisme. Nous déroulons ce constat paradoxal jusqu'à la fiction du "démon de Laplace".
24.09.
Correction du travail à la maison (liberté et travail) ; remarques méthdologiques, élaboration d'un corrigé.
Travail à rendre pour le mardi 01 octobre : rédiger deux paragraphes argumentatifs visant à résoudre le problème résultant des deux premières parties : comment faire en sorte que le travail ne détruise pas la liberté qu'il rend possible ? Comment faire en sorte qu'il joue son trôle émancipateur, mais qu'il n'aboutisse pas à la domination ? [Il faudra impérativement envisager le rôle que le droit peut jouer.]
c) Liberté ou égalité ?
Nous prenons à présent appui sur une autre remise en cause du "déterminisme" social, que l'on trouve notamment chez Jean-Paul SARTRE. Nous rappelons que, pour Sartre, je suis toujours libre, puisque toute situation me confronte à des choix, et que c'est toujours moi, et moi seul, qui choisis. Nous insistons sur le fait que la thèse de Sartre doit impérativement être acceptée dans sa radicalité si l'on veut en saisir les enjeux. Ainsi selon Sartre :
1. Le soldat auquel on ordonne de monter au front alors même qu'il sait que, s'il reste sur place, il sera exécuté pour trahison, a encore le choix : c'est lui, et lui seul, qii décide de partir à l'assaut, ou de rester sur place.
2. Pour prendre un exemple contemporain, le réfugié Syrien qui est monté avec ses enfants sur une embarcation de fortune en les exposant ainsi à un risque de mort évident, avait le choix : c'est lui, et lui seul, qui a décidé de monter sur l'embarcation avec ses enfants.
Cela veut-il dire que, puisque tout le monde est libre, le soldat et le réfugié n'ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes, et que ce qui leur arrive, c'est leur faute ?
Non. Car ce qui apparaît dès qu'on reconnaît la liberté du réfugié, c'est justement le caractère insoutenable de la situation qui devait être la sienne pour qu'il fasse ce choix Quelle devait être sa situation pour que le fait de quitter son pays, ainsi que tout ce qu'il possédait, pour monter avec ses enfants sur un bateau qui va peut-être couler, et qui doit l'emmener vers un pays dont il sait qu'il y sera en situation irrégulière... lui soit apparu comme "le meilleur choix" ? Tant que l'on considère que ce réfugié est "poussé" par des forces (la guerre, la pauvreté, etc.) qui le déterminent, on peut faire abstraction de l'horreur que révèle le fait qu'il a librement choisi de devenir un "boat people", que cela, dans la situation dans laquelle il se trouvait, a pu lui apparaître (et donc pourrait éventuellement nous apparaître, si nous étions dans la même situation) comme "le meilleur choix".
Et inversemernt : dès que nou reconnaissons sa liberté, nous sommes également contraints de reconnaître.... la nôtre. Nous non plus, nous ne pouvons pas dire : "nous n'avons pas le choix". Nous devons assumer le fait que nous avons à choisir, et que nous devrons assumer notre choix. Lorsqu'un bateau de sauvetage, qui a à son bord des dizaines de réfugiés dont la plupart sont dans un état de santé alarmant, et sur lequel se trouvent des enfants, demande la permission d'accoster, nous avons le choix : soit nous acceptons de les accueillir et de les secourir, soit nous les rejettons. Les deux choix sont possibles. Le seul "choix" que nous n'avons pas, c'est celui de ne pas choisir... ou de dire que "nous n'avons pas le choix" : car cela n'est rien d'autre que ce que Sartre appelle "de la mauvaise foi" : nous nions notre liberté pour ne pas assumer la responsabilité de nos choix.
On voit donc l'autre face de la posture de Sartre : loin de faire basculer toute la responsabilité sur la personne de ce qui agit, elle révèle la situation dans laquelle un choix doit être fait ; si la liberté du soldat et du boat-people nous dévoile l'horreur de la situation dans laquelle ils se trouvent, elle nous rappelle également à notre propre responsabilité à l'égard de cette situation.
Il est possible d'illustrer cette thèse sartrienne avec un auteur qui, pourtant, n'a pas grand chose de réellement "sartrien" : Victor Hugo.
Aux yeux d'un lecteur contemporain, il peut sembler légitime de dire que Jean Valjean, qui a volé un pain pour éviter aux enfants de sa soeur de mourir de faim, n'aurait pas dû être puni : il n'était pas coupable ", il n'avait pas le choix". Mais ce n'est pas ce que dit Victor Hugo (ce n'est pas même ce que dit Jean Valjean). Jean Valjean avait le choix : voler ou ne pas voler, personne n'a pris cette décison à sa place. Il est donc responsable de son choix. Or le vol;est un délit, voire un crime : c'est une atteinte à un droit fondamental, inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme : la propriété privée. Il est donc juste et normal qu'il soit sanctionné.
Il faut remarquer à ce sujet que, si Victor Hugo a été beaucoup de choses (légitimiste, bonapartiste, partisan de Louis-Philippe, soutien de Louis-Napoléon Bonaparte... avant de devenir républicain !), il n'a jamais été ni communiste (ce qui le conduirait à remettre en cause la propriété privée), ni anarchiste (ce qui le conduirait à remettre en cause la répresion de ceux qui désobéissent aux lois). Donc : le cas de Jean Valjean n'est pas du tout un problème de liberté : il était libre, il a choisi, il est responsable, il est jusiticiable.
Le problème que pose Jean Valjean, c'est celui des conditions dans lesquelles il a choisi ; ces conditions sont marquées par deux éléments : la pauvreté, et l'absence d'instruction (Jean Valjean ne sait ni lire, ni écrire : c'est au bagne qu'il apprendra). Pour Victor Hugo, il est évidemment compréhensible qu'un homme sans instruction, que l'on plonge dans une misère noire se mette à voler. Il y a évidemment quelque chose de scandaleux dans le fait d'envoyer au bagne des humains auxquels on a refusé la satisfaction de leurs besoins physiologiques (nourriture, etc.) et spirituels (éducation) fondamentaux.
Mais la solution, ce n'est pas de légaliser le vol ou de cesser de punir ceux qui violent les lois ; la solution, c'est de changer les conditions sociales qui conduisent au crime : lutter contre la pauvreté, lutter contre le manque d'instruction. Le problème n'est donc pas le manque de "liberté" des misérables : ce sont les inégalités qui scindent la société entre une minorité riche et instruite, et une masse de pauvres sans éducation. Lutter pour la justice (ou contre l'injustice), ce n'est donc pas combattre pour la reconnaissance de la liberté des misérables (vc'est justement parce qu'on les reconnaît comme libres qu'on peut, qu'on doit les envoyer au bagne quand ils volent !), mais bien combattre les inégalités. C'est détruire la misère, c'est promouvoir l'éducation. Et c'est précisément parce que Louis-Napoléon Bonaparte semblait vouloir le faire que Hugo lui a d'abord apporté son soutien.
20.09. 4) Les remises en cause du déterminisme social
a) "La" société ?
Nous commençons par remarquer que le fait de parler de "la" société, "du" système relève d'un abus de langage. Dire que je s déterminé par "la" société, c'est oublier que mon appartenance sociale est avant tout appartenance à des groupes sociaux : famille, école, profession, église, parti politique, association sportive, etc. Or si chacun de ces groupes est porteur d'idées, d'habitudes, de valeurs, celles-ci ne sont pas nécessairement en accord. Plutôt, donc, que de dire que l'individu est soulis à "la" force, "au" discours de "la" société, il convient de le considérer comme le point de rencontre d'un jeu de forces, de discours distincts et divergents. Si cela ne réintroduit pas d'emblée la possibilité d'une liberté, au moins cela permet de rendre compte de la grande diversité des comportements individuels, chaque individu occupant une place spécifique du fait du réseau de champs sociaux auxquels il participe.
b) La conscience critique
De plus, dans la mesure où il est ainsi soumis à des influences diverses et contradictoires, l'individu peut être amené à prendre position face aux différents enjeux auxquels il est confronté. Dans la mesure même où il doit choisir, ou hiérarchiser les discours qui se proposent à lui, il est amené à examiner la légitimité des différents choix possibles. Il dispose pour cela de cette capacité de conscience critique, qui permet de remettre en cause, et d'étudier la validité d'une idée ou d'une pratique. En ce sens, le conflit des influences le pousse à produire son propre jugement.
Nous insistons alors sur un point très important. Ces deux premières remises en cause du "déterminisme" social n'impliquent pas du tout que l'individu soit capable de "s'extraire" de la société dans laquelle il vit, qu'il puisse ainsi "s'isoler" mentalement pour examiner en lui-même et par lui-même ce qu'il pense, indépendamment de toute influence. Un individu qui prétendrait penser en dehors de tout contexte social, historique, culturel oublie par exemple qu'il réfléchit au problème qu'il rencontre dans la société dans laquelle il vit, qu'il examine les solutions que la société propose, qu'il réfléchit dans la langue de son pays, etc.
Ce n'est pas en cherchant à "s'abstraire" de la société que l'on peut forger notre propre jugement, mais au contraire en s'inscrivant pleinement dans les rapports de force qui la traversent. Ainsi, c'est en prenant appui sur le discours de l'école que je peux remettre en cause certains préjugés familiaux (homophobes, xénophobes ou autres) ; c'est en faisant jouer le discours juridique contre le discours de la morale dominante que je peux questionner mes propres "évidences" (par exemple, en prenant conscience que je peux fort bien considérer la pratique homosexuelle comme immorale, sans pour autant vouloir l'interdire légalement, puisqu'elle ne porte pas préjudice aux droits d'autrui) ; c'est en confrontant la religiosité environnante avec celle de telle ou telle communauté, qui s'y oppose, que je peux clarifier ma propre position (sur la laïcité, le prosélytisme, etc.).
C'est en me confrontant à la pluralité des discours, en prenant conscience du caractère contradictoire des forces et des discours auxquels je suis exposé, que je peux progresser dans la découverté de ma pensée. Cultiver son individualité, faire preuve de conscience critique, ce n'est pas penser "en-dehors" de la société, mais prendre appui sur les contradictions qui la traversent pour découvrir ce que je pense, ce que je veux.
On voit alors la catastrophe que constitue une société "totalitaire". Une société totalitaire, ce n'est pas une société où il n'y a plus qu'un seul pouvoir, un seul groupe social ("la société"), mais bien une société dans laquelle tous les groupes sociaux.... disent la même chose, exercent la même influence. C'est en ce sens que Goebbels concevait l'hégémonie national-socialiste : le but n'était pas de supprimer les groupes sociaux secondaires (école, église, associations sportives, etc.) mais bien de faire en sorte que tous diffusent le même discours. Dans le cas de l'Eglise, plutôt que d'entrer en lutte contre les autorités chrétiennes, il fallait faire en sorte que ces autorités deviennent elles-mêmes porteuses de l'idéologie nazie : ce que visait le "soutien" accordé par Hitler au mouvement des "chrétiens allemands".
Dans une société totalitaire, il devient impossible de faire jouer un discours contre l'autre, de prendre appui sur la divergence des forces pour construire un positionnement personnel : les fondements d'une pensée "personnelle" sont détruits. Et l'on comprend que les îlots d'opposition au régime nazi se soient essentiellement formés dans des espaces communautaires où la possibilité d'un contre-discours était maintenu : qu'il s'agisse de la communauté juive, du Parti communiste, ou de "l'Eglise confessante" (protestante) réunie autour de pasteurs comme Bonhoeffer. L'individu isolé est nécessairement démuni contre la force d'endoctrinement d'une société totalitaire : c'est encore en tant qu'individu social, socialisé que l'homme peut lutter contre les forces d'endoctrinement qu'une société déchaîne contre lui.
c) Langage et société : la langue nous enferme-t-elle dans notre appartenance sociale ?
Nous examinons d'abord les raisons pour lesquelles la langue semble être un instrument aux mains d'un déterminisme social qui asservirait l'individu à la société à laquelle il appartient. En effet :
_ la langue est toujours une construction sociale: c'est la société qui est "l'auteur' de la langue, sur laquelle les individus n'exercent (presque) aucune influence.
_ la langue est le support de la pensée : penser, c'est "se dire", la langue est le matériau de la pensée ; nous pensons "dans" une langue. C'est donc la société qui forge le matériau avec lequel nous pensons.
_ Or la langue n'est pas idéologiquement neutre. Toute langue porte en elle (dans son vocabulaire sa grammaire, sa syntaxe...) des idées, des valeurs qui sont celles de la société qui en est l'auteur. Ainsi dans la langue française, "le masculin l'emporte", et la plupart des fonctions de direction n'avaient pas (jusqu'à une période récente... encore en cours) de forme féminine (on parlait de Madame "le Proviseur", etc.) De même, la distinction entre "vous" et "tu" (abolie durant la Révolution française) exprime la hiéarchisation sociale des individus : si X tutoie Y et que Y voussoie X, c'est que X est supérieur à Y, etc. On peut donc dire qu'en apprenant une langue, on apprend à penser conformément aux idées, aux valeurs, aux principes dont cette langue est porteuse : la société, en nous imposant une langue, nous impose en fait beaucoup plus : elle nous impose d'admettre les fondements de sa "vision du monde". C'est en ce sens que Roland Barthes pouvait affirmer (dans sa leçon inaugurale au Collège de France) que "la langue est fasciste".
Par ailleurs, nous avons montré que, même au sein d'une langue, coexistaient en fait des langues, propres à des groupes sociaux particuliers. Chaque communauté tend à générer une langue qui lui est propre (avec son vocabulaire, ses tournures, son accent...) qui sont autant de marqueurs sociaux. Parler dans cette langue, c'est manifester mon appartenance à cette communauté. Victor Hugo a développé cette nature "identitaire" de la langue dans Les Misérables : en mobilisant les différentes formes argotiques, Hugo souligne le fait que le recours à tel ou tel argot est un marqueur social, un critère de différenciation qui permet aussi bien aux individus de se reconnaître entre eux, de se comprendre sans être compris du non-initié, et d'être reconnus par le reste du corps social (qui peut d'ailleurs exprimer sa répulsion en stigmatisant comme "vulgaire" le recours à l'argot ; si l'argot est "vulgaire", c'est d'abord parce qu'il est parlé... par "le vulgaire", le vulgus, l'homme du peuple.
Tout ceci concorde avec l'idée selon laquelle la langue nous "enfermerait" dans notre milieu social. Et pourtant la langue est aussi ce qui peut nous permettre de nous en affranchir, de nous émanciper. Car si la langue est porteuse de pré-jugés, elle est aussi ce qui permet de les remettre en cause, de les examiner. Ce n'est que lorsqu'un préjugé se fixe dans une formulation précise que je peux le questionner (en interrogeant le sens des termes, ses justifications, etc.); et c'est par le jeu de la discussion et du dialogue que j'ai des chances d'y parvenir. Comme le remarque Socrate dans l'Apolologie de Socrate (de PLATON), on peut réuter une accusation quand elle est formulée clairement et que l'on peut questionner celui qui la soutient (comme dans un tribunal) ; mais comment réfuter... une rumeur? Telle est celle que Socrate considère comme sa véritable ennemie, et qui le fera condamner à mort : la rumeur, le "on-dit", qui pénètre l'esprit des individus dès leur enfance, qui est trop vague pour qu'on puisse réellement la saisir, et dont le porteur (qui n'est personne) ne peut être interrogé. C'est parce que la rumeur se refuse à la formulation claire et au dialogue, parce qu'elle se tient en retrait du "logos", qu'elle est aussi malfaisante.
19.09. b) Analyse. Pour tenter de comprendre les raisons qui conduisent au maintien de la reproduction sociale, par l'intermédiaire du système scolaire, nous prenons appui sur les analyses du sociologue français Pierre Bourdieu.
Remarque : le but de cette séquence n'est évidemment pas de dresser un panorama complet des interactions (qui sont souvent l'objet de polémiques) entre appartenance sociale et réussite scolaire. Nous essaierons seulement de pointer quelques points d'articulation entre le milieu social et la scolarité d'un élève.
Pour Pierre Bourdieu, un milieu social se caractérise par un triple "capital", c'est-à-dire par trois types de ressources : le capital économique, le capital social et le capital culturel.
Nous étudions d'abord l'impact du capital économique sur la réussite scolaire ; l'un des éléments-clé est le coût des études supérieures (inscription, logement, etc.) qui oriente dès le départ les élèves issus de milieux économiquement défavorisés vers des parcours ne nécessitant pas d'études supérieures (CAP, bac pro, etc.) Les élèves "s'auto-sélectionnent" donc en fonction de leurs ressources économiques, indépendamment de leur mérite.
Nous étudions ensuite l'impact du capital social ; le problème de la "carte scolaire" indique l'impact que peut avoir le milieu social d'origine sur les conditions d'enseignement : ainsi un lycée "de banlieue" rencontre des problématiques qui sont (relativement) épargnées au lycée "de centre-ville". Puisque l'élève de banlieue doit aller dans un lycée de banlieue, il sera lui-même affecté, dans son parcours scolaire, par ces difficultés spécifiques. Cela fait partie des raisons pour lesquelles, dans le "classement" des lycées, les lycées de banlieue figurent, année après année, en queue de peloton.
Nous terminons par l'analyse de l'impact du capital culturel, en prenant appui sur deux éléments : la maîtrise de la langue et la culture générale, notamment artistique. Nous montrons que la langue que maîtrise réellement un élève est celle qu'il parle, et qui est parlée, dans son milieu social ; en interagissant au quotidien avec notre environnement, nous acquérons une maîtrise "intuitive" de la langue, qui nous permet par exemple de solliciter spontanément celle des 40 manières de poser une question qui est la plus appropriée à la situation. Seule la pratique perpétuelle d'une langue nous donne accès à cette maîtrise. Nous tirons de ce constat qu'un élève issu d'un milieu populaire maîtrisera une langue populaire.
Nous soulignons ensuite que la langue "populaire" n'a pas, en elle-même, moins de valeur linguistique (richesse, capacité expressive, plasticité) que la langue savante : nous montrons ainsi que c'est d'abord et avant tout la langue populaire qui est la source du renouvellement de la langue, qui "crée" sans cesse de nouveaux mots, de nouvelles formules, de nouvelles tournures, qui seront ensuite (ou non) intégrées à la langue "officielle". Pier Paolo Pasolini (qui a lui-même écrit un roman qui mobilise largement les ressources de la langue populaire des quartiers de Rome, après avoir été l'un des promoteurs de la poésie populaire) a beaucoup insisté sur cette créativité de la langue populaire. Pourtant la langue populaire n'a pas du tout la même valeur scolaire que la langue "noble" : l'argot, le verlan, les tournures et même l'accent des catégories populaires se trouvent pénalisés dans le cadre scolaire, et ils le sont de plus en plus au fur et à mesure que l'on s'élève dans la hiérarchie des diplômes (on n'imagine pas un candidat au grand oral de l'ENA recourant au verlan...)
Nous effectuons le même constat en ce qui concerne la culture. La culture artistique d'un élève ne lui est pas donnée par l'école, mais par son milieu ; si l'on excepte le domaine littéraire, un enseignant de terminale ne peut pas présupposer qu'un élève de terminale L (filière éminemment culturelle !) a déjà reçu un enseignement quelconque en histoire de la photographie, du cinéma, de la danse, de la musique ou de l'architecture... C'est donc hors de l'école que l'individu tirera l'essentiel de sa culture artistique. Ce qui nous reconduit à l'idée selon laquelle un élève issu de milieu populaire possèdera une culture populaire. Et là encore, nous montrons qu'il est absurde de déconsidérer a priori la culture populaire, qui est la principale source de renouvellement de l'art au XX siècle : dans le domaine musical, la musique électrifiée, la musique électronique, le rap ont été des sources majeures de renouvellement de la composition et de la pratique musicale (même dans la musique "savante"). Il en va de meme dans le domaine des arts graphiques avec le "Street Art", etc. Nier la part de la culture populaire dans "l'art contemporain" au sens vrai du terme serait une aberration. Mais là encore, la culture populaire n'est pas valorisée de la même façon que la culture dite "classique" : un épisode de série (même s'il s'agit de Black Mirror, ou de The Wire) a moins de prestige culturel qu'un film d'Alain Resnais (qui ne passe jamais dans la plupart des cinémas de banlieue), un titre de Public Enemy exige de celui qui le mobilise qu'il justifie sa valeur artistique... travail qui sera épargné à celui qui mobiliserait un opéra de Wagner ou un quatuor de Mozart.
On peut donc dire (1) qu'un enfant de milieu populaire maîtrise principalement la langue et la culture populaire ; (2) que cette langue et cette culture n'ont pas en elles-mêmes moins de valeur que la langue et la culture "noble" (dans laquelle on peut par ailleurs très bien dire des choses qui n'ont aucun intérêt, voire aucun sens, ce qui caractérise la langue de bois) ; (3) que cette langue et cette culture populaires sont dévaluées au sein du système scolaire. Ce qui revient à dire que l'on défavorise un élève selon un critère qui n'a pas de légitimité évidente et qui dépend essentiellement de son milieu social d'origine : ce qui est une forme de discrimination.
Et cette discrimination devient de plus en plus prégnante quand on s'élève dans la hiérarchie scolaire : pour un CAP, la maîtrise de la langue "noble" et de la culture classique n'est pas requise ; pour un bac général, elle l'est beaucoup plus ; et dans les oraux de "culture gé" des ENS ou le grand oral de l'ENA, elle est devenue essentielle.
18.09. 3) Scolarité républicaine et reproduction sociale.
Nous étudions maintenant une illustration sociologique du "déterminisme social" en analysant le cas du système scolaire républicain. Nous montrons d'abord ce qui relie l'école républicaine au déterminisme social. Dans la société d'Ancien Régime, la place de l'individu dans la société est déterminée par une donnée qui s'impose à lui, dont il n'est pas responsable et qu'il ne peut modifier : son origine sociale ; ce système est donc marqué par la "reproduction sociale" : les roturiers produisent des enfants qui deviendront roturiers, les nobles prpduisent des enfants qui deviendront nobles, lesquels produiront des enfants qui... etc. Ce système est inacceptable d'un point de vue républicain, fondé sur la liberté individuelle. Il faut donc faire en sorte que la réussite sociale d'un individu soit déterminée par "quelque chose", ce quelque chose devant être indépendant de son origine sociale. Plus encore, ce "quelque chose" doit être déterminé par ce qui fait de l'individu un être libre : notamment son intelligence (sa raison), et sa volonté. Ce "quelque chose" sera la réussite scolaire.
a) L'école républicaine : quelques constats
Nous insistons sur le fait que le principe originel de l'école républicaine n'est pas un principe "égalitaire", qui viserait à faire en sorte que tout le monde réussisse ; les premiers Républicains ne remettaient pas en cause le fait qu'une société implique une hiérarchie des individus. Ce qui importe, c'est que la réussite sociale d'un individu ne soit déterminée que par son "mérite", c'est-à-dire ses capacités (notamment intellectuelles) et ses efforts (sa volonté). Ainsi, la place de l'individu dans la hiérarchie sociale ne sera plus déterminée par sa naissance, mais par ce qui fait de lui un être libre.
La question est alors de savoir si l'école républicaine atteint son but : parvient-elle à libérer l'individu de l'emprise de son milieu social d'origine ? L'école met-elle fin à la reproduction sociale ?
En prenant appui sur quelques données statistiques (lien entre pauvreté et niveau de diplôme, taux de chômage en fonction du diplôme, espérance de salaire, etc.), nous montrons que le premier volet du projet républicain est réalisé : en France, il existe une corrélation forte entre la réussite scolaire (le niveau de diplôme obtenu) et la réussite sociale. Le faux de chômage des élèves sortis du système scolaire sans diplôme est ainsi de 40 %, alors que celui de ceux qui sont sortis avec un doctorat est de 5 %.
Qu'en est-il maintenant de l'autre volet ? Peut-on dire que la réussite scolaire d'un individu est indépendante de son milieu social d'origine ? Les données statistiques montrent... le contraire. En France à l'heure actuelle, il existe une très forte corrélation entre l'origine sociale et la réussite scolaire. Les élèves issus de milieux sociaux défavorisés réussissent beaucoup moins bien à l'école que ceux des milieux sociaux les plus élevés (le niveau de diplôme obtenu est, statistiquement, beaucoup plus bas).
Nous soulignons le problème que pose ce constat : si la réussite sociale est déterminée par la réussite scolaire, mais que la réussite scolaire reste déterminée par l'origine sociale... alors la reproduction sociale est maintenue ! Elle est seulement voilée derrière un mécanisme de sélection qui, officiellement, ne fait intervenir que le mérite. L'individu reste donc prisonnier de son milieu social d'origine, même dans l'institution qui avait pour but de l'en libérer...
Comment l'expliquer ? La réponse la plus simple serait évidemment de dire que les individus issus de milieus sociaux défavorisés... sont moins méritants que les autres ! Ils sont moins intelligents et plus paresseux... Si nous ne nous satisfaisons pas de cette explication (et il y a évidemment des raisons de ne pas s'en satisfaire !), il faut trouver d'autres explications.
17.09. 2) Individu et société : le paradoxe de la morale contemporaine
Nous terminons notre mise en lumière du "déterminisme social" en envisageant le cas des valeurs. Il semble en effet que les valeurs touchent la part la plus personnelle, la plus privée, la plus intime de notre personnalité ; ce que je pense "bien" ou "mal", "juste" ou "injuste" constitue une part essentielle de mon identité. Mais les valeurs qui sont les miennes sont-elles réellement mes valeurs ?
Nous prenons appui sur l'analyse d'un texte de Durkheim pour montrer que les valeurs morales d'un individu dont avant tout celles de la morale de la société dans laquelle il vit. "La" morale est un système de valeurs que la société diffuse et impose aux individus qui la composent, et sur laquelle les individus pris isolément n'exercent aucune influence véritable. Chaque individu construit sa propore conscience morale en intériorisant les normes de la société dans laquelle il vit (en s'identifiant aux modèles qu'elle lui propose, en intégrant les discours qui lui sont tenus dans sa famille, à l'école, dans les médias, etc.) et là encore, s'il tente de s'opposer aux valeurs de la morale collective, il se heurte à un ensemble de processus de répression (s'écarter des valeurs communément admises, c'est commettre des actes que la société considère comme "mauvais", ou refuser de faire ce que la société considère comme "bon" : c'est donc encourir le blâme social.) "La morale" est donc une construction sociale : chaque société construit une morale qu'elle impose ensuite aux individus.
Ceci conduit Durkheim à mettre en lumière la contradiction interne à la morale occidentale contemporaine. En tant que morale, celle-ci est, comme toutes les autres, une construction sociale que la société impose aux individus. Mais le paradoxe est que le principe fondamental de cette morale est le respect absolu de l'individu, de sa liberté et de ses droits. Nous illustrons ce point dans le domaine du droit : le droit occidental moderne repose sur la proclamation du caractère sacré (inviolable) des "droits de l'homme", qui sont tous des droits de l'individu. Liberté individuelle, propriété individuelle, sûreté individuelle, etc. Dans cette optique, il est absolument interdit de violer la liberté individuelle en portant atteinte, par exemple, à la "liberté de pensée" (en lui imposant des idées ou des valeurs), à la "liberté de conscience" (en lui imposant une religion, etc.) Le propre de la morale de notre temps est donc d'affirmer qu'il est absolument immoral d'imposer une morale aux individus.
D'où la contradiction : la société actuelle nous impose une morale... selon laquelle la société ne doit pas nous imposer de morale ! Nous illustrons ce paradoxe en confrontant la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (qui doit être affichée dans tous les établissements scolaires) et la "charte de la laïcité" ou l'enseignement de l'EMC. D'après la première, les libertés de pensée et de conscience sont sacrées : chacun a le droit le plus absolu d'avoir les idées, les valeurs et les croyances qu'il veut. Mais d'après les deux autres, tout individu doit admettre que l'intolérance est immorale, que la laicité est bonne, etc. Et comment justifier l'idée selon laquelle l'école doit enseigner une morale... si elle doit respecter la liberté de chacun de croire dans les valeurs qu'il veut (et donc, par exemple, de refuser la tolérance ou la laïcité ?)
Ce paradoxe souligne la contradiction entre le message actuel de la morale et ce qu'est la morale : non pas une donnée propre aux individus, mais une construction sociale que la société impose aux individus. C'est le sens de la formule de Durkheim : alors même que nous croyons être libre en agissant conformément à notre conscience, nous ne faisons qu'obéir à une morale qui nous est dictée par notre société. "Nous sommes agis plus que nous n'agissons."
13.09. Nous entrons maintenant à l'intérieur de l'individu (ce que nous avons déjà commencé à faire en partant de ses vêtements, qui nous ont conduit à ses goûts et à l'image de lui-même). En quel sens peut-on dire que les désirs de l'individu sont façonnés par des normes sociales ? Là encore, le désir semble appartenir à la sphère strictement privée, personnelle, voire intime de l'individu. Le désir est l'une des dimensions de notre âme, de notre personnalité, et l'on ne voit pas en quoi ildevrait être régi par des normes sociales.
Nous analysons le renversement qui s'est opéré au XX° siècle dans le processus économique : alors que le schéma économique traditionnel tend à faire correspondre une offre à la demande (le système oroductif doit produire ce dont les individus ont besoin, il doit satisfaire els désirs des individus), le propre de l'économie marchande contemporaine est de devouir produire la demande qui correspond à l'offre. Comment faire en sorte que les individus désirent ce que l'on veut leur vendre ? Le mécanisme-clé du dispositif est la publicité, qui doit générer le désir répondant à l'offre. Comment pousser l'individu à acheter un nouveau smartphone, alors que l'on sait très bien que ce nouvel engin ne lui apportera aucune fonctionnalité dont il éprouve le besoin, et que l'ancien fonctionne encore parfaitement ? C'est le défi de la publicité, qui va réussir à génerer le manque, le désir et l'achat de ce qu'il fallait lui vendre, et qu'il ne désirait pas. Nous insistons sur le fait que le propre de la publicité est moins de générer "du désir", que de capter une aspiration préexistante et de la réorienter vers l'objet de consommation ; ainsi on captera le désir de l'adolescent (qui aspire à une intégration au sein d'un groupe, à une reconnaissance par ses pairs) pour l'orienter vers l'achat de produits de marque ou de la téléphonie mobile (qui seront effectivement des supports d'intégration sociale).
Nous généralisons cette analyse en montrant en quoi les désirs individuels sont perpétuellement façonnés par le corps social, qui produit tout autant la demande que l'offre. Et là encore, l'individu qui tente de s'affranchir de désirs régulés s'expose à des formes de sanctions sociales (du fait d'une sexualité "déviante", ou d'une marginalisation forcée, etc.)
Nous envisageons ensuite le domaine des idées et des représentations. Nous montrons que notre vision du monde, notre conception de l'univers et des hommes repose sur un petit nombre de principes fondamentaux. Ainsi, nous montrons qu'un individu occidental contemporain "normal" considère que l'Univers est régi par des lois naturelles, que la science (astronomie, physique, chimie, biologie...) peut découvrir ; et que ce qui est scientifiquement établi ne peut être contesté (qui peut dire : c'est scientifiquement prouvé, mais je ne suis pas d'accord ?) Nous montrons ensuite qu'un européen du 14e siècle aurait, lui, consisdéré comme évident que l'Univers était avant tout régi par la Volonté divine, et que l'autorité suprême en matière de vérité n'était pas la communauté scientifique, mais bien l'Eglise. Nous montrons que, même pour des penseurs comme Galilée, il était impossible de dire, mais plus encore de penser que la Bible pouvait être fausse ; si la Bible nous semble dire des choses fausses, ce n'est pas parce que Dieu se trompe ou nous a trompés, mais bien parce que nous la lisons mal !
D'où vient la foi de l'Européen actuel dans la science ? D'où venait la foi de son ancêtre dans l'Ecriture ? Le facteur-clé est évidemment l'environnement social. C'est la société qui, par l'éducation notamment, nous fournit-impose comme des évidences les principes fondamentaux sur lesquels nous construisons notre représentation du monde. Comment un adolescent occidental, auquel on a toujours (notamment dans le système scolaire) imposé le discours scientifique comme le dicours vrai, et qui ne voit reconnaître comme savoir authentique que ce qui peut être rangé dans la catégorie "science" (sciences dures, scuiences appliquées, sciences exprimentales, sciences économiques, sciences sociales, sciences et techniques du sport, sciences humaines, sciences de l'éducation...) pourrait-il douter de l'autorité de la science ?
12.09. Nous débutons le cours proprement dit sur le chapitre de la liberté. La liberté nous servira de thème pour aborder plusieurs notions du programme (que nous pourrons recroiser ailleurs) : le couple esprit / matière, le rapport individu et société, etc.
I) La nature de la liberté. Nous commençons par quelques rappels issus du corrigé : la définition de la liberté (comme obéissance aux facultés qui font de nous un être humain : la raison et la conscience, par l'intermédiaire de la volonté), nous renvoyons au rapport entre liberté et travail (ce point est développé dans le sujet d'application, traité parallèlement). Nous développons ensuite le rapport entre liberté et responsabilité, en partant de deux paradoxes énoncés par Jean-Paul Sartre. (1) en quel sens peut-on dire avec Sartre que "nous n'avons jamais été aussi libres que sous l'Occupation" ? Nous montrons que si la liberté repose sur le fait de choisir, la liberté est d'autant plus intense que le choix est radical, décisif. Or sous l'Occupation les citoyens devaient choisir entre deux membres d'une alternative, sans réelle possibilité d'emprunter une "troisième voie" : choisir de collaborer (avec le régime de Vichy), choisir de résister. Chacun de ces choix portait à des conséquences fortes : que choisir ? Voici une situation d'intense liberté (beaucoup plus intense en tout cas que losrque j'ai à choisir entre 12 paquets de lessive dans un hypermarché : ce n'est pas le nombvre de possibilités qui importe, mais l'enjeu du choix, l'engagement qu'il implique de ma part).
En quel sens peut-on dire alors (toujours avec Sartre) que (2) "nous sommes condamnés à être libres ?" Il semble au départ que la liberté soit une chance, et que ce soit davantage la privation de liberté qui soit une condamnation. Mais nous montrons, à partir de notre exemple précédent, qu'être libre, c'est aussi être responsable de notre choix. Que je choisisse de collaborer ou de résister, j'aurai choisi, et je dois en assumer les conséquences. Si je décide de collaborer, alors que je dois assumer le fait que je participe à l'injustice ; si je décide de résister, je dois assumer les conséquences qui en découleront pour mes proches, ma famille, etc. D'où la tentation de la "mauvaise foi" selon Sartre, qui consiste à nier ma liberté pour ne pas avoir à assumer mon choix, grâce à la formule magique : "je n'avais pas le choix"... Or nous avons TOUJOURS le choix : c'est moi, et moi seul, qui ai choisi de résister ou de collaborer ; je pouvais faire l'un ou l'autre, et j'ai choisi : je suis donc responsable de ce choix. La seule chose que je ne peux pas faire, c'est ne pas choisir : je suis condamné à choisir, et à assumer les conséquences de mon choix : je suis condamné... à être libre.
II) Sommes-nous maîtres de nous-mêmes ? Nous envisageons à présent les arguments que l'on peut opposer à la liberté, en étudiant le débat entre liberté et déterminisme.
A) La notion de déterminisme. Si la liberté consiste à agir conformément à ce que l'on pense, c'est-à-dire conformément à ce que notre raison et notre conscience nous indiquent être le meilleur choix, une posture "déterministe" sera une posture qui nie ou remet en cause la liberté de l'homme en affirmant que ce qu'est un individu (ce qu'il pense, ce qu'il fait) est déterminé par des forces et mécanismes qui échappent à son contrôle. D'après la définition de la liberté, il y aura donc deux formes principales de déterminisme :
(a) sera déterministe une posture qui affirme que les actes de l'homme ne sont pas dictés par sa raison et sa conscience, mais par des forces qui échappent à sa raison et sa conscience et qu'il ne maîtrise pas. Nous rencontrerons cette forme de déterminisme lorsque nous traiterons de la notion "d'inconscient" telle que la développe Freud (l'idée-clé étant que le comportement de l'homme est avant tout dicté par des processus inconscients).
(b) sera déterministe une posture qui affirme que les actes de l'homme sont bien dirigés par ce qu'il pense... mais que ce qu'il pense (ses idées, ses valeurs, ou même ses désirs) est déterminé par des forces et des mécanismes qui lui échappent et qu'il ne peut contrôler.
Nous allons d'abord envisager des postures déterministes de ce type.
B) L'individu et la société : le déterminisme social
Le déterminisme social est la posture qui consiste à affirmer que ce qu'un individu pense et fait est avant tout déterminé par des forces et des processus sociaux qui s'imoposent à lui et qu'il ne peut pas maîtriser.
1) L'individu comme produit de la société.
En quel sens peut-on dire de notre "personnalité" qu'elle est est façonnée par la société ? Nous partons du plus extérieur : l'apparence, et notamment l'apparence vestimentaire. Nous soulignons d'abord le caractère apparemment "personnel", individuel du vêtement est à la fois l'expression de goûts individuels, mais il est aussi lié à l'image que je veux donner de moi-même aux autres, et de l'image que je me donne à moi-même. En prenant appui sur deux photos de classe (2008, 2018), nous faisons apparaître la conformité des pratiques vestimentaires individuelles. Comment expliquer cette conformité ?
En prenant appui sur les analyses de Durkheim, nous montrons que les comportements vestimentaires individuels sont régis par des normes sociales (ex : les hommes ne peuvent pas porter de jupe) qui n'ont pas de fondement rationnel mais que les individus intériorisent (par l'éducation, l'instruction, l'imitation) ; de plus, si les individus tentent de s'opposer à ces normes (en portant une jupe), la société réagit par des formes de sanctions (nous envisageons ce que pourraient être les formes sociales de sanction auxquelles s'exposerait un enseignant qui tenterait de venir faire cours en jupe).
Les comportements vestimentaiers indivuiduels sont donc régis par des normes sociales qu'ils ne choisissent pas, qu'ils intériorisent et auxquelles ils sont contraints de se conformer : ils sont donc bien "déterminés" par des normes sociales. Nous insistons avec Durkheim sur le fait que, la plupart du temps, cette contrainte n'est pas ressentie par les individus : puisque précisément, ils ont intériorisé ces normes ! Mais la contrainte apparaît dès qu'ils tentent de s'en affranchir (nous envisageons le cas du rire comme forme élémentaire de la sanction sociale chez les enfants).
11.09. Nous envisageons pour terminer deux autres prises de position possibles face au problème de la liberté face à une loi injuste. La première est celle de la "désobéissance civile", que nous présentons à partir de l'analyse d'un texte du philosophe américain THOREAU. Thoreau prend le contre-pied de la thèse de Spinoza en affirmant :
(1) que face à une loi que l'on pense injuste (et même si celle-ci a reçu l'approbation de la majorité), nous avons le devoir de désobéir ; appliquer une loi que l'on pense injuste, c'est en effet collaborer à l'injustice, commettre soi-même l'injustice. C'est donc aller contre notre conscience (ce qui détruit la liberté) en commettant le mal (ce qui est condamnable). Ainsi, celui qui condamne la guerre américaine contre le Mexique, celui qui condamne la politique esclavagiste de l'Etat dans lequel il vit, devrait retirer tout soutien à l'Etat en question (par exemple, en refusant de répondre à l'appel de l'armée (ce dont se souviendront les opposants à la guerre du Viêt-Nam ou, comme le fit Thoreau, en refusant de payer ses impôts).
(2) que face à une loi que l'on pense injuste, il n'est pas de notre devoir (même si ce n'est pas interdit non plus) de chercher à convaincre l'Etat de modifier la loi. Le devoir d'un homme est de ne pas commettre l'injustice, non de faire régner la justice sur terre. Par conséquent, je n'ai pas, selon Thoreau, à "faire de la politique" pour rendre les lois justes, mais bien à leur désobéir quand elles sont condamnées par ma conscience. Le fait de "faire de la politique" n'a de sens que si l'on accepte les règles du jeu politique, et donc : si l'on accepte d'obéir à la loi si l'on ne parvient pas à ralier la majorité des voix : ce que nous devons justement éviter. Mais si je n'ai pas à convaincre l'Etat par un militantisme, je ne fdois pas non plus chercher à entrer en guerre contre lui, oà fomenter des révolutions, etc. Encore une fois, ce n'est pas ce que la conscience exige. Par conséquent, face à une loi que je pense injuste, ma liberté consiste à ne pas lui obéir, tout en laissant l'Etat jouer son rôle, qui peut être de m'envoyer en prison si je ne transgresse pas la loi.
Ces deux attitudes définissent la "désobéissance civile" : je refise d'obéir à une loi quand je la pense injuste, mais j'accepte les sanctions de l'Etat qui en découlent. Même si la désobéissance civile de Thoreau a inspiré (explicitement) des penseurs politiques comme Gandhi ou Martin Luther King, leur "activisme" politique va plus loin (ils ont incontestatnlement "fait de la politique") que ce que dit Thoreau. Une figure qui peut illustrer la poésture de la désobéissance civile serait le personnage d'Antigone qui, dans la pièce de Sophocle, refuse d'obéir à la loi formulée par Créon (selon laquelle le corps de l'un de ses frères doit être laissé sans sépulture), mais se soumet à la sanction décrétée par Créon. En ce sens, Antigone est bien une figure de la liberté, en tant qu'insoumission, mais elle n'est pas une figure de la révolte, une illustration d'une posture révoutionnaire (elle se laisse conduire à ce qui sera son tombeau). Et c'est en cela qu'elle peut illustrer la désobéissance civile.
La dernière prise de position possible est celle.... de la Déclaration des droits de l'Homme, qui repose sur une double thèse. Lorsque la loi respecte les droits fondamentaux de tous les citoyens (les "droits de l'homme"), tout citoyen doit lui obéir "à l'instant", qu'il soit d'accord avec la loi ou non. Un citoyen qui refuse d'obéir à la loi alors que la loi respecte les droits fondamentaux est en tort, et doit être sanctionné. En revanche, si la loi porte atteinte aux droits fondamentaux de n'importe quel citoyen, alors tous les citoyens ont le droit, mais plus encore le devoir, d'entrer en résistance face à l'Etat : c'est la "résistance à l'oppression". Cela veut-il dire que l'on désobéit à la loi ? En fait, non : puisque la loi... c'est d'abord la Constitution, et c'est justement la Constitution qui, par la déclaration des droits de l'homme qu'elle contient, nous commande de résister au gouvernement quand il devient oppresseur !
10.09.2019 : Correction du travail demandé : introduction du sujet :"Le travail est-il source de liberté ?" Distribution d'un corrigé et d'une structure de première partie (premier paragraphe argumentatif déjà construit : la liberté est source d'indépendance).
Travail à rendre pour le mardi 17 : rédiger l'analyse des notions de "travail" et "source de". Rédiger un paragraphe argumentatif justifiant l'idée que le travail est source de liberté.
Nous passons à la troisième partie de notre sujet d'application. La transition entre les parties 2 et 3 est simple : si la liberté exige l'obéissance à nos propres lois ET l'obéissance aux lois de la Cité... que faire lorsque les deux semblent entrer en conflit ? Qu'est-ce qu'être libre face à une loi que je pense injuste ?
Nous montrons que cette question peut donner lieu à des prises de position différentes, et inconciliables. A une posture légaliste (la liberté exige l'obéissance) s'opposeront les postures qui justifient la désobéissance au nom de la liberté. Nous choisissons de les examiner successivement (ce que nous ne ferions pas dans une dissertation, dans laquelle il faudrait défendre une prise de position claire).
Nous commençons par la posture légaliste : la liberté exige que nous obéissions aux lois, même lorsque nous pensons qu'elles sont injustes. En prenant appui sur un texte de SPINOZA, dont nous effectuons une lecture suivie, nous montrons que, pour Spinoza, la paix sociale exige bel et bien que les individus abandonnent leur liberté d'action : je dois toujours, dans mes actes, obéir aux lois. Il n'est jamais rationnel de violer les lois : ce n'est donc jamais un acte de liberté. Mais la suite du texte indique que les individus conservent en revanche leur liberté de pensée (ce que je pense ne peut pas porter atteinte à la coexistence pacifique), et leur liberté d'expression, à condition de n'en faire qu'un usage raisonnable (et non en utilisant la parole pour exciter la colère de lafoule, par exemple).
Qu'est-ce alors que suivre la raison, et donc être libre, face à une loi que je pense injuste ? Je dois
(1) lui obéir (dans mes actes)
(2) examiner dans mon esprit les objections que je peux lui faire, et
(3) faire part au Souverain, sous la forme d'argumentaires raisonnés, de ces objections.
Nous illustrons cette approche "légaliste" avec la situation de la France sous l'Occupation, telle qu'elle aparaissait aux yeux d'un partisan de Vichy, Charles Maurras. Nous montrons en quoi l'obéissance à l'Etat français pouvait apparaître comme la seule conduite raisonnable, et conc libre. Mais nous soulignons qu'en réalité, cette posture "légaliste" était aussi, même si cela peut sembler paradoxal, celle des Résistants. Les Résistants ne se considéraient pas comme des "hors-la-loi", mais bien comme des défenseurs de la loi française... telle qu'elle était inscrite dans la Constitution, et notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Aux yeux des Résistants, c'est le gouvernement de Vichy qui ne respectait pas la loi, en ne respectant pas la Constitution. De leur point de vue, il ne s'agissait donc pas de violer les lois, mais bien de mettre en oeuvre ce que la Déclaration de 1793 pose comme "le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs" : la résistance à l'oppression.
06.09.2019 : Mise en application de la méthodologie du développement : la justification des thèses.
Nous commençons par construire un premier paragraphe argumentatif visant à justifier et à illustrer la thèse selon laquelle la liberté est obéissance à nos propres lois. L'argument prend appui sur la définition : si la liberté consiste à suivre sa raison et sa conscience, alors êre libre exige d'obéir aux lois qui nous sont prescrites par la raison (par ex : les lois de la logique, qui nous permettent de raisonner correctement) et la conscience (les "devoirs"). A quoi il faut ajouter une règle fondamentale : si la liberté consiste à agir conformément à ce que l'on pense (être le meilleur choix), alors il faut commencer par faire l'effort de penser par soi-même. Nous illustrons la thèse par le cas du vote : le vote est par excellence l'acte qui n'a de sens que s'il est libre; le vote libre est celui qui exprime ce que je pense ; il exige donc de ma part un travail préalable (information, confrontation d'argumentaires différents,etc.) par lequel je vais former mon propre jugement. Nous synthétisons en posant que la liberté est avant tout auto-nomie, obéisance à nos propres lois, celles que nous dictent notre raison et notre conscience.
La transition entre nos deux premières parties est simple : si la liberté exige l'obéissnce à nos propres lois, qu'en est-il de l'obéissance aux lois de la Cité ? Suivre nos lois, est-ce rejeter les lois communes ? La liberté exige-t-elle l'an-archie ?
Nous construisons ensuite un second paragraphe argumentatif visant à démontrer que la liberté exige que les individus obéisent à des règles communes, garanties par l'Etat. L'argument s'appuie sur la pensée de SPINOZA : nous montrons que l'obéissance de tous à des lois communes est la condition du respect de la liberté de chacun, dans la mesure où seule cette obéissance permet d'éviter l'instauration de rapports de force, voués à devenir des rapports de domination. Nous illustrons cet argument avec le cas des guerres civiles, notamment des guerres de religion dans l'Europe du XVII° siècle.
Nous terminons notre deuxième partie en démontrant que cette obéissance à la loi ne doit pas seulement être le fait des individus,mais également le fait de l'Etat lui-même. En prenant appui sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nous montrons que la liberté ne peut être sauvée que si le gouvernement respecte la loi en respectant les droits fondamentaux qui y sont mentionnés. Sans quoi l'Etat devient oppresseur et la liberté est détruite. Nous illustrons cet aspect en analysant la dimension symbolique de la prise de la Bastille, atteinte à la "sûreté" au sens premier du terme.
Nous synthétisons en affirmant que la liberté, loin de réclamer l'anarchie,exige au contraire l'obéissance de tous à des lois fondées sur le respect des lois fondamentaux, obéissance des individus ET du gouvernement à la loi : ce qui définit "l'Etat de droit".
05.09.2019 : Mise en application de la méthodologie du développement : l'analyse des termes du sujet
Analyse des termes du sujet-témoin : lois, vivre, liberté. Après avoir indiqué les éléments clé de la loi (comme règle obligatoire) et du "vivre" (penser, agir, s'exprimer), on construit la définition de la notion de liberté. On part de la définition initiale "être libre, c'est faire ce que l'on veut", puis on procède à la distinction conceptuelle entre volonté et désir. On montre (à partir d'exemples : alcoolique, etc.) que la liberté ne consiste pas à suivre nos désirs, mais à adopter le compoirtement conforme à notre volonté (l'alcoolique qui veut arrêter de boire, mais qui est incapable de résister à son désir n'est pas libre : il est l'esclave d'un désir qui s'impose à lui et auquel il ne peut résister). Est libre celui qui a la "force de volonté" nécessaire pour résister à ses désirs.
On se demande alors par quoi (puisque ce n'est pas le désir) est déterminée la volonté. On montre que les facultés qui régissent la volonté sont la conscience (en tant que faculté de discernement moral) et la raison.
La liberté consiste donc à agir conformément à ce que notre raison et notre conscience nous indiquent être le meilleur choix. [def 1]
Dans la mesure où la raison et la conscience sont les facultés caractéristiques de la nature humaine, on comprend qu'être libre, ce n'est rien d'autre que suivre les facultés qui font de nous un être humain : être pleinement "humain".
Nous montrons que cette caractérisation de la liberté correspond à la conception fondamentale dans la tradition philosophique ; pour Platon, pour Erasme, pour les philosophes des Lumières, la liberté consiste à vivre conformément aux facultés qui font de nous un être humain. Dans le cas des Lumières, on indique cependant que, si Kant donne la primauté à la raison, Rousseau privilégie la conscience (qui est un sentiment) : nous y reviendrons dans le cours sur la conscience.
Nous montrons enfin que cette définition correspond à celle qu'adopte implicitement le droit (pénal) ; si la liberté est la condition de la responsabilité, le droit considère que la responsabilité de l'homme n'est remise en cause que là où son discernement (qui regroupe la raison et la conscience) est aboli.
04.09.2019 : Mise en application de la méthodologie sur le sujet-témoin :"Être libre, est-ce vivre sans lois ?" Construction d'une introduction. Pour l'approche du sujet, nous prenons le cas de la mise en place de règles collectives et obligatoires dans les ZAD : cela nous conduit à nous demander si la recherche de la liberté implique le rejet de la loi en tant que telle. Pour la problématisation, on insiste sur le conflit apparent entre la liberté et la soumission aux lois, avant de montrer que l'absence de lois peut conduire à la disparition des libertés (domination desplus forts). A quel type de lois devons-nous alors obéir pour être libre ? Pour l'annonce du plan, on suit un raisonnement semi-linéaire : on montrera d'abord en quoi la liberté implique l'obéissance à sa proper loi (autonomie), avant de montrer en quoi la sauvegarde des libertés implique l'obéissance de tous à des règles communes ; ceci nous conduira à nous interroger sur le rapport entre la liberté et la contestation des lois que l'on pense injustes.
Exercice à rendre pour le mardi 10 : rédiger l'introduction du sujet "Le travail est-il source de liberté pour 'l'homme ?"
Méthodologie du développement. 1. L'analyse des termes du sujet. 2. La construction des paragraphes argumentatifs : Thèse / Argument(s) / Exemple(s) / Synthèse
03.09.2019: Présentation de la discipline, du programme, des épreuves du bac et du site internet. Méthodologie de la dissertation (1). Présentation des consignes méthodologiques de l'introduction : approche du sujet (exemple d'approche pour le sujet : la démocratie est-elle le système politique le plus juste ?), problématisation (exemple de problématisation pour le sujet :"pour être heureux, faut-il satisfaire tous ses désirs ?"), annonce du plan.
03.09.2019 : accueil des élèves, présentation de la terminale : baccalauréat et orientation.
-
Vous trouverez ans cet espace les fiches méthodologiques relatives aux deux exercices de type bac.