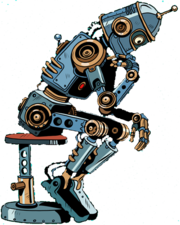Autrui, un espace inviolable
Nous commençons ici à mettre en rapport le sujet avec l'autre-sujet, c'est-à-dire autrui. Pour définir la notion d'autrui, rien de mieux que de partir de la définition que donne Sartre dans "l'Etre et le néant" : autrui, c'est "ce Moi qui n'est pas moi et que je ne suis pas". Cette définition manifeste trois choses :
a) Autrui "est un Moi" : ce n'est donc pas un simple objet, mais un sujet, doté de conscience
b) Autrui "n'est pas moi" : autrui est donc un autre, distinct, séparé et différent de moi.
c) Autrui n'est pas moi / je ne suis pas autrui : le rapport entre moi et autrui est un rapport réciproque : autrui est autrui pour moi, mais je suis autrui pour autrui.
Dans la définition sartrienne, nous avons donc déjà la tension fondamentale qui constitue la notion d'autrui : autrui est "mon semblable", il est "comme moi" en tant que nous sommes tous deux des "moi", des sujets dotés de conscience. Mais autrui est "autre que moi" en tant que nous ne sommes pas la même personne, que nous sommes des individus distincts et que nos caractéristiques sont différentes. Pour résumer, autrui est mon semblable en tant qu'homme, mais il m'est étranger en tant qu'individu. Ce qui pose le problème de la reconnaissance réciproque des sujets humains : comment les individus peuvent-ils se reconnaître mutuellement dans leur humanité, sans abolir leur différence ?
"L'ennemi est bête : il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui !" (Pierre Desproges)
Saisir autrui dans son identité / altérité, c'est donc le saisir comme "alter ego", comme autre moi. Mais attention ! Autrui n'est pas un autre "moi-même " (ce que l'on entend parfois par "alter ego") ; car dans ce cas, j'abolis la différence entre moi et l'autre. Mieux vaut donc dire que autrui est un "moi autre". [Ce genre de gymnastique verbale fait partie de la thématique d'autrui : il est donc recommandé de vous familiariser avec cet exercice rhétorique... qui peut resurgir dans un texte d'examen.]
Commençons par "l'alter". Ce qui fait d'autrui un autre, ce n'est pas d'abord sa différence : c'est ce qui nous sépare. Autrui est un être séparé, distinct de moi. Je peux éventuellement penser un autre absolument identique à moi (du point de vue génétique, deux jumeaux homozygotes sont rigoureusement identiques) ; mais il restera encore séparé, distinct de moi. C'est le sens de l'énoncé de Sartre selon lequel "autrui n'est pas moi" (et je ne suis pas autrui).
Ce qui me signifie cette séparation, c'est d'abord le corps d'autrui. Je peux penser qu'autrui puisse avoir un corps identique au mien : mais je ne peux habiter son corps, et il ne peut habiter le mien. Le corps d'autrui est le lieu par excellence où je ne pourrai jamais séjourner : pour que j'occupe un espace, il faut que le corps d'autrui l'ait libéré.
Mais, objectera-t-on, il est difficile de considérer que le corps d'autrui est absolument "fermé". En ce qui concerne le corps de la femme au moins, le seul fait de la vie humaine indique que le corps de la mère a bien du "s'ouvrir" en quelque manière.
[A l'âge que l'on peut accorder chez le lecteur d'un site de ce genre, on peut supposer dépassée la représentation du sexe féminin comme espace "vide" : ce qui est susceptible de s'ouvrir, c'est encore le corps. Insistons sur ce point : le corps ne se limite pas à de la matière : même les espaces "creux" dans le corps humain (songeons à la bouche, par exemple) font encore partie du corps. ]
Man Ray, Le violon d'Ingres...
Maintenons donc l'idée qu'il peut bien y avoir pénétration d'un corps dans un autre. Faut-il alors remettre en cause le caractère "clos" du corps d'autrui ? Non. Mais il faut en revanche admettre que "l'impénétrabilité" du corps d'autrui doit s'entendre de deux façons. Il s'agit d'une part d'une impossibilité (je ne peux pas, physiquement, me "mettre à la place de l'autre" si l'autre n'a pas libéré cette place) ; mais il s'agit plus encore d'une interdiction. Le corps d'autrui est l'espace au sein duquel je ne dois pas entrer : il s'agit ici d'une impossibilité morale. C'est en ce sens que l'on peut comprendre, par exemple, la très ancienne prohibition de la dissection du corps humain. Il est interdit d'ouvrir, d'entrer dans le corps humain. Et, en ce sens, on peut bien considérer le corps humain comme un sanctuaire, comme un espace sacré.
Mais, objectera-t-on encore, cela signifie-t-il que les rapports sexuels seraient contraires au respect du caractère sacré du corps ? Non. Car, comme nous le rappelle Georges Bataille, "sacré" signifie toujours deux choses :
a) est sacré ce qui est frappé d'interdit. En ce sens, c'est bien le caractère sacré du corps qui fonde l'interdiction de son ouverture ou de sa pénétration. Mais...
b) la transgression de l'interdit est, elle aussi, sacrée. Les gestes du rite sont, bien souvent, des transgressions de l'interdit ; mais ces transgressions sont elles-mêmes sacrées : elles ne peuvent donc être commises que dans le cadre du rite, et par une personne "consacrée". Par exemple, personne n'a le droit de manger le corps ou le sang du Christ au petit déjeuner : c'est absolument interdit ! Songeons à quelqu'un qui se verserait un verre de vin de messe ("ceci est mon sang") pour accompagner son pot-au-feu... Sacrilège ! Profanation ! Et pourtant, le fait de manger le pain, l'hostie ("ceci est mon corps") est bien un geste obligatoire... mais seulement à la fin de l'eucharistie, lorsqu'on la reçoit de la main du prêtre. C'est une "transgression sainte" : l'autre face du sacré. Par conséquent, on peut tout à fait admettre que le corps d'autrui est un sanctuaire inviolable, un espace sacré : cela signifie que toute pénétration du corps d'autrui est interdite, mais que cette transgression peut se trouver justifiée par un rituel qui fait de cette transgression une transgression sainte. La pénétration du corps de l'autre est toujours une transgression (en cela, on peut dire qu'elle constitue toujours une violence) : mais elle peut être soit profane (elle est alors "profanation" du corps), soit sainte (acte rituel).
Rodin, Andromède
Pour information, cette corrélation de l'érotisme, de la transgression et du sacré, chère à Georges Bataille (que nous recroiserons un peu plus loin) est une matrice que l'on retrouve tout au long de l'histoire de l'art occidental. C'est ce qui explique, par exemple, que le thème antique de la "fête de Dionysos", fête orgiaque où la sexualité, la transgression et le rite religieux s'entremêlent, resurgisse de façon récurrente (notamment à travers les peintures de "Bacchanales") tout au long de l'histoire de la peinture. On le trouve de façon plus que récurrente chez les peintres des XVI°-XIX° siècles, notamment à travers les peintures de "Bacchanales".
Une "Bacchanale" de Le Titien, peintre vénitien du XVI° siècle
Une autre "Bachhanale", mais de Nicolas Poussin (peintre français du XVII°)
...encore une "Bacchanale", de Rubens (peintre hollandais du XVII-XVIII°)
Pour changer un peu, une sculpture d'Auguste Clesinger, sculpteur français du XVIII° : "Bacchante couchée". Théophile Gautier la décrivait ainsi : « c’est le pur délire orgiaque, la Ménade échevelée qui se roule aux pieds de Bacchus, le père de liberté et de joie […] Un puissant spasme de bonheur soulève par sa contraction l’opulente poitrine de la jeune femme, et en fait jaillir les seins étincelants…». Le Romantisme n'est pas loin...
...et une dernière Bacchanale, de Charles Gleyre, peintre suisse du XIX°.
Ajouter un commentaire