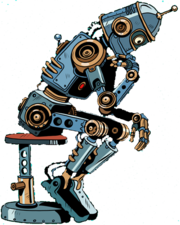Histoire et interprétation
Y a -t-il une "vraie" interprétation de l'Histoire ? Pour répondre à cette question, le plus simple est de repartir de la manière dont on écrit l'histoire, telle que la conçoivent les historiens. L'analyse du texte de Lucien Febvre (qui se trouve  ici) nous a permis d'élucider la formule selon laquelle "toute histoire est choix".
ici) nous a permis d'élucider la formule selon laquelle "toute histoire est choix".
Le choix s'entend d'abord ici au sens d'une sélection des faits, cette sélection ne résultant pas nécessairement de choix humains. Ainsi, le matériau dont dipose l'historien reste toujours lacunaire : il n'a pas à sa disposition le registre de la totalité des faits passés, (qui serait évidemment infiniment infini), d'innombrables données sont à jamais perdues. Cela signifie donc que l'historien construit son interprétation de l'histoire à partir d'un matériau partiel.
Mais cet aspect lacunaire des "sources" peut être compris de deux façons :
a) soit l'on sépare entièrement cette "sélection" de tout choix humain, et l'on souligne le rôle du hasard dans la conservation des "archives" : certains manuscrits, par exemple, ont été définitivement perdus suite à l'incendie d'une bibliothèque, au pillage d'une ville, etc. Dans ce cas, l'ensemble des faits sur lesquels travaillera l'historien sera certes "partiel" (il n'aura pas accès à certaines données) mais on ne pourra pas le considérer comme "partial", puisque seul le hasard a détruit, en aveugle, telle ou telle source. Le matériau sur lequel travaille l'historien peut alors être dit partiel, mais globalement neutre.
b) soit l'on rattache la sélection des faits consultables par l'historien à un certain nombre de choix humains. Il ne s'agit pas ici seulement de traquer les individus malfaisants qui auraient détruit (ou caché) tel ou tel document : on sait que l'une des thèses du roman Le nom de la Rose est que si le dernier exemplaire de "La comédie" d'Aristote a disparu, c'est parce que les autorités eccléstastiques ont jugé qu'il fallait le soustraire aux yeux des hommes.

La bibliothèque interdite...
Que la destruction de certaines sources, de certaines archives, ait été commise de façon volontaire par tel ou tel groupe humain au cours de l'histoire ne fait aucun doute. Mais là encore, pour que le résultat global de cette destruction d'archives soit un résultat partial, "orienté", il faudrait que, d'un bout à l'autre d'une séquence historique, le même clan, le même groupe social se soit trouvé en position de détruire les sources compromettantes pour lui. Ce qui est souvent difficile à défendre, sauf lorsque l'on écrit des romans : on sait que, dans le roman de Dan Brown (da Vinci Code), si pendant 2000 ans toutes les sources concernant le "fils du Christ" ont disparu, c'est parce que, durant 2000 ans, le même rapport de force entre l'Eglise romaine et le "Prieuré de Sion" a cantonné les deux acteurs dans la même position : la première s'efforçant de détruire les sources que le second s'efforçait de cacher.
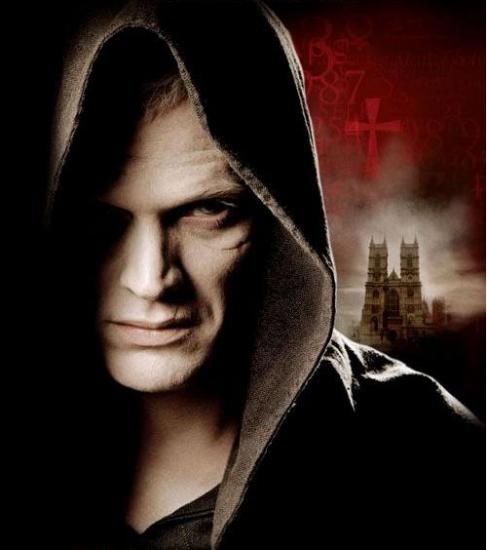
Mais, hors du domaine romanesque, il est très rare qu'un rapport de force se maintienne pendant 2 millénaires : il est donc extremêment rare qu'un clan puisse s'octroyer le monopole des sources... et de leur destruction. Les thèses selon lesquelles "on nous a toujours menti" sont donc bien souvent de pures et simples "théories du complot", puisqu'elles supposent qu'un acteur de l'histoire est suffisamment puissant pour posséder une maîtrise totale des sources à partir desquelles les historiens travaillent (archives, témoignages, etc.). Or cette maîtrise totale est davantage un fantasme de paranoïaque ou de politicien fou qu'une réelle possibilité... du moins jusqu'à présent.
Mais il existe une autre manière de corréler le caractère "sélectif" des données auxquelles l'historien a accès et les décisions humaines. C'est de partir, non de la destruction des sources, mais de leur conservation. N'oublions pas en effet que, pour qu'un historien ait accès à des événements passés, il fait que ces faits aient laissés des traces ; or le fait même qu'un fait soit collecté, enregistré et conservé indique que ce fait lui-même a été jugé suffisamment intéressant par les hommes d'une époque pour être digne d'être ainsi "mémorisé". Les données qui ont été collectées et conservées par une société nous disent déjà beaucoup sur cette société, non par ce qu'elles contiennent, mais par ce qu'elles nous indiquent concernant ce que cette société jugeait important. Pour prendre un exemple simple, il est beaucoup plus difficile pour un historien de travailler sur l'évolution des populatiions au Moyen-Âge qu'au XIX° siècle en Europe. Car c'est entre le XVIII° et le XX° siècle que la majorité des pays européens ont mis au point leurs techniques de recensement des populations. Or si on a "découvert" ces techniques, ce n'est pas en raison des avancées de la science : c'est parce que ce recensement revêtait une importance toujours croissante aux yeux des autorités d'Etat. En Europe, le formidable développement du recensement au XIXe siècle nous indique clairement l'une des transformations du pouvoir d'Etat, qui devient de plus en plus centralisé : les individus deviennent une "population" que l'Etat peut contraindre, par le droit et (donc) par la force s'il le faut, à aller combattre. Au XIX° siècle, la logique du recensement, c'est avant tout celle de la conscription.


Un parallèle un peu facile, mais c'est pour vous faire saisir l'idée...
En ce sens, on peut dire que le caractère "partiel" des données auxquelles accède l'historien est bel et bien "partial" : l'historien ne reconstruit l'histoire d'une époque qu'à partir des données que cette époque a bien voulu collecter et conserver. Si l'on se situe sur le plan de l'histoire individuelle, l'historien n'a accès qu'aux événements qui ont su mobiliser l'attention des "témoins" ; si l'on se situe sur celui de l'histoire sociale, alors l'historien n'a accès qu'aux données que reflètent les registres d'état civil, les journaux officiels, les compte-rendus de séances parlementaires, etc. En ce sens, on peut dire que toute époque conditionne le regard que porteront sur elle les historiens de l'avenir : dans la mesure où c'est elle qui "choisit" le type de données qui constitueront le "matériau" de travail de l'historien.
[A titre de prolongement du raisonnement, on pourrait souligner que la manière dont notre époque collecte et conserve l'information est tout à fait intéressante. Si on se limite au seul as des déplacements, on peut remarquer qu'un élève qui se rend au lycée le matin ne cesse de produire des données enregistrées concernant ses déplacements : chaque déplacement utilisant les transports en commun (métro, train, tram...) est enregistré-mémorisé s'il utilise une carte (carte TCL, carte M'RA, etc. (on peut se demander ce qui peut bien justifier l'obligation de valider cette carte à chaque trajet, chose inédite dans l'histoire des abonnements, si ce n'est le fait de produire de l'information sur les déplacements des utilisateurs), son téléphone portable, s'il est allumé, ne cesse d'envoyer des signaux qui permettant de le localiser, il entre ensuite au lycée grâce à une carte qui rend possible l'enregistrement des entrées/sorties de tout élève (c'est le cas, par exemple, à l'ENS Lettres de Lyon), et entre temps il sera passé (devant le lycée, par exemple) devant une douzaine de caméras de vidéo-surveillance. Notre époque est indéniablement une époque de collecte exponentielle d'informations. On peut considérer cela comme une chance pour les historiens de l'avenir ; mais il est encore plus certain que la première information que cette information démultipliée leur apportera, c'est celle qui concerne la manière dont notre époque aura séparé radicalement la notion d'espace privé et celle d'espace "non-public", au sens notamment d'espace inaccessible au regard des institutions (économiques ou politiques). Notre éoque est indéniablement marquée par ce vieux mot de Hobbes selon lequel les hommes sont bien souvent heureux d'accepter une restriction de leurs libertés au nom de leur confort et de leur sécurité. ]
Mais revenons à notre Histoire. Pour Lucien Febvre, si l'histoire est choix, c'est certes parce que l'historien travaille toujours sur des sources qui opèrent elles-mêmes une sélection des faits, que cette sélection soit due au hasard ou aux projets humains. Mais c'est plus encore du fait des choix qu'effectue l'historien. L'argument de Lucien Febre est ici très intéressant, et il faut le lire à la lumière du parcours que nous avions effectué dans notre chapitre consacré au rapport entre raison et réel.
Pour Lucien Febre, si l'historien effectue des "choix", c'est que le point de départ de sa démarche n'est pas une pure consultation des sources et des archives ; contrairement au récit que l'on donne parfois du travail de l'historien, ce travail ne repose pas sur le triptique : 1) collecte-consultation de l'information, 2) travail critique des sources (évaluation de la validité et de la convergence des sources, etc.), 3) construction d'une interprétation. Pour Lucien Febvre, l'interprétation vient au début. La démarche de l'historien n'est en rien une démarche "neutre" : l'historien part avec en tête une hypothèse, une pré-interprétation dont il s'agit de voir si elle "tient". Il faut donc renverser le triptique : loin que l'interprétation émerge péniblement du travail critique opéré sur les sources, c'est l'interprétation qui guide et oriente le travail de lecture et de sélection des sources.
Si l'historien s'enquiert de telle ou telle donnée, de telle ou telle source, c'est parce qu'il estime que cette donnée est pertinente pour comprendre le sens d'un événement ; or pour savoir quelles sont les données pertinentes pour comprendre le sens d'un événement, pour déterminer ce que sont les données qui, réunies, feront apparaître une logique compréhensible au sein de la séquence historique... il faut déjà savoir quel sens on cherche à prêter à cet événement. C'est parce que l'historien a déjà son interprétation en tête qu'il s'oriente vers tel ou tel type de données, qu'il cherche à mettre en lumière les articulations entre tel et tel événement, etc. Bref, si l'historien parvient à construire un récit historique qui produise une interprétation cohérente d'une séquence historique, c'est parce qu'il a élaboré son récit à la lumière de cette interprétation.
Les peintures d'Arcimboldo (peintre italien du XVI° sicèle) constitueraient une métaphore intéressante du travail de l'historien selon Lucien Febvre : mieux vaut savoir au départ à quoi l'on veut aboutir si l'on veut disposer les objets/faits comme il faut...
Mais, objectera-t-on, si l'historien part ainsi d'un "préjugé" qui oriente toute sa démarche, il ne peut plus du tout prétendre à l'objectivité qui caractérise la démarche du scientifique des sciences de la nature !
C'est précisément là que l'argumentation de Febvre est judicieuse : loin que cette influence de l'hypothèse de départ sur la lecture des faits éloigne l'historien de la délarche scientifique, c'est précisément elle qui l'en rapproche. Rappelons-nous ce que disait Claude Bernard : "celui qui ne sait pas ce qu'il cherche ne comprend pas ce qu'il trouve" : c'est précisément ce qui vaut pour l'historien. Nous avions montré comment le scientifique des sciences expérimentales partait d'un ensemble d'hypothèses et de présuppositions pour organiser ses expériences en laboratoire : c'est parce que le scientifique a une hypothèse à vérifier qu'il peut effectuer une inteprétation féconde des résultats qu'il obtient. De même, nous avions affirmé (avec Kuhn) que le scientifique ne pouvait "voir" dans son laboratoire que ce que ses présuppositions de départ lui permettaient, le préparaient à voir ; le scientifique ne "voit" que les données "pertinentes", et cette pertinence est déjà déterminée par ce qu'il cherche et s'attend à voir. Le scientifique qui en tasserait "à l'aveugle" des observations, sans idée préconçue concernant ce qu'il s'agit de trouver ou de démontrer, ne pourrait construire aucune interprétatiion valable de ses résultats.
"Celui qui ne sait pas ce qu'il cherche ne comprend pas ce qu'il trouve" : Lucien Febvre ne dit pas autre chose. C'est précisément parce que l'historien part d'une hypothèse à vérifier, qu'il cherche à organiser les faits-événements conformément à une interprétation déjà formulée, qu'il peut "comprendre ce qu'il trouve", c'est-à-dire organiser les faits collectés d'une façon compréhensible.
Ajouter un commentaire